Xavier Pavie : «Derrière l’innovation, une volonté de transcendance»
ENTRETIEN : Dans L’innovation à l’épreuve de la philosophie récemment paru chez PUF, le philosophe Xavier Pavie, professeur à l’ESSEC, étudie cette force de changement qui vient de l’homme tout en cherchant à le dépasser. Mais il se veut résolument optimiste : oui, il est possible d’arrêter une innovation jugée nuisible pour la société.
 Docteur en Philosophie et diplômé en Management, Xavier Pavie est Professeur à l’ESSEC Business School, où il dirige le Master in Management de Singapour et le centre iMagination, et chercheur associé à l’Université Paris-Ouest. Auteur d’une douzaine d’ouvrages, il a notamment publié Innovation responsable, levier de croissance pour les organisations (Eyrolles), Exercices spirituels, leçons de la philosophie antique (Les Belles Lettres), Exercices spirituels, leçons de la philosophie contemporaine (Les Belles Lettres) et L’innovation à l’épreuve de la philosophie (PUF). Suivre sur Twitter : @xavierpavie
Docteur en Philosophie et diplômé en Management, Xavier Pavie est Professeur à l’ESSEC Business School, où il dirige le Master in Management de Singapour et le centre iMagination, et chercheur associé à l’Université Paris-Ouest. Auteur d’une douzaine d’ouvrages, il a notamment publié Innovation responsable, levier de croissance pour les organisations (Eyrolles), Exercices spirituels, leçons de la philosophie antique (Les Belles Lettres), Exercices spirituels, leçons de la philosophie contemporaine (Les Belles Lettres) et L’innovation à l’épreuve de la philosophie (PUF). Suivre sur Twitter : @xavierpavie
iPHILO. – On a souvent l’impression que la philosophie s’intéresse peu aux phénomènes économiques et gestionnaires. Vous êtes philosophe et professeur à l’ESSEC, comment l’expliquez-vous ?
Xavier PAVIE. – A quoi doit s’intéresser la philosophie ? D’abord aux problèmes que les individus rencontrent, ça a d’ailleurs toujours été le cas. Depuis l’Antiquité, elle a toujours cherché à comprendre le monde, voire à le changer. Cette recherche d’une forme de sagesse vise notamment une organisation plus positive de la société, des citoyens, de la cité. Aujourd’hui, il est compliqué de dire – voire il faut être de mauvaise foi – que ce ne sont pas les systèmes économiques qui gèrent le monde. On peut le regretter, il n’empêche que la société capitaliste et la mondialisation telles qu’elles sont montrent bien que ce sont les organisations plutôt privées, plutôt commerciales, qui le dirigent.
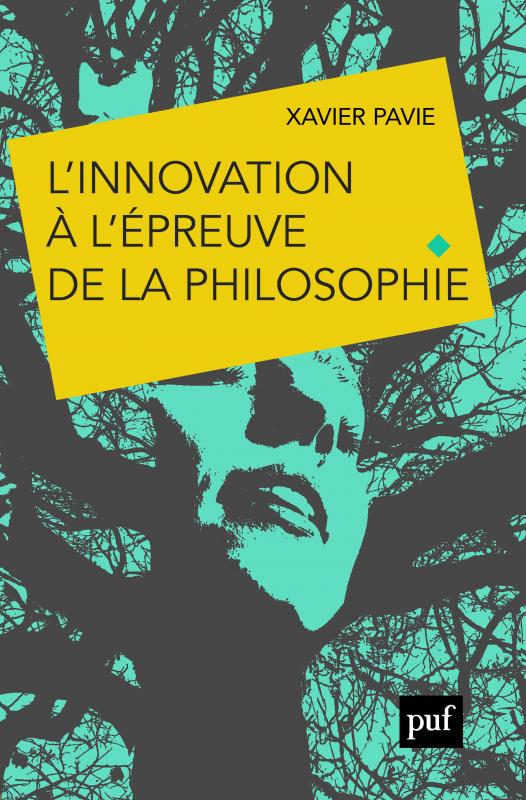 La philosophie doit donc s’emparer de ces sujets, notamment celui de l’innovation car celle-ci change et transforme notre monde. La philosophie est coupable de rester dans sa tour d’ivoire, détachée de ce monde qui est le nôtre, parce qu’il ne lui paraîtrait pas assez noble. C’est par exemple dans les organisations de commerce et au sein du système éducatif que l’on doit poser ces questions. Les innovateurs de demain sont face à nous. Ils ont peut-être entre 15 et 30 ans et sont peut-être dans une école comme l’ESSEC. Nous avons une responsabilité, nous philosophes, auprès de ces plus jeunes.
La philosophie doit donc s’emparer de ces sujets, notamment celui de l’innovation car celle-ci change et transforme notre monde. La philosophie est coupable de rester dans sa tour d’ivoire, détachée de ce monde qui est le nôtre, parce qu’il ne lui paraîtrait pas assez noble. C’est par exemple dans les organisations de commerce et au sein du système éducatif que l’on doit poser ces questions. Les innovateurs de demain sont face à nous. Ils ont peut-être entre 15 et 30 ans et sont peut-être dans une école comme l’ESSEC. Nous avons une responsabilité, nous philosophes, auprès de ces plus jeunes.
Justement, dans L’innovation à l’épreuve de la philosophie paru récemment chez PUF, vous dîtes vouloir mettre l’innovation à l’épreuve de la sagesse comme le matériau testé dans des conditions extrêmes avant d’être envoyé dans l’espace. Mais en cas d’échec, le métal fond, se désagrège, se disloque. Il n’en est rien pour l’innovation qui continuera…
J’ai cherché à écrire cet ouvrage en mettant à l’épreuve l’innovation ou, plus précisément, le processus d’innovation, autrement dit, la façon, la manière, le procédé par lesquels nous innovons, et nous les innovations elles-mêmes. Quitte pour le coup à mettre ce processus dans des conditions extrêmes, à le voir se disloquer, se désagréger comme un matériau envoyé dans l’espace.
Lire aussi : Luther, la société et le marché (Claude Obadia)
Cela m’a paru nécessaire parce que les processus d’innovation que nous conservons date d’une trentaine voire d’une cinquantaine d’années : ils ne sont plus appropriés aux enjeux d’aujourd’hui et de demain. Ils n’ont pas suivi la croissance de nos connaissances, l’émergence d’internet, la prise de conscience de nouvelles questions, comme celles liées à l’environnement. On ne peut plus innover comme avant. Nous devons même mettre à mal voire faire exploser ces processus passés.
L’innovation vient étymologiquement de novare, changer en latin, et de in, qui signifie à l’intérieur. Mais n’y a-t-il pas quelque chose d’extérieur à la volonté humaine dans l’innovation, quelque chose qui dépasse l’homme ?
Non, l’innovation vient toujours de l’homme. En revanche, elle est le résultat d’un certain nombre d’individus qui vont chercher à mettre en place quelque chose qui peut effectivement les dépasser. Et en même temps, ce quelque chose, ce sont eux qui l’ont fait. C’est toute la subtilité. Prenons l’exemple d’Elon Musk qui souhaite aller sur Mars, c’est une innovation presque paradigmatique. Et bien, cela est précisément la volonté d’un homme d’accomplir quelque chose qui le dépasse et qui le dépassera peut-être au sens propre : la possibilité d’aller sur Mars voire de coloniser cette planète, ainsi qu’il l’appelle de ses vœux, pourrait bien n’être mis en œuvre que bien après sa mort. C’est ainsi que l’espèce humaine elle-même ne cesse de se développer. Il n’y a pas quelque chose d’extérieur à la volonté humaine, mais bien une volonté humaine qui cherche à se transcender.
Vous écrivez qu’il y avait deux contraintes qui pesaient jusqu’à présent sur l’innovation, mais que celles-ci ont volé en éclat. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Oui, ces deux contraintes étaient pour l’une d’ordre technique, pour l’autre d’ordre moral. Cette dernière était incarnée par l’Eglise ou plutôt les églises en général. Les religions empêchaient certains travaux, certaines études, certaines façons de travailler. Je pense en particulier aux questions comme la PMA, la GPA, le séquençage de l’ADN, au génome. Et bien, les églises ont toujours refusé que l’on travaille sur l’humain, qui était quelque chose de sacré. Je ne veux pas dire que les églises ont disparu, mais que lorsqu’elles prennent la parole, elles ne sont plus aussi audibles. Cela laisse le champ libre aux innovateurs, qu’ils s’appellent médecins, savants, scientifiques, ingénieurs.
Lire aussi : Stratégie et entreprise : fallait-il brûler tout Marx ? (Bruno Jarrosson)
L’autre contrainte est d’ordre technique. Le fait que nous cherchions par exemple l’immortalité n’a rien de nouveau : la fontaine de jouvence, la boîte de Pandore, le rêve prométhéen, etc. on retrouve ce projet à travers toute la mythologie puis au Moyen-Âge, à la Renaissance. Dans toutes les périodes de l’histoire humaine, nous avons cherché à viser l’immortalité, mais ce n’était techniquement pas possible. Aujourd’hui, pour la première fois, il y a très clairement une possibilité de faire. Vu la disparition de ces deux contraintes, la nouvelle question est : faut-il faire ou pas ?
Depuis la philosophie des Lumières, le progrès servait à qualifier la dynamique d’amélioration du monde. Ce terme n’est plus à la mode, contrairement à celui d’innovation. Quel rapport établissez-vous entre ces deux termes ?
L’innovation est devenue un mot à la mode, mais le mot lui-même est ancien. Il date du Moyen-Âge même si son sens a évolué. Le progrès est un petit peu différent. C’est la visée de la civilisation. Il y a quelque chose de l’ordre de l’idéal, ce qui n’est pas forcément le cas de l’innovation. L’innovation est aussi à regarder d’un point de vue économique et commercial. Ce sont les organisations qui vont chercher à innover, quelles que soient leur forme, qu’elles soient profitables, non profitables, qu’elles soient un système politique ou économique. Malgré tout, ces organisations vont toujours chercher à améliorer leurs performances, idée que l’on ne retrouve pas forcément dans le progrès. Pourquoi cette logique de la performance ? Parce qu’on a des concurrents. La concurrence favorise l’innovation.
Vous dîtes qu’il ne s’agit plus de notre capacité à faire, mais de notre choix de faire ou non. Est-ce seulement possible ? Autrement dit, une innovation peut-elle être arrêtée ?
Bien sûr, elle peut être arrêtée dans la mesure où ses effets auront été anticipés grâce à l’établissement d’hypothèses durant sa période de construction. Il me semble que seul l’innovateur peut arrêter une innovation lorsqu’il en arrive à la conclusion qu’elle est nuisible pour la société, l’environnement et qu’il peut dire : j’ai des connaissances qui le montrent. Toute la difficulté, c’est évidemment qu’il va y avoir d’autres parties prenantes : les actionnaires vont pouvoir dire, par exemple, dans une société commerciale : non, il faut la continuer, parce qu’elle est profitable.
Encore faut-il pouvoir mesurer l’innovation. A court terme, elle peut être jugée pertinente, mais peut être en même temps dangereuse à long terme. Comment s’assurer que la mise à l’épreuve de l’innovation respecte le temps long, que l’innovation devienne durable ?
C’est toute la complexité. L’innovation a un caractère très incertain dans tous les sens du terme. Est-ce que ce sera une innovation ou est-ce que cela restera-t-il simplement une idée ? Nul ne sait à l’avance. C’est souvent l’exploitation de l’innovation qui va faire en sorte qu’elle devienne réellement une innovation. A ce titre-là, l’innovation doit toujours être sous contrôle. Lorsque nous avions de l’amiante dans les années 1960, nous ne savions pas si cette innovation, qui était extrêmement performante à l’époque, pouvait être ou non nuisible pour les individus.
Lire aussi : La déraison de l’économie (Jean-Pierre Dupuy)
La question est donc : dès lors que nous savons, alors que peut-on faire ? C’est d’ailleurs ce qui distingue le principe de précaution – qui fait dire plutôt « on ne fait pas » – du principe de responsabilité dans lequel on peut faire mais sous contrôle. Dans un système mondialisé et globalisé, extrêmement concurrencé, nous ne pouvons pas seulement dire « on ne le fait pas » au nom du principe de précaution car, à quelques encablures d’une société qui va décider d’interdire ceci ou cela, et bien, d’autres décideront de les mettre en œuvre. Il faut donc plutôt agir selon un principe de responsabilité qui passe par le suivi, le contrôle, la mesure des innovations, avec, à la fin, la possibilité de dire stop à une innovation dès lors qu’elle ne respecte plus un certain nombre de critères.
Que représente l’innovateur aujourd’hui ? Un surhomme ?
D’une certaine mesure, car il s’affranchit des règles, des régulations, des normes établies, des standards, de tout ce qu’il peut y avoir autour de lui. Globalement, il veut à la fois survivre dans un environnement économique donné, mais surtout résoudre un problème que d’autres n’ont pas résolu. Ca peut être Airbnb qui s’attaque aux problématiques du logement hôtelier, Uber qui veut que l’on puisse trouver un taxi facilement, mais aussi Dick Fosbury qui a trouvé une méthode pour sauter plus haut que les autres, ou encore un artiste comme Claude Monnet qui veut chercher une autre technique pour faire apparaître ce qu’il voit. Les innovateurs sont des surhommes dans la mesure où ils bouleversent la manière dont nous agissons dans le monde. Et puis, ils ne supportent pas la stagnation, ces façons de faire où tout est établi.
Pour aller plus loin : Xavier PAVIE, L’innovation à l’épreuve de la philosophie, éd. PUF, 2018.
Docteur en philosophie et diplômé en science de gestion, Xavier Pavie est Professeur à l'ESSEC Business School, où il dirige le centre i-Magination, et chercheur associé au sein de l'IREPH (Institut de Recherches Philosophiques) de l'Université Paris Ouest. Auteur de nombreux articles et d'une douzaine d’ouvrages, à la fois en philosophie et en management, il a récemment publié : Innovation-responsable (Eyrolles) ; Exercices spirituels, leçons de la philosophie antique (Les Belles Lettres 2012) et Exercices spirituels, leçons de la philosophie contemporaine (Les Belles Lettres 2013). Site internet :http://www.xavierpavie.com/. Suivre sur Twitter : @xavierpavie.


Commentaires
Dans un contexte différent, je pourrais être sincèrement touchée par la naïveté des propos de ce si jeune homme (je ne sais pas quel âge il a, à vrai dire).
Mais, mais, mais…
Son vocabulaire reflète la platitude, et l’extrême pauvreté de l’idéal du management, et la tentative de mettre en quarantaine, sinon disqualifier, les « Métamorphoses d’Ovide », et d’autres écrits semblables dans le monde moderne. (Quoi de neuf, là ??) Cet idéal pauvre nous mine, et nous prive de notre capacité de rêver, de désirer de manière vivante, et non pas… robotique.
M. Pavie a pourtant le mérite d’avancer non masqué, et ce qu’il dit me permet d’identifier… mon ennemi, et sa pensée. Il revendique, et veut m’imposer une nouvelle forme de transcendance, dont il serait.. le prêtre qui ne veut pas se reconnaître comme tel, d’ailleurs. (Quoi de neuf ? c’en est même lassant, d’ailleurs. Et na ! pour ceux qui font l’apologie de l’immanence à longueur de journée…et se félicitent de l’avoir embrassé après avoir chassé la transcendance, POUR SE LIBERER.)
Son église n’est pas la mienne, et son projet de transcendance ne m’est pas recevable. Je résiste avec tout mon être à la tentative de me l’imposer et je sais que je ne suis pas seule. Je ne sais pas si M. Pavie a la culture de reconnaître comment son.. idole… s’appuie sur/contre notre héritage religieux (qui incorpore bel et bien des éléments de l’Antiquité greco-romaine…Lire Ivan Illich, surtout le livre de conversations avec David Cayley, « La corruption du meilleur engendre le pire », Actes Sud).
Pour le problème de l’innovation, je me réfère… oui, oui, aux « Bacchantes » d’Euripides, et au chapitre sur la famille des Labdacides (Cadmos, Oedipe et compagnie) dans « Les Métamorphoses » pour une exposition du problème très loin de la platitude de M. Pavie. Pour que nous puissions voir que le problème a une très longue histoire, et ne remonte pas à… 40 ans et quelques. (Plus ça change, plus c’est la même chose. Une piqûre de rappel pour l’humilité.) Et que nos vies ne sont pas réductibles à ce que nous VOULONS qu’elles soient de manière consciente.
A y regarder de près, je vois dans cet écrit une démonstration, à l’insu de celui qui l’a « écrit », du pouvoir d’une langue sans sujet, et peut-être sans objet, qui a le projet de parler sans s’appuyer sur le corps ? de celui qui « parle ». Je vois dans cet écrit le résultat de ce qui arrive quand le fait de prendre l’Homme comme objet d’un discours scientifique objectivant soit érigé en vérité d’ordre transcendant et religieux. Cela m’effraie.
Cela ne me rend pas très optimiste pour la « transcendance » qui se profile sur cette base. Pas du tout, même.
Credo… que nous sommes constitués dans et par les mots qui nous traversent, et.. il vaut mieux pour nous que ces mots soient… parlants ? rugueux ? avec des aspérités qui choquent, et (nous) heurtent. Certainement.
Credo dans la langue INCARNEE chez un SUJET, et pas un individu. Et là, je constate que la langue du management se situe dans l’anti-incarnation. Oui.
Merci à M. Pavie de m’avoir fait prendre enfin conscience de cela.
par Debra - le 15 janvier, 2019
Je suis très sceptique quant à cet article, qui ne me paraît pas très rigoureux. Xavier Pavie parle de transcendance mais réfute ensuite les conséquences même de cette transcendance, qui est d’ailleurs plutôt une autotranscendance (puisque cette extériorité est le fruit des actions individuelles des hommes). Autrement dit, ce que manque cet article, c’est la dimension systémique de l’innovation qui, pourtant, a très bien été mise en valeur dès les années 1970 par la littérature du management que… Xavier Pavie semble mettre au placard. Dans un cadre systémique, ce n’est pas un acteur (les innovateurs) qui peut arrêter un processus.
Grosse erreur théorique sur le principe de précaution opposé au principe de responsabilité. Je suis quand même très étonné d’une telle bourde dans un livre publié aux PUF… Le principe de précaution ne porte pas sur ce que l’on sait être dangereux. Ça, c’est le principe de prévention qui est assez évident. Quand on sait que c’est mal, autant l’arrêter. Autrement dit, dans le cas de l’amiante, le principe de prévention dit : dès qu’on a su que c’était mauvais, on a arrêté de l’employer. Le principe de précaution est différent : il présuppose que l’on ne sait pas ! Ceci consiste donc à dire : nous ne savons pas à l’heure actuelle si l’amiante est bon ou mauvais, mais nous arrêtons de l’employer quand même.
C’est précisément dans le champ du « nous ne savons pas encore » qu’il y a un dilemme moral face à la technologie. Hors, depuis le début des temps, l’homme n’a jamais été capable d’arrêter un « progrès » (avec plein de guillemets). Ceci est plus visible aujourd’hui parce que ce « progrès » est exponentiel.
Si je résume :
* Nous avons affaire à une autotranscendance, qui nécessite d’avoir une analyse systémique de la chose. Une analyse individualiste sur les surhommes est un enfantillages assez grossier ;
* La question n’est pas « que faire quand l’on sait », mais « que faire alors que l’on ne sait pas tout » (notamment les enchaînements causaux qui sont de plus en plus complexes avec le progrès technologique qui se fonde sur une interconnexion croissante des différents éléments de base entre eux, ce qui est précisément la définition d’un système) ;
* Vous vous réjouissez de la fin des églises. Soit ! Mais la question est pourtant « quelle forme donner à l’organisme capable d’exercer un jugement moral sur le progrès technique » et ce même si on laisse Dieu tranquille.
par Mme Michû - le 15 janvier, 2019
Que le progrès technique puisse s’avérer un mal , nous le savons depuis un siècle. Très précisément depuis la Première guerre mondiale, lorsque les progrès de l’artillerie ont fait littéralement de l’homme de la chair à canon et permis les massacres de masse. Puis les révolutions marxistes, avec leurs Etats policiers et leurs dizaines de millions de morts nous ont fait découvrir cet étrange renversement de la morale : la pureté des intentions justifiait l’emploi de tous les moyens. Il s’agissait de » créer un homme nouveau « , de faire advenir » des lendemains qui chantent « , de » changer la vie « , on n’allait pas mégoter ! Au 21ème siècle , même logique mais plus soft . Ainsi plusieurs Etats ont-ils légalisé la GPA, la technique des mères porteuses , en invoquant un objectif vertueux : permettre l’accès à la filiation à ceux que le nature en a privés. Elle constitue pourtant un double scandale , comme la France le reconnaît – pour l’instant encore : il y a marchandisation du corps de la femme ; et l’on tranche le lien qui l’a uni à l’enfant à naître pendant neuf mois, sans souci des conséquences pour l’une et l’autre. Alors j’avoue éprouver un réflexe pavlovien de méfiance quand j’entends invoquer le mot » progressisme » : qu’est-ce que le camp du Bien va encore essayer de nous fourguer ?
par Philippe Le Corroller - le 16 janvier, 2019
Laissez un commentaire