La GPA : éléments philosophiques
Parmi tous les droits subjectifs qui ont envahi notre paysage juridique depuis un demi-siècle, parmi ces innombrables « droits à … » qui ont submergé les anciens « droits de », est apparu le « droit à l’enfant ».
Je ne peux m’empêcher de penser, quand on parle de « droit à l’enfant », de me souvenir des premiers plans du fameux film des Monty Python, La vie de Brian, véritable petit bijou sur la question de la religion et des croyances en général. La scène se passe dans une arène romaine, en Galilée, à l’époque de la naissance du Christ. Quatre hommes sont plongés dans un interminable débat. La question est, entre autres, de savoir si l’un des protagonistes a raison d’affirmer qu’il a « le droit de porter un enfant dans son ventre ». Après de fougueux échanges, le groupe conclut unanimement : « Oui, il a le droit ».
Tout est dit, ou presque, sur un mode ironique. Le « droit à l’enfant », comme quasiment tous les « droits à … », apparaît, dans la majorité des occurrences, comme un quasi non-sens. Ai-je le droit de m’élever dans les airs en agissant frénétiquement mes deux bras ? Rien ne m’en empêche, en effet. Mais une telle interrogation aurait, vous me l’accorderez, davantage sa place dans un sketch de Raymond Devos que dans un débat philosophique.
Ce qui existe en réalité, partout et toujours, dans toutes les sociétés, c’est un processus en deux temps :
1° une possibilité offerte aux humains, une capacité de faire ou de posséder quelque chose.
2° une organisation sociale et juridique (mais aussi économique dans les sociétés modernes) de la mise en œuvre de cette capacité.
Un couple homosexuel a-t-il « droit à un enfant » ? La question ne se poserait pas si la capacité d’avoir un enfant engendré en dehors de l’utérus maternel n’existait pas. C’est cette capacité qui seule fait surgir le débat et lui donne sens. Cette capacité a été conçue et organisée dans un pays tel que l’Inde depuis fort longtemps. Une épouse stérile a recours au ventre de sa sœur pour avoir un enfant (ce qui implique un rapport sexuel entre son mari et sa sœur qui, dans d’autres civilisations, ne serait pas sans poser problème …).
Chez nous, une telle capacité existe depuis que les biotechnologies sont venues au secours de la procréation naturelle : la fécondation in vitro, les dons de sperme et les banques qui les recueillent, les dons d’ovules, ont ouvert cette possibilité, techniques auxquelles est venue s’ajouter la possibilité d’avoir recours à une mère-porteuse.
Ce qu’il est à présent convenu d’appeler « maternité par substitution » présente deux modalités principales : 1) le recours à une mère de substitution génétique, lorsque la future mère-porteuse est inséminée avec le sperme du père, ou 2) la maternité de substitution non génétique, lorsque la mère-porteuse reçoit un embryon obtenu par FIV à partir des gamètes du couple. D’autres figures peuvent exister, mais ces cas sont beaucoup plus rares, si la mère porteuse reçoit un embryon fécondé in vitro avec un ovule de la mère et du sperme issu d’un donneur étranger au couple, ou inversement un embryon fécondé in vitro avec du sperme du père et un ovule prélevé sur une femme étrangère au couple. Dans tous les cas, un « contrat de maternité » est conclu, le plus souvent par l’entremise d’un avocat.
n
La GPA à la lumière de l’histoire du vivant.
La vie a utilisé la reproduction par division cellulaire longtemps avant d’avoir inventé la reproduction sexuée. On peut ici faire référence au beau livre du professeur Jacques Ruffié, Le sexe et la mort (1975), qui raconte merveilleusement cette découverte et ses conséquences sur l’organisation de la vie sur la planète.
Depuis cette invention, la règle est l’hétérosexualité, la reproduction par le biais d’une relation sexuelle entre deux individus de sexe opposé, seule possibilité de reproduction pour des vivants fonctionnant sur le mode de la reproduction sexuée. Dans notre époque chaotique, on tend sans cesse à confondre la règle et l’exception, et l’on est généralement frileux sur le rappel de la règle, croyant, par confusion idéologique, que rappeler la règle serait « discriminatoire ». Ainsi que je le disais chaque année à mes étudiants (mais peut-être ai-je alors pris de gros risques sans le savoir …), tous les humains depuis des millions d’années sont nés d’une relation hétérosexuelle, y compris tous les homosexuels qui ont vu le jour. Il ne peut qu’y avoir dissymétrie, qu’on le veuille ou non, que cela plaise ou non, entre les deux formes de sexualité. Nous sommes, tous, homosexuels ou hétérosexuels, nés d’une relation hétérosexuelle.
Il est vrai que depuis peu les biotechnologies viennent bouleverser cette logique, qu’elles mettent en place une symétrie qui n’a jamais existé entre les deux formes de sexualité, puisqu’un couple homosexuel peut décider d’avoir un enfant en ayant recours à une mère-porteuse, s’il s’agit d’homosexuels de sexe masculin, ou à un don de sperme s’il s’agit d’homosexuelles de sexe féminin.
La reproduction sexuée a assuré pendant des millions d’années un brassage génétique exceptionnel. Contrairement à la reproduction par simple division, avec la sexualité, pour perpétuer l’espèce, il faut être deux, et deux de sexes différents. « Il y a deux sexes », dirait la grande Antoinette Fouque (on aura reconnu le titre du livre de cette grande dame, récemment disparue, paru chez Gallimard en 1995). Qu’il y ait deux sexes, et qu’ils soient co-nécessaires au maintien de l’espèce, c’est ce dont la reproduction sexuée apportait sans cesse la preuve, c’est ce que les biotechnologies viennent remettre en question. Reconnaissons sur ce premier point que la maternité de substitution ne crée pas de difficultés spécifiques, elle vient seulement prendre place dans le vaste dispositif qui remet insensiblement en question la reproduction sexuée.
n
La GPA à la lumière de la biologie humaine
Qu’est-il apparu de nouveau avec l’être humain sur le plan de la reproduction sexuée ? Comme dans tous les autres domaines, l’apparition de la conscience a bouleversé de fond en comble ce qui n’existait chez les autres vivants que dans la spontanéité de l’instinct.
On ne retiendra ici que quatre éléments particulièrement déterminants, même si la liste des modifications engendrées par l’existence de la conscience est infiniment plus étendue.
- Une organisation sociale de la reproduction, avec des « structures de la parenté » extraordinairement diversifiées, mais qui semblent toutes répondre au même objectif, ainsi que l’ont montré les anthropologues tels que Claude Lévi-Strauss. Cet objectif étant d’assurer à la fois la diversité de l’ethnie et la stabilité du groupe à travers la succession des générations.
- Un lien profond et mystérieux entre procréation et affectivité. Tout ce que les différentes civilisations ont appelé « amour » s’enracine dans la dualité des sexes et dans l’union nécessaire des deux sexes à la perpétuation de l’espèce.
- Une rupture avec les pratiques eugénistes spontanés des autres êtres vivants, même si cette rupture ne s’est pas faite en un jour. L’avantage accordé aux mâles dominants, les luttes entre mâles en vue de s’approprier les femelles, ont disparu peu à peu (en tout cas pour l’essentiel) du paysage humain, laissant d’autres modes de relation entre les deux sexes prendre le relais (structures matrimoniales artificielles dans les sociétés archaïques, hiérarchies sociales imposant des obligations sexuelles dans les sociétés médiévales, attrait réciproque et techniques de séduction dans les sociétés modernes). Dans ces modes de relation, l’eugénisme a sinon disparu, du moins a cessé d’être le moteur des pratiques humaines.
- La présence conjointe des deux pôles, masculin et féminin, autour de l’enfant, par-delà la procréation elle-même, dans la protection et dans l’éducation de l’enfant. Nous parlons bien de « pôles », ainsi que l’a compris la psychanalyse, ces deux pôles étant le plus généralement assuré par des parents de sexes opposés, mais pouvant aussi être incarnés par des éducateurs de même sexe (tante ou grand-mère assurant la fonction père après le décès du père biologique, par exemple).
Ce qui est en jeu avec les biotechnologies, et en l’occurrence avec les maternités de substitution, c’est donc infiniment plus qu’une simple aide technologique à la procréation, comme on tente de nous le faire croire trop souvent.
Reprenons rapidement les quatre éléments que nous avons (un peu artificiellement pour les besoins de l’exposé) isolés.
- Sur le plan de l’organisation sociale : aussi diverses qu’elles aient pu être, les organisations inventées par les cultures ont ceci en commun que jamais dans notre histoire la venue au monde d’un enfant n’a été l’affaire d’un seul individu. C’est donc à une individualisation de la part la plus spécifique (au sens biologique du terme), c’est-à-dire de la part la moins individuelle, de nos existences, à laquelle nous assistons. Les conséquences ne pourront en être que considérables, même si nul aujourd’hui ne saurait les prévoir.
- Pour ce qui est du lien entre procréation et affectivité, sauf à mépriser notre partie affective (comme l’ont souvent fait les philosophes, nous devons le reconnaître), il nous faut admettre que nous nous construisons autant par l’affectivité que par l’intelligence. L’opposition un peu naïve entre émotion et intelligence ne cesse d’être remise en cause. On n’hésite plus aujourd’hui à parler d’ « intelligence émotionnelle » (Cf. le livre souvent cité de Daniel Goleman, qui porte précisément ce titre, édité chez « J’ai Lu »). Recourir à un utérus féminin comme à un simple outil de procréation, rompre le lien affectif (rupture incontournable dès qu’il s‘agit de GPA) entre l’enfant et celle qui le porte, ne peut qu’avoir des conséquences considérables sur le devenir de l’enfant.
- Quant à la question de l’eugénisme, reconnaissons qu’il règne une très grande hypocrisie sur le sujet. Nous avons déjà franchi allègrement le pas de l’eugénisme dit « négatif », c’est-à-dire celui qui procède par élimination des êtres supposés déficients, celui qui fonctionne par « tri » (diagnostic préimplantatoire, tests amniotiques, échographies, etc.). Avec les biotechnologies actuelles, c’est l’eugénisme dit « positif », c’est-à-dire celui qui choisit de procréer des êtres supposés supérieurs, qui peut refaire surface, retour grimaçant des Lebensborn nazis de triste mémoire.
- Enfin, pour ce qui est de la dualité masculin-féminin, devons-nous suivre les leçons de la psychanalyse ? Pas nécessairement. Mais on doit cependant rappeler qu’en rompant avec la reproduction hétérosexuelle, on rompt avec une immense temporalité dont nous sommes tous issus. Les réussites des couples homosexuels, l’apparent épanouissement des enfants éduqués au sein de couples homosexuels masculins ou féminins, ne sont pas un argument suffisant, loin s’en faut. Car ces couples maintiennent souvent, d’une manière ou d’une autre, la dualité des fonctions masculine et féminine en face de l’enfant. Le véritable danger, qui n’est pas spécifique à la maternité par substitution, est bien la possibilité qu’un enfant vienne au monde qui soit l’enfant d’un seul individu.
n
Réflexions psychologiques sur l’identité
L’enfant humain est une « personne ». Le philosophe Kant l’a formulé une fois pour toutes : « Les choses ont un prix, la personne a une dignité ».
Mais qu’est-ce qui donne une dignité à la personne humaine ? Fondamentalement son autonomie, son indépendance à l’égard de tous les autres membres de l’espèce. Cette autonomie, cette liberté, fait de la personne une « fin en soi », et lui accorde une « valeur infinie ». Sans cette valeur « infinie », elle n’aurait, cela va de soi mais cela va encore mieux en le disant, qu’une valeur « relative », elle aurait un prix, et que ce prix soit éventuellement extrêmement élevé ne change rien à l’affaire.
Or l’indépendance qui assure sa dignité à la personne est garantie par la reproduction hétérosexuelle, garantie par le couple dont la relation amoureuse est à l’origine de l’enfant. Jean-Paul Thomas, dans un livre déjà ancien, Misère de la bioéthique (Albin Michel, 1990), a formulé à ce propos des arguments décisifs et probablement définitifs. Que son livre date de 1990 ne doit pas nous troubler : sur ces questions de bioéthique, c’est-à-dire de philosophie, le temps importe peu, les idées n’avancent pas au rythme des hit-parades, mais, comme le dit magnifiquement Nietzsche, elles arrivent « silencieuses comme un vol de colombes ».
Il nous faut donc citer à ce moment de notre réflexion les belles formules de Jean-Paul Thomas ; après avoir rappelé comment le désir d’enfant peut être narcissique, peut s’enraciner dans la volonté de conjurer sa propre finitude, allant parfois jusqu’au désir de vivre par procuration à travers ces reflets de nous-mêmes que sont nos enfants, Pascal Thomas ajoute :
« L’autre logique, qui heureusement interfère avec la première, est donc celle de l’altérité. Cet enfant qui ne m’est pas radicalement étranger, radicalement autre, qui peut me ressembler au point d’être un autre moi-même, n’est pas moi-même. Et s’il ne peut l’être, c’est d’abord parce qu’il est aussi l’enfant d’un autre, avec lequel je l’ai « fait » (op. cit. p. 178).
Et à la page suivante, on trouve ces mots superbes :
« Il y a continuité, en effet, éventuellement, entre l’acceptation du désir qui s’élève en moi sans être voulu par moi, et la découverte de l’autre dans sa corporéité irréductible à la mienne, ayant ses rythmes et ses désirs propres, et entre cette reconnaissance de l’autre et le développement d’un embryon puis la naissance d’un autre être humain » (p. 179).
C’est donc à un véritable parcours de la reconnaissance de l’altérité que se livre ici Jean-Paul Thomas, reliant conscience individuelle de l’énigme du désir, sexualité humaine comme acceptation du désir de l’autre, et venue au monde d’un être qui n’est mon enfant que parce qu’il est aussi l’enfant d’un autre. Y a-t-il d’autres chemins possibles pour que se mette en place cette reconnaissance de l’altérité sans laquelle nous cesserions d’être humains ? Ce n’est pas impossible, mais ce n’est pas du tout certain. En tout cas ces autres chemins relèvent aujourd’hui de la pure spéculation.
Avec la GPA, l’enfant devient l’objet d’une « commande », son rapport avec ses futurs parents, voire avec le parent unique qui l’aura « commandé », en sera bouleversé. Et puisque nous avons mis au premier plan la notion de dignité, quid de la dignité d’une femme réduite à l’état d’instrument de procréation au service d’autrui, et quid de la dignité de l’enfant ainsi « commandé » ?
n
Biotechnologies et principe de précaution
Nous vivons un étonnant paradoxe. Effrayés que nous sommes par les conséquences visibles des technologies sur notre environnement, nous intégrons assez rapidement l’idée d’un « principe de précaution » à appliquer systématiquement. Or notre environnement, j’entends par là celui qui a rendu possible l’apparition et la durée (très relative) de l’espèce humaine sur la planète, n’est vieux que de quelques millions d’années. Ainsi, par exemple, les soi-disant « monstres » du Tertiaire (qui n’étaient en rien « monstrueux ») ont longtemps vécu dans un environnement qui leur était favorable mais qui interdisait au contraire aux mammifères dont nous sommes issus de se développer. Or la reproduction sexuée, elle, a commencé avec les plantes il y a des milliards d’années. C’est donc l’une des plus anciennes structures de la vie terrestre qu’on s’apprête à bouleverser. En ce domaine plus qu’en tout autre, devrait s’imposer un principe de précaution. En ce domaine plus qu’en tout autre, nous devrions prendre acte de l’immensité de nos ignorances, de notre méconnaissance totale des conséquences qui résulteront des bouleversements que nous introduisons dans des équilibres archi-millénaires. Reconnaissez avec moi que ce n’est pas du tout ce que nous faisons.
N
Éléments bibliographiques
Claire Crignon-de-Oliveira, Marie Gaille-Nikodimov, A qui appartient le corps humain?, Les Belles Lettres, 2004.
François Dagognet, La maîtrise du vivant, Hachette, 1988.
Philippe Granarolo, « Surhomme ou homme parfait ? », Discours de réception à l’Académie du Var prononcé à Toulon le mercredi 12 mars 2003, in Bulletin de l’Académie du Var, année 2003.
Philippe Granarolo, « Création, Procréation, Autocréation », iPhilo.
Philippe Granarolo, « Éléments nietzschéens pour une critique des biotechnologies« , in Génétique, biomédecine et société, sous la direction de Philippe Pedrot, Presses Universitaires de Grenoble, 2005.
Philippe Granarolo, « Les prophéties de Nietzsche jugées par le XXe siècle », Revue Héritages, 2008, volume n° 10.
Jürgen Habermas, L’avenir de la nature humaine. Vers un eugénisme libéral ?, Gallimard, 2003.
Dominique Mehl, Naître ? La controverse bioéthique, Bayard Editions, 1999.
Jean-Paul THOMAS, Misère de la bioéthique, Albin Michel, 1990.
Docteur d'Etat ès Lettres et agrégé en philosophie, Philippe Granarolo est professeur honoraire de Khâgne au lycée Dumont d'Urville de Toulon et membre de l'Académie du Var. Spécialiste de Nietzsche, il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment Nietzsche : cinq scénarios pour le futur (Les Belles Lettres, 2014) . Nous vous conseillons son site internet : http://www.granarolo.fr/. Suivre surTwitter : @PGranarolo
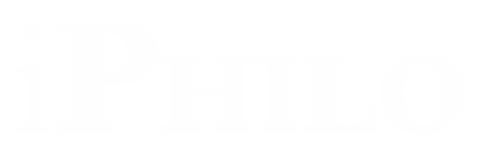

Commentaires
Bonjour,
Le surhumain de Nietzsche sera supplanté par le transhumanisme.
Il conviendrait dores et déjà d’en prendre acte et de réfléchir comment nous pourrions définir une éthique phénoménologique, pour faire entrer dans les »mœurs »le post Darwinisme : » l’être humain augmenté « ! (NBIC)
Des bouleversements extraordinaires vont secouer la planète humanité. Une nouvelle ère de la philosophie se doit d’accompagner le mouvement.
par philo'ofser - le 12 novembre, 2014
La GPA , qu’elle bénéficie à des couples hétérosexuels ou gays , constitue un double scandale et l’on ne peut que louer le droit français de l’avoir interdite :
1) On arrache l’enfant à sa mère biologique , qui l’a porté pendant neuf mois . On l’arrache à sa chaleur , à son odeur , à sa voix , à son sein . Comment ne pas sentir que trancher ainsi le lien qui les unit charnellement et au niveau de l’inconscient constitue un traumatisme ? Depuis Freud et consorts, qui de nous s’aventurerait à nier le poids de l’inconscient dans nos vies ?
2) Réduire la femme à un utérus que l’on loue , pourvu qu’on ait du fric , est-ce autre chose qu’un avatar « moderne » de l’esclavagisme ?
La PMA , en revanche, qu’elle bénéficie à un couple hétérosexuel ou de lesbiennes , échappe à ces deux scandales : le lien mère-enfant est préservé ; et il n’y a pas marchandisation du corps de la femme . D’évidence , le mal est moindre . Mais , bien sûr , confirmer cette différence de traitement entre GPA et PMA , c’est créer une inégalité entre homosexuels , l’adoption restant le seul recours des couples gays . Surtout , qu’il s’agisse de la GPA ou de la PMA , peut-on ignorer la question posée l’an dernier par les millions de Français descendus dans la rue lors des Manifs pour tous : ne joue-t-on pas aux apprentis-sorciers en créant , pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, une nouvelle catégorie d’enfants : ceux délibérément privés du couple père-mère ?
par Philippe Le Corroller - le 13 novembre, 2014
[…] Philippe Granarolo revient sur iPhilo sur les implications philosophiques de la GPA. Qu'y-a-t-il donc derrière cette question de société qui montre autant le progrès de la science que le doute face au souci bioéthique ? […]
par La GPA : éléments philosophiques ... - le 14 novembre, 2014
Bonjour
Si je m’interroge sur la réalité de la prééminence anthropologique de la famille et du llien « mystérieux » (SIC) entre procréation et affectivité, je partage votre souci de l’enfant « objet de commande ». Ne pourriez-vous cependant rattacher cette question à la finalité de l’organisation sociale, ou à l’organisation sociale comme finalité ? La conception utilitariste de l’organisation sociale que vous affichez dans l’une de vos prémisses vous en empêche sans doute, ce qui affaiblit à mon sens considérablement votre rappel à la Loi ; une Loi et une organisation sociale qui nous manquent cruellement pour nous réveiller de toutes nos entreprises d’objectivatiion.
par Olivier - le 15 novembre, 2014
l’ argumentaire me laisse pantois. Qu’ en est il d’une toute simple adoption ? Les liens avec la mère porteuse sont bel et bien coupés, et la filiation n’est alors plus que symbolique. Et pourtant ça marche depuis la nuit des temps sans conséquences importantes pour les adoptés… Sinon ce serait interdit depuis longtemps…
par Ledoux Philippe - le 17 novembre, 2014
Etes-vous sûr que « depuis la nuit des temps » l’adoption soit pratiquée par des couples homosexuels ?
par Philippe Le Corroller - le 17 novembre, 2014
C’est vraisemblable, la question n’est pas nouvelle, et l’adoption était fréquente chez les Romains . César pourtant pédophile avait bien adopté Brutus.. Mal lui en prit au final…
par Ledoux Philippe - le 17 novembre, 2014
Bizarre, pas une ligne sur les pays où PMA et GPA se pratiquent depuis longtemps … Je préfère sur un tel sujet les articles informatifs aux articles spéculatifs.
par Fabrice Mercier - le 17 novembre, 2014
Je ne suis pas sûr que citer l’exemple d’un pédophile pour appuyer votre thèse soit vraiment opportun .
par Philippe Le Corroller - le 18 novembre, 2014
Bonjour,
Il paraît établi dans l’inconscient collectif,que le paradigme qui incarne le désir d’enfant est un plaisir égoïste. (consumérisme affectif)
Nous faisons des enfants pour soi ; moins la femme qui porte sur ses épaules la reproductibilité de l’espèce, qui se fait un devoir de procréation.
Qu’en sera t’il autrement, du genre femme homme, demain ?
Comment encore, aujourd’hui, laisser, par millions, des enfants orphelins, en proie à la faim, à la mal nutrition, à la maladie, à la mort ? Tout le monde, ou presque, vous dira aimer les enfants ! Aimer les siens en « propriétaires » ne suffirait pas.
Aimer un enfant, c’est peut-être, faire preuve d’abnégation, de désintéressement de ses sentiments personnels, faire une magnifique preuve d’humanité, pour donner le meilleur de ce que nous sommes capables, à cet enfant, quelque soit son origine, sa couleur, pour qu’il devienne, comme les autre : un être humain aimé.
L’origine de cet enfant est naturellement humaine!
Cela serait d’une actualité indéniablement inoubliable !
Tel l’amour porté à d’autres espèces animales. (chat, chien, etc…. )
par philo'ofser - le 4 décembre, 2014
[…] aussi : La GPA : éléments philosophiques (Philippe […]
par iPhilo » PMA pour toutes : une avancée, mais vers où ? - le 25 novembre, 2019
[…] aussi : La GPA : éléments philosophiques (Philippe […]
par iPhilo » L’I.V.G. : Droit naturel ou enjeu démocratique ? - le 1 juillet, 2022
[…] à différents domaines, qui impliquent la loi et la morale publique. Voici des exemples: la GPA (elle est possible?), l’écologie, les droits humains, la […]
par Éthique(s) - le 12 avril, 2023
Laissez un commentaire