La psychanalyse peut-elle faire plaisir ?
ANALYSE : Quoi de neuf en psychanalyse, cette discipline moins à la mode qu’il y a quelques décennies ? A la lecture de quatre ouvrages récents parus chez Gallimard, le philosophe Michel Juffé de se poser une question : comment la psychanalyse peut-elle étayer la raison au lieu de l’obscurcir ? Peut-être est-ce une question de dosage entre le «principe de plaisir» et le «principe de réalité», argue-t-il.
 Né en 1945, Michel Juffé est un philosophe français, intéressé aux questions d’éthique, de philosophie politique et d’écologie. Il fut conseiller au sein du Conseil général de l’écologie et du développement durable (2003-2010) et a enseigné dans plusieurs grandes écoles et universités. Auteur d’une douzaine d’ouvrages, il a récemment publié Sigmund Freud – Benedictus de Spinoza, Correspondance, 1676-1938 (Gallimard, 2016), Café-Spinoza (Le Bord de l’eau, 2017), Liberté, égalité, fraternité… intégrité (L’Harmattan, 2018) et A la recherche d’une humanité durable (L’Harmattan, 2018).
Né en 1945, Michel Juffé est un philosophe français, intéressé aux questions d’éthique, de philosophie politique et d’écologie. Il fut conseiller au sein du Conseil général de l’écologie et du développement durable (2003-2010) et a enseigné dans plusieurs grandes écoles et universités. Auteur d’une douzaine d’ouvrages, il a récemment publié Sigmund Freud – Benedictus de Spinoza, Correspondance, 1676-1938 (Gallimard, 2016), Café-Spinoza (Le Bord de l’eau, 2017), Liberté, égalité, fraternité… intégrité (L’Harmattan, 2018) et A la recherche d’une humanité durable (L’Harmattan, 2018).
La psychanalyse, de nos jours, n’est plus la panacée que certains crurent dans les années 1950 aux États-Unis et 1960-1970 en France. Entre les clichés faciles («le train dans le tunnel») et les propos ésotériques («il y a un mathème de la psychanalyse»), elle a continué son chemin clinique et littéraire, parfois anthropologique… à la suite de Freud ou en s’écartant résolument de lui.
Lire aussi : Neurologie, psychanalyse et philosophie : un triangle non-oedipien ? (Michel Juffé)
C’est le pari tenté par Michel Gribinski avec une série «Le principe de plaisir» qu’il a créé en 2015 dans la réputée collection Connaissance de l’inconscient chez Gallimard. Cette série a maintenant quatre ans, et j’ai rendu compte de deux de ses ouvrages Contes de faits par Antonio Alberto Semi (2016) et Naissances inconscientes du droit par Catherine Rodière-Rein (2017) dans la Nouvelle Quinzaine Littéraire (16 juillet 2016, 16 mars 2018). Au lieu de continuer ces recensions, il me prend l’envie, aujourd’hui, de me promener parmi quelques-uns de ces livres, notamment les derniers parus.
Freud, romancier et analyste
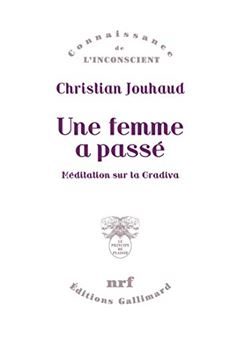 Je commence par celui de Christian Jouhaud, Une femme a passé, Méditation sur la Gradiva, paru le 17 janvier 2019. Ce qui l’intéresse, lui historien, dans le livre de Freud, est «le lieu d’une interaction entre le geste théorique qui capte et les scènes que le romancier fait jouer à ses personnages». Il tente d’en «griffonner le roman historique». En effet, Freud est à la fois romancier (il raconte l’histoire d’une fiction historique) et analyste (il cherche à illustrer divers aspects du refoulement avec les métaphores archéologiques qu’il chérit). L’auteur ne peut pas ignorer que le dernier livre publié par Freud (son Moïse) porta d’abord le titre de L’homme Moïse, un roman historique. Un livre où, loin de la Gradiva, il ne laisse aucune place à l’archéologie, pour confronter plusieurs récits.
Je commence par celui de Christian Jouhaud, Une femme a passé, Méditation sur la Gradiva, paru le 17 janvier 2019. Ce qui l’intéresse, lui historien, dans le livre de Freud, est «le lieu d’une interaction entre le geste théorique qui capte et les scènes que le romancier fait jouer à ses personnages». Il tente d’en «griffonner le roman historique». En effet, Freud est à la fois romancier (il raconte l’histoire d’une fiction historique) et analyste (il cherche à illustrer divers aspects du refoulement avec les métaphores archéologiques qu’il chérit). L’auteur ne peut pas ignorer que le dernier livre publié par Freud (son Moïse) porta d’abord le titre de L’homme Moïse, un roman historique. Un livre où, loin de la Gradiva, il ne laisse aucune place à l’archéologie, pour confronter plusieurs récits.
Le délire et les rêves dans la Gradiva de W. Jensen est paru en 1907 dans une série explicitement destinée à «étendre le champ d’application et par là l’audience de la psychanalyse» (comme le remarque J.B. Pontalis dans sa préface à l’édition de 1986, chez Gallimard), série nommée : «Schriften Zur AngewandtenSeelenkunde» (Écrits sur la science de l’âme appliquée). Christian Jouhaud s’adresse à Freud, bien sûr, mais aussi directement à Jensen, dont il commente trois autres livres, ainsi qu’à Anatole France (Le crime de Sylvestre Bonnard), à Michel de Certeau (La Possession de Loudun), Théophile Gauthier (Arria Marcella. Souvenir de Pompéi). Ces récits se croisent, s’emmêlent, parfois de manière un peu déroutante pour le lecteur ignorant (de ces textes) que je suis.
Lire aussi : Pour Darwin et au-delà (Georges Chapouthier)
 Je vais me concentrer sur le chapitre qui me parle le plus, «Possessions», où Freud apparaît, cette fois, comme auteur de Une névrose démoniaque au XVIIe siècle (1923). La question, dit l’auteur, est : qui possède qui ? Et peut-on même parler d’un possesseur (diabolique ou non : un hypnotiseur par exemple ou une mère possessive) ou seulement de processus de possession (alors sans auteur) ? On peut poser ces questions autrement : qu’est-ce que la hantise ? Il est clair, explicite l’auteur, qu’il est toujours question d’un passé qui s’impose au présent, de morts qui saisissent les vivants, d’une impossibilité (c’est la mélancolie) d’accepter une perte (dite «irrémédiable»), ou – comme dans la Gradiva et autres récits – un rêve de retour au passé perdu, et précisément à l’enfance perdue dont on ne parvient pas à faire le deuil, et qu’on ressuscite… par des romans.
Je vais me concentrer sur le chapitre qui me parle le plus, «Possessions», où Freud apparaît, cette fois, comme auteur de Une névrose démoniaque au XVIIe siècle (1923). La question, dit l’auteur, est : qui possède qui ? Et peut-on même parler d’un possesseur (diabolique ou non : un hypnotiseur par exemple ou une mère possessive) ou seulement de processus de possession (alors sans auteur) ? On peut poser ces questions autrement : qu’est-ce que la hantise ? Il est clair, explicite l’auteur, qu’il est toujours question d’un passé qui s’impose au présent, de morts qui saisissent les vivants, d’une impossibilité (c’est la mélancolie) d’accepter une perte (dite «irrémédiable»), ou – comme dans la Gradiva et autres récits – un rêve de retour au passé perdu, et précisément à l’enfance perdue dont on ne parvient pas à faire le deuil, et qu’on ressuscite… par des romans.
Ceci est alors rapporté au refoulement et au conflit psychique, où les forces refoulantes (jamais bien claires chez Freud, soit dit en passant) sont aussi, si on les identifie grâce à l’analyse, celles qui permettent le «retour du refoulé» sous forme pathologique (symptômes) ou curative (paroles, récits). Avec le rôle délicat du transfert qui «livre le patient à son exorciste ou son analyste, mais ce transfert est à la fois la conséquence et la cause d’un élan de possessivité». «Tout le monde sait cela», ajoute Jouhaud.
Lire aussi : Conscience, liberté et mécanismes cérébraux (Jean-Michel Muglioni)
Je n’en suis pas si sûr, car à mes yeux, il existe trois sortes de possessions : la hantise (passé «possédant» le présent – du point de vue du présent) ; l’emprise au présent de quelqu’un sur un, plusieurs ou beaucoup d’autres (fascination, séduction, terreur) ; la possession– légitime si je puis dire – de quelque chose qui est moi ou à moi : (se) posséder c’est (se) contenir, empêcher que quelque chose se répande, se dissolve, se corrode. Le transfert, s’il réussit, est une déprise de la hantise ou de l’emprise ou plus souvent des deux (car la hantise facilite l’emprise, comme on le voit dans bien des nationalismes) qui s’opère par une prise en charge de soi-même. Que le transfert – dans le récit romancé ou dans la parole analytique – permette de retrouver «le temps de la pulsion heureuse» – est peut-être plus un temps de trouvaille voire de création que de retrouvaille et de réconciliation.
Ceci dit j’ai spécialement apprécié ce que dit l’auteur de la maison gothique, et de «La vengeance de Gradiva», qu’il pourrait peut-être écrire lui-même ?
Rêverie cannibale
 Le livre de Patrick Merot est d’emblée intrigant : Je désosse une amie. Je me suis demandé de quelle amie il parlait pour l’avoir placée en titre. Et je me le demande toujours, car, sans doute par malice, il fait de – ou il cueille – cette expression qui pourrait prêter à de très nombreux sens, une phrase dans la bouche d’une patiente, laquelle ajoute que son amie n’était pas morte mais qu’il fallait nettoyer ses os, pour lui venir en aide. Cette allusion fait partie d’un chapitre intitulé Corps. Celui-ci commence par la pratique cannibalique des Tupinamba (rapportée par Marc Augé) où des prisonniers de guerre vivent dans la tribu, peuvent s’y marier et avoir des enfants, tout en sachant qu’ils seront un jour mangés, sans se révolter. Continue avec Freud qui trouvait normal qu’on aime la chair humaine. Puis avec un article de Salomon Reinach Totems et tabous (1899) où il est question d’anthropophages en Crimée et des voyages de Sindbad le marin. (Ce qui me rappelle que le Monte-Cristo de Dumas, dévoré par sa vengeance, et qui va dévorer ses trois ennemis, se fait appeler Sindbad le marin). Et d’autres références – peintres, sculpteurs, écrivains, auteurs de théâtre, – en très libre association. Impossible à résumer ou à synthétiser. C’est, je crois, une rêverie de l’auteur, par laquelle il est bon de se laisser entraîner, sous peine de s’y perdre. Car il ne cherche rien à démontrer, à prouver, même pas sa filiation à Freud, bien qu’il fasse deux fois allusion dans ces vingt pages.
Le livre de Patrick Merot est d’emblée intrigant : Je désosse une amie. Je me suis demandé de quelle amie il parlait pour l’avoir placée en titre. Et je me le demande toujours, car, sans doute par malice, il fait de – ou il cueille – cette expression qui pourrait prêter à de très nombreux sens, une phrase dans la bouche d’une patiente, laquelle ajoute que son amie n’était pas morte mais qu’il fallait nettoyer ses os, pour lui venir en aide. Cette allusion fait partie d’un chapitre intitulé Corps. Celui-ci commence par la pratique cannibalique des Tupinamba (rapportée par Marc Augé) où des prisonniers de guerre vivent dans la tribu, peuvent s’y marier et avoir des enfants, tout en sachant qu’ils seront un jour mangés, sans se révolter. Continue avec Freud qui trouvait normal qu’on aime la chair humaine. Puis avec un article de Salomon Reinach Totems et tabous (1899) où il est question d’anthropophages en Crimée et des voyages de Sindbad le marin. (Ce qui me rappelle que le Monte-Cristo de Dumas, dévoré par sa vengeance, et qui va dévorer ses trois ennemis, se fait appeler Sindbad le marin). Et d’autres références – peintres, sculpteurs, écrivains, auteurs de théâtre, – en très libre association. Impossible à résumer ou à synthétiser. C’est, je crois, une rêverie de l’auteur, par laquelle il est bon de se laisser entraîner, sous peine de s’y perdre. Car il ne cherche rien à démontrer, à prouver, même pas sa filiation à Freud, bien qu’il fasse deux fois allusion dans ces vingt pages.
Ce livre est composé – s’il est composé – de huit chapitres, chacun associant deux à huit sous-chapitres, soit en tout trente-cinq fragments. Je dis «fragments», car c’est le titre de son premier texte, dans lequel il parle notamment de voyager : «larguer les amarres […] aller de point en point, de lieu en lieu, sans savoir de quoi sera fait le lendemain. […] faire une place à l’étranger». Ce à quoi il s’emploie tout au long de ce livre, rencontrant des thèmes, des personnages et des auteurs disparates. Il suffit de se laisser bercer, au gré de la navigation. Et d’accepter ou non des propositions, dans le chapitre Écriture, telles que :
– La citation est un symptôme mélancolique (Starobinski) ; oui, pas seulement
– «Il faudrait une machine à laver les mots» ; très bonne idée !
– «On peut se rappeler ce que le corps a souffert ou qu’on a eu du plaisir, on ne peut le ressentir de nouveau» ; pas d’accord : cela dépend si ce corps (ancien) a disparu ou non ; quand je regarde une coccinelle voler, j’ai toujours trois ans ; c’est écrit/inscrit dans mon corps.
Lire aussi : Le Père Noël supplicié (Claude Lévi-Strauss)
Et ceci, qui me parle tout de suite : The Cat People (La Féline) de Jacques Tourneur, où le baiser d’un homme déclenche chez elle le déchaînement de forces mystérieuses. Quel pouvoir serait celui d’un homme qui libère chez la femme des forces surhumaines ! L’homme qui fait naître la Femme.
Puis Proust, qui découvre à son tour que les faits n’ont aucun effet sur les croyances (après n’importe quel prêcheur, après les Pères de l’Église, après Spinoza, après Nietzsche). Oui mais : quels faits ? Quelles croyances ?
Et encore Stefan Zweig, qui se vante ainsi auprès de Freud : «Un méchant Dieu m’a donné la capacité de prévoir bien des choses, et ce qui s’abat maintenant» (lettre du 15 novembre 1937). Veut-il parler de Jérémie, publié en 1928 ? Toujours est-il que cette «capacité à prévoir» est bien plus intense chez Joseph Roth, Robert Musil ou Hermann Broch, ses contemporains. Mais Zweig était, dès les années 1920, une célébrité mondiale, n’est-ce pas ?
Et ce troisième paragraphe de la page 136, digne, par sa verve, de Raymond Devos, que je crois voir sur scène en lisant ces 17 lignes. Bref, j’ouvre au hasard une page de Je désosse une amie (j’aime répéter cette formule magique) et je m’amuse, ou m’agace… ou deviens pensif.
Aux côtés des hommes ordinaires
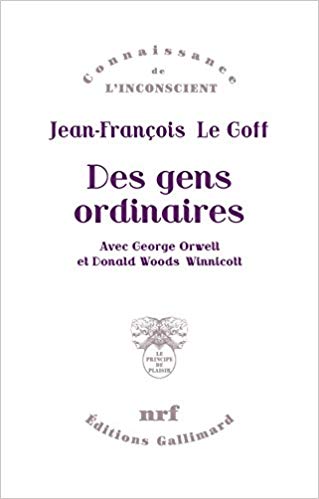 Des gens ordinaires. Avec George Orwell et Donald Woods Winnicott de Jean-François Le Goff, psychiatre de secteur, est autre chose. Je me suis précipité pour le lire, d’un seul trait ou presque, car Orwell et Winnicott sont deux de mes auteurs préférés : délicats, nuancés, pénétrants, espiègles, même si leurs destins n’ont que peu en commun. Communs pourtant leur position d’outsider, de refus de s’incliner devant le conformisme intellectuel et social, de résistance au jargon psychanalytique et à la novlangue politique. Leur rencontre ? Un puzzle interminable.
Des gens ordinaires. Avec George Orwell et Donald Woods Winnicott de Jean-François Le Goff, psychiatre de secteur, est autre chose. Je me suis précipité pour le lire, d’un seul trait ou presque, car Orwell et Winnicott sont deux de mes auteurs préférés : délicats, nuancés, pénétrants, espiègles, même si leurs destins n’ont que peu en commun. Communs pourtant leur position d’outsider, de refus de s’incliner devant le conformisme intellectuel et social, de résistance au jargon psychanalytique et à la novlangue politique. Leur rencontre ? Un puzzle interminable.
Ce livre nous présente ses deux personnages face à la guerre, à la pauvreté affective (ce passage de 1984 où Winston se souvient du temps lointain où l’on avait des vrais sentiments !), leur attention commune aux «gens ordinaires», auxquels ils opposent les intellectuels (qui les méprisent) et les «classes moyennes» (qui les redoutent).
Lire aussi : Jean-Paul Sartre : conscience de soi et conscience d’autrui (Daniel Guillon-Legeay)
Autre thème important : celui du faux self. Pour Winnicott le faux self n’existe que parce qu’il y a aussi, plus ou moins caché et réprimé, un vrai self, une personne authentique (Winnicott hérite ainsi de Ferenczi, via Balint) qui reste en retrait (dans le monde qui est le nôtre). Pour Orwell, c’est un monde sans création, et voué à la banalité répétitive, celui ou on avance et recule sur les mêmes rails (comme il le dit quelque part dans Un peu d’air frais). Pour Winnicott la créativité n’est pas une sublimation ou une réparation : elle est vraiment capacité à créer le monde. Orwell est plus freudien : c’est la solitude qui l’a conduit à vouloir être reconnu. Les deux ont beaucoup écrit, mais Orwell reste ambivalent : écrire l’épuise. Alors que, cela se voit, Winnicott aime écrire et parler en public.
Un passage très amusant, suite à une remarque de Winnicott disant qu’on finirait par le prendre pour Winnie l’Ourson. Lorsque Winnie l’Ourson et son ami Porcinet tournent en rond sur leurs propres traces, Winnie demande à son ami : «Quel jour est-on ? – On est aujourd’hui, répond Porcinet. – C’est mon jour préféré, dit Winnie». Commentaire de Le Goff : «tous les doutes disparaissent : il s’agit bien d’Orwell et de Winnicott».
Ce livre est passionnant de bout en bout, érudit sans être pédant, mettant les deux auteurs en valeur sans pour autant disparaître derrière eux, écrit avec beaucoup de clarté et de fluidité (chose assez rare). La suite qu’il donne à la Julia de 1984 est émouvante. Et le procès féministe intenté à G.O. et D.W.W. cocasse. Quant à la lettre que DDW adresse à GO, elle est prémonitoire : les totalitarismes fabriquent des enfants qui n’auront que haine vis-à-vis de ceux qui n’ont pu prendre soin d’eux. Question (que je me pose) : comment apprendre aux gens – ordinaires ou non – à prendre soin d’eux-mêmes, si on n’a pas pris soin d’eux ?
Le petit garçon sur son plongeoir
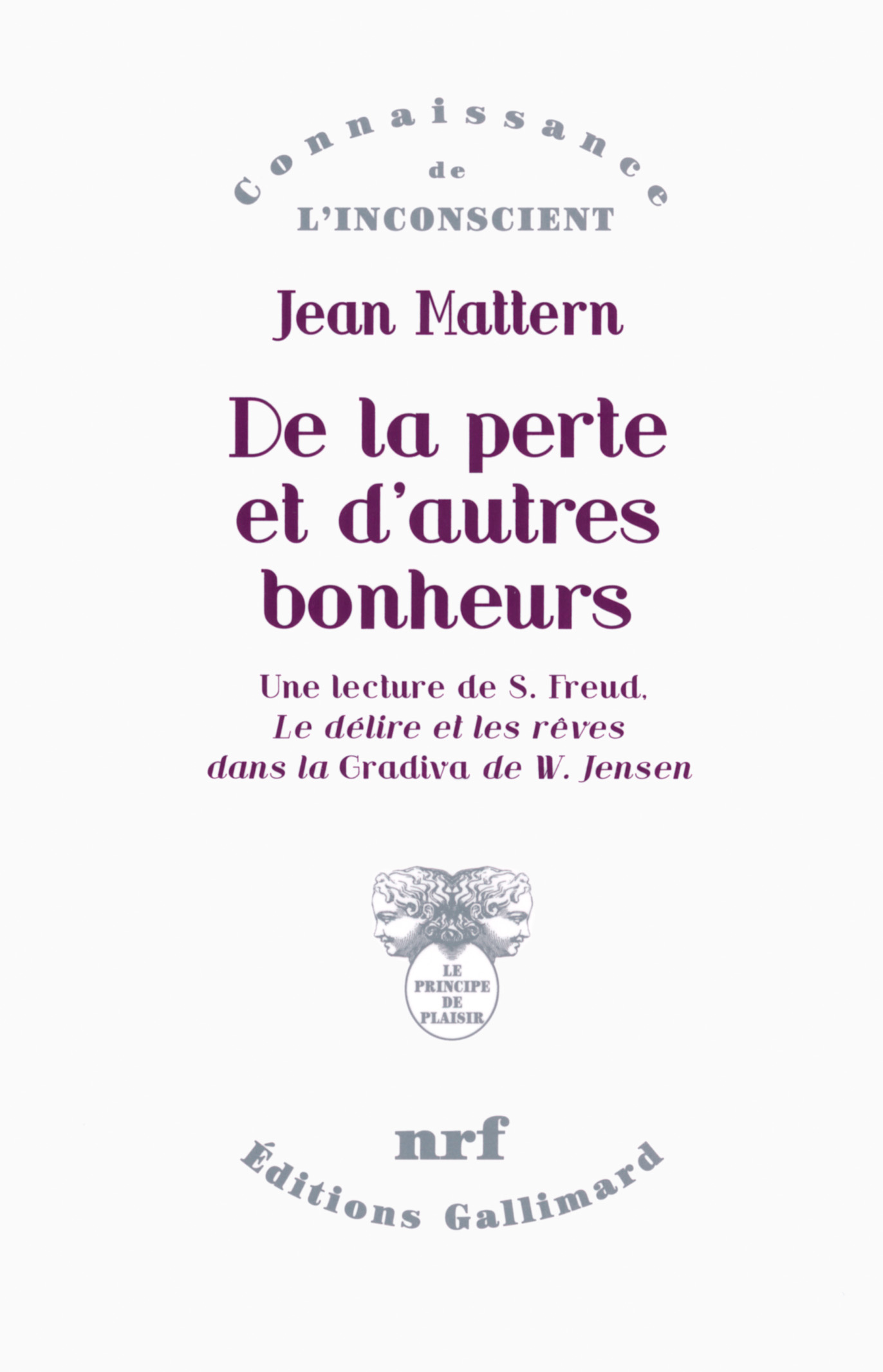 Jean Mattern, écrivain, auteur de De la perte et d’autres bonheurs (2016), s’est aussi attaché à Freud, lecteur de la Gradiva. Pour des raisons très personnelles : il a dû, tel Norbert Hanold (l’archéologue), perdre sa langue maternelle (l’allemand) pour «passer» à une autre langue, le français. Aussi va-t-il emmêler sa propre histoire à sa lecture de Freud. Notamment avec une histoire de pieds «gauches», de chutes vécues comme des pertes, d’étalement sur la chaussée… Et des paralysies (peur de tomber à nouveau) qui s’ensuivent. Et de marches dans le désert. Et de plongeons dans une piscine. Tout cela pour aboutir à «faire mourir l’adulte raisonnable en moi pour faire naître un autre homme, un homme qui serait plus fidèle au petit garçon sur son plongeoir.» Une écriture fluide, poétique… qui ne s’entrave pas, ne chute pas.
Jean Mattern, écrivain, auteur de De la perte et d’autres bonheurs (2016), s’est aussi attaché à Freud, lecteur de la Gradiva. Pour des raisons très personnelles : il a dû, tel Norbert Hanold (l’archéologue), perdre sa langue maternelle (l’allemand) pour «passer» à une autre langue, le français. Aussi va-t-il emmêler sa propre histoire à sa lecture de Freud. Notamment avec une histoire de pieds «gauches», de chutes vécues comme des pertes, d’étalement sur la chaussée… Et des paralysies (peur de tomber à nouveau) qui s’ensuivent. Et de marches dans le désert. Et de plongeons dans une piscine. Tout cela pour aboutir à «faire mourir l’adulte raisonnable en moi pour faire naître un autre homme, un homme qui serait plus fidèle au petit garçon sur son plongeoir.» Une écriture fluide, poétique… qui ne s’entrave pas, ne chute pas.
Qui continue avec une évocation de Mahler et un parallélisme avec la vie de Freud (juifs nés loin de la capitale, d’abord incompris puis admirés), ainsi que le refoulement de la sexualité qu’on trouve chez Mahler et Norbert Hanold (et peut-être chez Freud qui, semble-t-il, ne commença à copuler qu’à 30 ans).
Lire aussi : La nouvelle conscience de notre fragilité (Philippe Granarolo)
Vient un chapitre où, après une nouvelle évocation de Hanold, l’auteur parle de la liberté que lui a donnée l’écriture et écrit cette phrase que je fais mienne : «La psychanalyse et la littérature font toutes deux commerce de nos âmes […] toutes deux nous donnent les clefs pour accéder à une forme d’épanouissement, de devenir soi-même que promet la cure à l’analysant, et que le miroir tendu au lecteur par la littérature permet également». Dont acte, y compris avec ce livre, autre manière de «me confronter à un repli inexploré de mon histoire, de moi-même». Un très beau livre, qui me parle directement, comme sans doute à d’autres amoureux de l’écriture.
A la recherche du grand homme
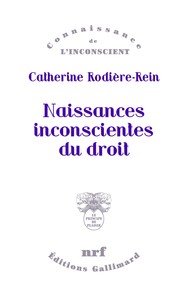 Je ne peux résister au plaisir de redire un mot du livre de Catherine Rodière-Rein, Naissances inconscientes du droit, car dans mon article de la NQL, je n’ai parlé que de son chapitre sur la mansuétude des cannibales. Cette fois-ci, je lis un autre chapitre, sur le «grand homme» chez Freud. Du père de la horde primitive, dit-elle, on se demande s’il a jamais été enfant et a connu le besoin de protection et du sentiment de déréliction en l’absence de protection. Est-il un hors-la-loi et/ou un créateur de loi ? Et le héros tragique est-il père et/ou fils ? Et le Moïse de Michel Ange est-il plein de fureur et/ou la contient-il ? Et le président Wilson est-il un fou idéaliste et/ou un lâche ? On en vient à l’homme Moïse que Freud considère comme son chef-d’œuvre et/ou un roman inachevé. Moïse crée, dit Freud, le peuple juif. Ce faisant il fait naître l’intolérance et la pureté morale. Il est très exigeant envers ce peuple, qui finit par le tuer. Puis survient le deuxième Moïse, etc. Commentaire de Catherine Rodière : le grand homme respecte la loi qu’il instaure… et pourtant «on croit voir glisser la plume de Freud», tout près d’en faire un homme insouciant et inconséquent. Comme lui-même : insouciant du scandale qu’il crée, très soucieux de laisser sa marque dans l’histoire. Et de citer Freud écrivant à Binswanger qu’il lui était imparti «le destin de troubler la paix du monde» (lettre du 10 septembre 1911). Une vraie ou une fausse paix ? Ce que Catherine ne dit pas, mais qu’elle suggère, est qu’avec son Homme Moïse, 25 ans plus tard, Freud allait exalter le peuple juif (son haut sens éthique, dû à la loi mosaïque) et/ou l’abaisser (l’alliance avec Dieu n’est qu’une fantaisie humaine, et résulte d’un emprunt à l’Égypte).
Je ne peux résister au plaisir de redire un mot du livre de Catherine Rodière-Rein, Naissances inconscientes du droit, car dans mon article de la NQL, je n’ai parlé que de son chapitre sur la mansuétude des cannibales. Cette fois-ci, je lis un autre chapitre, sur le «grand homme» chez Freud. Du père de la horde primitive, dit-elle, on se demande s’il a jamais été enfant et a connu le besoin de protection et du sentiment de déréliction en l’absence de protection. Est-il un hors-la-loi et/ou un créateur de loi ? Et le héros tragique est-il père et/ou fils ? Et le Moïse de Michel Ange est-il plein de fureur et/ou la contient-il ? Et le président Wilson est-il un fou idéaliste et/ou un lâche ? On en vient à l’homme Moïse que Freud considère comme son chef-d’œuvre et/ou un roman inachevé. Moïse crée, dit Freud, le peuple juif. Ce faisant il fait naître l’intolérance et la pureté morale. Il est très exigeant envers ce peuple, qui finit par le tuer. Puis survient le deuxième Moïse, etc. Commentaire de Catherine Rodière : le grand homme respecte la loi qu’il instaure… et pourtant «on croit voir glisser la plume de Freud», tout près d’en faire un homme insouciant et inconséquent. Comme lui-même : insouciant du scandale qu’il crée, très soucieux de laisser sa marque dans l’histoire. Et de citer Freud écrivant à Binswanger qu’il lui était imparti «le destin de troubler la paix du monde» (lettre du 10 septembre 1911). Une vraie ou une fausse paix ? Ce que Catherine ne dit pas, mais qu’elle suggère, est qu’avec son Homme Moïse, 25 ans plus tard, Freud allait exalter le peuple juif (son haut sens éthique, dû à la loi mosaïque) et/ou l’abaisser (l’alliance avec Dieu n’est qu’une fantaisie humaine, et résulte d’un emprunt à l’Égypte).
C’est là un problème que la psychanalyse ne peut résoudre : jusqu’à quel point la fiction est-elle salvatrice ? Comment peut-elle étayer la raison au lieu de l’obscurcir ? Peut-être est-ce une question de dosage – de compromis dit Gribinski – entre le «principe de plaisir» et le «principe de réalité» ?
Né en 1945, Michel Juffé est un philosophe français, intéressé aux questions d'éthique, de philosophie politique et d'écologie. Il fut conseiller du vice-président du conseil général de l'écologie et du développement durable (2003-2010) et a enseigné dans plusieurs grandes écoles et universités. Auteur d'une douzaine d'ouvrages, il a récemment publié Sigmund Freud – Benedictus de Spinoza, Correspondance, 1676-1938 (Gallimard, 2016), Café-Spinoza (Le Bord de l'eau, 2017), Liberté, égalité, fraternité... intégrité (L'Harmattan, 2018), A la recherche d'une humanité durable (L'Harmattan, 2018) et, dernièrement, Éclats d’un monde disparu (Élan des mots, 2020), Nietzsche lecteur de Heidegger (Élan des mots, 2021) et Vlad le destructeur (Élan des mots, 2022).


Commentaires
Passionnant papier ! On sent bien, à travers les livres dont vous faites recension , les rapports intimes entre psychanalyse et littérature . Ce n’est pas d’hier, il est vrai : Sophocle – notamment avec Oedipe Roi et Oedipe à Colonne – n’est-il pas, au fond, le vrai père de la psychanalyse , près de cinq siècles avant Jésus-Christ ? Et que dire des tourments d’Hamlet, si subtilement compris de Shakespeare ! Freud, bien sûr, jeune bourgeois viennois cultivé, ayant fait ses » humanités « , connaissait parfaitement l’oeuvre de l’un et de l’autre, comme le montre le livre de Jacques Rider, Freud, de l’Acropole au Sinaï. Comme vous, je vais me précipiter sur le livre de Jean-François Le Goff, consacré à Orwell et Winnicott !
Par ailleurs, je partage votre distinction entre les trois sortes de possessions et plus particulièrement celle entre la hantise ( passé » possédant » le présent ) et l’emprise ( de quelqu’un sur un, plusieurs ou beaucoup d’autres ). Et j’applaudis à votre définition du travail de l’analyse : » Le transfert, s’il réussit, est une déprise de la hantise ou de l’emprise, ou plus souvent des deux… ».
par Philippe Le Corroller - le 27 janvier, 2019
L’efficacité de la psychanalyse ne dépend pas tant de la technique utilisée ou du thérapeute mais de l’implication du patient. La psychanalyse offre avant tout, un lieu, un temps et un cadre. La psychanalyse ne vous demande pas l’heure, ne vous dit pas l’heure mais vous invite à regarder votre montre.
La psychanalyse est dès lors une chose excellente que personnellement je recommanderais à tout le monde car nous avons tous des mécanismes de fonctionnement contre productifs voire destructeurs qu’il est toujours utile de rectifier ou à tout le moins de maîtriser.
Ceux qui prétendent ne pas avoir pas besoin de psychanalyse et a fortiori ceux qui la dénigrent sont les premiers à en avoir urgemment besoin soyez en sûr.
par Olivier MONTULET - le 27 janvier, 2019
Bonjour,
Merci de cette revue critique de plusieurs livres très intéressants, et des nombreuses remarques et commentaires affûtés qui l’accompagnent. Et aussi, grand merci pour cette perle sur la question de savoir quel jour est-on et sa réponse, which makes my day!
Cependant, la question que la psychanalyse ne peut pas résoudre et qui est évoquée dans cet article a trait à la fiction (et sa capacité à étayer ou obscurcir la raison ) – et non à la psychanalyse elle-même, contrairement à ce qui est dit dans sa brève présentation.
Mais cela dit, le rôle, la place, bref la question de la fiction dans l’analyse reste un point fondamental, théorique et cllnique, qui continue de créer de lourds contresens dont la psychanalyse fait les frais. Y compris dans la conclusion de cet article.
par Gilles-Olivier Silvagni - le 28 janvier, 2019
Sur la fiction…
Je n’oublie pas que certains philosophes grecs… hommes, parmi les plus influents sur notre civilisation… ont craché dans la soupe des « contes de vieilles femmes au coin du feu »… Je suis une très mauvaise féministe, mais la tendance à renvoyer la faculté de l’imagination à l’irrationalité, et à la loger chez la VIEILLE FEMME me semble trimballer des conséquences lourdes pour la civilisation occidentale… moderne.
Et je continue à penser que celui, ou celle qui idolâtre la raison, en s’accaparant l’exclusivité de la vérité raisonnable et raisonnante est sur une très mauvaise pente. L’histoire récente du XXième siècle nous a déjà donné une démonstration assez éclatante, et suffisante, à mes yeux.
Pour la psychanalyse : Freud a tergiversé entre un idéal de cure qui renforcerait les processus secondaires, compris comme la raison raisonnante et raisonnable, mais il était trop réaliste pour croire que l’Homme puisse trouver son salut dans un… positivisme progressiste. Les héritiers américains de la psychanalyse n’ont pas hésité à mettre Freud à la sauce positiviste, mais… Freud ne se laisse pas réduire aussi facilement, pour ceux qui le lisent. Il était un grand homme, un grand curieux, un grand « scientifique » avec un grand amour pour la littérature, et il écrit… comme un lettré, pas comme un technicien moderne.
Le divorce (moderne) entre la littérature et la « science » achève mieux… la science que la littérature, d’ailleurs. Mais… notre gestion comptable qui nous fait comptabiliser tout ce qui bouge, et ce qui ne bouge pas aussi, est assez mortifère, et risque de… nous achever avec le comptage.
Je retourne au coin du feu..
par Debra - le 29 janvier, 2019
[…] aussi : La psychanalyse peut-elle faire plaisir ? (Michel […]
par iPhilo » «Le salut du peuple est la loi suprême» - le 16 mai, 2020
Laissez un commentaire