Hannah Arendt : « Le conservatisme est l’essence même de l’éducation »
CLASSIQUES : Nous vous proposons au début de chaque mois la lecture d’un grand texte de l’histoire de la philosophie. Ils sont d’autant plus grands qu’ils continuent à nous éclairer… pour peu encore que nous les lisions. Dans le monde du zapping, conserver un contact avec les «classiques» est un acte de courage. C’est précisément pour cette raison que la philosophe évoque dans La crise de la culture la tâche de « conservation » de l’éducateur, à qui il « appartient de faire le lien entre l’ancien et le nouveau ».
« Sa profession exige de lui un immense respect du passé », explique encore Hannah Arendt dans « La crise de l’éducation », l’un des huit essais que comporte cet ouvrage paru en 1961. Pour l’ancienne élève d’Heidegger, qui évoque dans sa préface « la brèche entre le passé et le futur », il ne s’agit pas d’empêcher le monde de changer, mais, bien au contraire, de « préserver ce qui est neuf et révolutionnaire dans chaque enfant ».
Lire aussi : L’autorité à l’École : relire Hannah Arendt (Claude Obadia)
Or, cette tâche est rendue délicate par le rapport au temps propre à la Modernité, qui abolit « le respect du passé », « trait essentiel » de l’esprit romain, que le christianisme n’a pas remis en cause. « Le problème de l’éducation tient au fait que par sa nature même l’éducation ne peut faire fi de l’autorité, ni de la tradition, et qu’elle doit cependant s’exercer dans un monde qui n’est pas structuré par l’autorité ni retenu par la tradition », poursuit Hannah Arendt. Il faut dès lors que l’éducation soit protégée de l’esprit du temps et strictement séparée des autres domaines de la vie publique, à commencer par la politique. En somme, l’éducation doit avancer à contre-courant, elle est une nécessaire résistance.
Ce texte marque par son actualité. Ce sont précisément ces questions qui hantent les débats contemporains sur l’éducation et les réformes discutées actuellement par le ministre Jean-Michel Blanquer. On pourrait par exemple décliner l’intuition d’Hannah Arendt : pour qu’un enfant devienne une fois adulte un internaute averti, il faut le protéger dans sa jeunesse du trop plein d’écran ; pour qu’il profite de la création bouillonnante du Web, il doit commencer par lire les classiques, étudier le latin et le grec ; pour qu’il devienne à l’aise dans la multidisciplinarité nécessaire à la complexité du monde contemporain, il doit d’abord commencer par maîtriser les matières fondamentales…
Voici donc un extrait de « La crise de l’éducation » d’Hannah Arendt, dans une traduction de Chantal Vezin (Folio Essais n°113)
Dans le cas de l’éducation, la responsabilité du monde prend la forme de l’autorité […] La compétence du professeur consiste à connaître le monde et à pouvoir transmettre cette connaissance aux autres, mais son autorité se fonde sur son rôle de responsable du monde. Vis-à-vis de l’enfant, c’est un peu comme s’il était un représentant de tous les adultes, qui lui signalerait les choses en lui disant : »Voici notre monde » [….]
Il existe bien sûr un lien entre la disparition de l’autorité dans la vie publique et politique et sa disparition dans les domaines privés et prépolitiques de la famille et de l’école. Plus la méfiance envers l’autorité devient systématique dans la sphère publique, plus il devient naturellement probable que la sphère privée en soit affectée […]
Lire aussi : «Il faut libérer l’école de l’ambition prométhéenne d’un homme nouveau» (Robert Redeker)
Evitons tout malentendu : il me semble que le conservatisme, pris au sens de conservation, est l’essence même de l’éducation, qui a toujours pour tâche d’entourer et de protéger quelque chose, – l’enfant contre le monde, le monde contre l’enfant, le nouveau contre l’ancien, l’ancien contre le nouveau […]
Au fond , on n’éduque jamais que pour un monde déjà hors de ses gonds ou sur le point d’en sortir, c’est là le propre de la condition humaine que le monde soit créé par des mortels afin de leur servir de demeure pour un temps limité. Parce que le monde est fait par des mortels, il s’use ; et parce que ses habitants changent continuellement, il court le risque de devenir mortel comme eux. Pour préserver le monde de la mortalité de ses créateurs et de ses habitants, il faut constamment le remettre en place. Le problème est tout simplement d’éduquer de façon telle qu’une remise en place demeure effectivement possible, même si elle ne peut jamais être définitivement assurée. Notre espoir réside toujours dans l’élément de nouveauté que chaque génération apporte avec elle ; mais c’est précisément parce que nous ne pouvons placer notre espoir qu’en lui que nous détruisons tout si nous essayons de canaliser cet élément nouveau pour que nous, les anciens, puissions décider de ce qu’il sera. C’est justement pour préserver ce qui est neuf et révolutionnaire dans chaque enfant que l’éducation doit être conservatrice ; elle – doit protéger cette nouveauté et l’introduire comme un ferment nouveau dans un monde déjà vieux qui, si révolutionnaire que puissent être ses actes, est, du point de vue de la génération suivante, suranné et proche de la ruine.
Lire aussi : L’art d’éduquer : une impossible «science» de la pédagogie ? (Jean-Sébastien Philippart)
La véritable difficulté de l’éducation moderne tient au fait que, malgré tout le bavardage à la mode sur un nouveau conservatisme, il est aujourd’hui extrêmement difficile de s’en tenir à ce minimum de conservation et à cette attitude conservatrice sans laquelle l’éducation est tout simplement impossible. Il y a à cela de bonnes raisons. La crise de l’autorité dans l’éducation est étroitement liée à la crise de la tradition, c’est-à-dire à la crise de notre attitude envers tout ce qui touche au passé. Pour l’éducateur cet aspect de la crise est particulièrement difficile à porter, car il lui appartient de faire le lien entre l’ancien et le nouveau : sa profession exige de lui un immense respect du passé. Pendant des siècles, c’est-à-dire tout au long de la période de civilisation romano-chrétienne, il n’avait pas à s’aviser qu’il possédait cette qualité, car le respect du passé était un trait essentiel de l’esprit romain et le Christianisme n’a ni modifié ni supprimé cela, mais l’a simplement établi sur de nouvelles bases.
L’essence même de cet esprit romain (bien qu’on ne puisse appliquer cela à toute civilisation, ni même à l’ensemble de la tradition occidentale) était de considérer le passé en tant que passé comme modèle, et dans tous les cas les ancêtres comme de vivants exemples pour leurs descendants. Il croyait même que toute grandeur réside dans ce qui a été, que la vieillesse est donc le sommet de la vie d’un homme et que, étant déjà presque un ancêtre, le vieillard doit servir de modèle aux vivants. Tout cela est en contradiction non seulement avec notre époque et les temps modernes depuis la Renaissance, mais aussi par exemple avec l’attitude grecque en face de la vie. Quand Goethe dit que vieillir c’est «se retirer progressivement du monde des apparences », il fait là un commentaire dans l’esprit même des Grecs pour lesquels être et apparaître ne font qu’un. La conception latine serait que c’est justement en vieillissant et en disparaissant peu à peu de la communauté des mortels que l’homme atteint sa plus caractéristique manière d’être même si, par rapport au monde des apparences, il est en train de disparaître; car c’est alors seulement qu’il atteint ce mode d’existence où il sera une autorité pour les autres.
Lire aussi : L’avenir de l’éducation (François-Xavier Bellamy)
Avec l’arrière-plan intact de cette tradition où l’éducation jouait un rôle politique (et ce fut un cas unique), il est en fait relativement facile de faire ce qu’il faut en matière d’éducation, sans prendre la peine de réfléchir à ce que l’on est en train de faire : l’éthique particulière des principes d’éducation est en parfait accord avec les principes éthiques et moraux de la société en général. Éduquer, selon les termes de Polybe, c’était simplement «vous faire voir que vous êtes tout à fait digne de vos ancêtres» et, dans cette tâche, l’éducateur pouvait être un «partenaire dans la discussion» et un «partenaire dans le travail», car lui aussi, bien qu’à un niveau différent, passait sa vie les yeux fixés vers le passé. Camaraderie et autorité n’étaient dans ce cas que les deux faces d’une même chose et l’autorité de l’éducateur était fermement fondée dans l’autorité plus vaste du passé en tant que tel. Cependant, nous ne sommes plus dans cette situation aujourd’hui et cela ne veut pas dire grand-chose d’agir comme si nous nous y trouvions encore et comme si nous ne nous étions éloignés du droit chemin que par accident, restant libres de le retrouver n’importe quand. Cela signifie que, partout où la crise a éclaté dans le monde moderne, nous ne pouvons nous contenter de continuer, ni même simplement de retourner en arrière. Un tel retour en arrière ne fera jamais que nous ramener à cette même situation d’où justement a surgi la crise. Ce retour ne serait qu’une simple répétition — bien que peut-être différente dans la forme — car il est toujours possible de présenter toute absurdité et toute notion extravagante comme étant le dernier mot de la science. Par ailleurs, une simple persévérance sans réflexion, qu’elle agisse dans le sens de la crise ou qu’elle demeure attachée au train-train quotidien qui croit naïvement que la crise ne submergera pas son domaine particulier, peut seulement, parce qu’elle s’abandonne au cours du temps, conduire à la ruine ; elle peut seulement, pour être plus précis, accroître cette aliénation du monde, situation qui nous menace déjà de toutes parts. Qui réfléchit sur les principes d’éducation doit tenir compte de ce processus d’aliénation par rapport au monde ; il peut même admettre que nous nous trouvons sans doute là en face d’un processus automatique, à la seule condition qu’il n’oublie pas que la pensée et l’action de l’homme peuvent interrompre et arrêter un tel processus.
Dans le monde moderne, le problème de l’éducation tient au fait que par sa nature même l’éducation ne peut faire fi de l’autorité, ni de la tradition, et qu’elle doit cependant s’exercer dans un monde qui n’est pas structuré par l’autorité ni retenu par la tradition. Mais cela signifie qu’il n’appartient pas seulement aux professeurs et aux éducateurs, mais à chacun de nous, dans la mesure où nous vivons ensemble dans un seul monde avec nos enfants et avec les jeunes, d’adopter envers eux une attitude radicalement différente de celle que nous adoptons les uns envers les autres. Nous devons fermement séparer le domaine de l’éducation des autres domaines, et surtout celui de la vie politique et publique. Et c’est au seul domaine de l’éducation que nous devons appliquer une notion d’autorité et une attitude envers le passé qui lui conviennent, mais qui n’ont pas une valeur générale et ne doivent pas prétendre détenir une valeur générale dans le monde des adultes.
Lire aussi : Éducation : faire attention à l’attention (Nathalie Depraz)
En pratique, il en résulte que, premièrement, il faudrait bien comprendre que le rôle de l’école est d’apprendre aux enfants ce qu’est le monde, et non pas leur inculquer l’art de vivre. Étant donné que le monde est vieux, toujours plus vieux qu’eux, le fait d’apprendre est inévitablement tourné vers le passé, sans tenir compte de la proportion de notre vie qui sera consacrée au présent. Deuxièmement, la ligne qui sépare les enfants des adultes devrait signifier qu’on ne peut ni éduquer les adultes ni traiter les enfants comme de grandes personnes. Mais il ne faudrait jamais laisser cette ligne devenir un mur qui isole les enfants de la communauté des adultes, comme s’ils ne vivaient pas dans le même monde et comme si l’enfance était une phase autonome dans la vie d’un homme, et comme si l’enfant était un état humain autonome, capable de vivre selon des lois propres. On ne peut pas établir de règle générale qui déterminerait dans chaque cas le moment où s’efface la ligne qui sépare l’enfance de l’âge adulte ; elle varie souvent en fonction de l’âge, de pays à pays, d’une civilisation à une autre, et aussi d’individu à individu. Mais à l’éducation, dans la mesure où elle se distingue du fait d’apprendre, on doit pouvoir assigner un terme. Dans notre civilisation, ce terme coïncide probablement avec l’obtention du premier diplôme supérieur (plutôt qu’avec le diplôme de fin d’études secondaires) car la préparation à la vie professionnelle dans les universités ou les instituts techniques, bien qu’elle ait toujours quelque chose à voir avec l’éducation, n’en est pas moins une sorte de spécialisation. L’éducation ne vise plus désormais à introduire le jeune dans le monde comme tout, mais plutôt dans un secteur limité bien particulier. On ne peut éduquer sans en même temps enseigner; et l’éducation sans enseignement est vide et dégénère donc aisément en une rhétorique émotionnelle et morale. Mais on peut très facilement enseigner sans éduquer et on peut continuer à apprendre jusqu’à la fin de ses jours sans jamais s’éduquer pour autant. Mais tout cela n’est que détails, que l’on doit vraiment abandonner aux experts et aux pédagogues.
Ce qui nous concerne tous et que nous ne pouvons donc esquiver sous prétexte de le confier à une science spécialisée — la pédagogie — c’est la relation entre enfants et adultes en général, ou pour le dire en termes encore plus généraux et plus exacts, notre attitude envers le fait de la natalité : le fait que c’est par la naissance que nous sommes tous entrés dans le monde, et que ce monde est constamment renouvelé par la natalité. L’éducation est le point où se décide si nous aimons assez le monde pour en assumer la responsabilité et, de plus, le sauver de cette ruine qui serait inévitable sans ce renouvellement et sans cette arrivée de jeunes et de nouveaux venus. C’est également avec l’éducation que nous décidons si nous aimons assez nos enfants pour ne pas les rejeter de notre monde, ni les abandonner à eux-mêmes, ni leur enlever leur chance d’entreprendre quelque chose de neuf, quelque chose que nous n’avions pas prévu, mais les préparer d’avance à la tâche de renouveler un monde commun.
(Texte choisi et présenté par Alexis Feertchak)
Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook : @iPhiloApp ; facebook.com/iphiloapp !
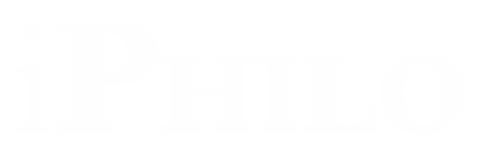

Commentaires
Bonjour,
L »éducation de l’enfant commence au sein de la famille.Nous aurions trop tendance oublier ce fondement.
Un climat de confiance et de respect de l’enfant dans un cadre de règles à minima-tous les âges de la vie sont sacrés-devraient prévaloir avant; et au cours de l’éducation scolaire.
Chaque enfant est une chance,une richesse pour l’humanité et la condescendance n’est pas la règle à appliquer à la toise.
Appréhender un enfant comme un sujet non pas comme un objet de représentation ou de renoncement. L’enfant n’appartient pas à l’adulte.
Parlons de compétence,d’attention,de pédagogie,plutôt que d’autorité, d’obéissance,de notes rédhibitoires.
Du devoir d’élever,confortant l’enfant dans son monde de génie ingénu.
Le conduire à découvrir le monde sans artifice!
par philo'ofser - le 2 mars, 2018
Comme vous avez raison, cher Alexis Feertchak de souligner cette phrase d’Hanna Arendt : » Le conservatisme, pris au sens de conservation, est l’essence même de l’éducation, qui a toujours pour tâche d’entourer et de protéger quelque chose… » . Il me semble qu’un enseignant peut difficilement éviter d’être un conservateur , au sens vrai de ce mot : celui qui s’inscrit dans une continuité , celui qui sait que le présent est d’abord – mais pas seulement, bien sûr – l’aboutissement du passé. Pas du tout un adepte du » C’était mieux avant « , comme l’a récemment caricaturé un philosophe d’ordinaire moins superficiel. Mais au contraire un réformateur dans l’âme , convaincu qu’il faut » que tout change pour que rien ne change « . Vous évoquez Jean-Michel Blanquer : la sympathie qu’il suscite chez une majorité de Français ne tient-elle pas au fait que ses réformes, sortant enfin l’école de l’idéologie des » pédagogistes » , lui redonne son vrai rôle ?
par Le Corroller - le 2 mars, 2018
Hannah Arendt, bien sûr.
par Le Corroller - le 2 mars, 2018
Très bel article qui vient à point nommé mettre davantage sur la scène la véritable nature de l’éducation. Selon moi toute éducation qui cesse d’être conservatrice se desubstantialise. En tant que substratum sociétal l’éducation doit transmettre certaines valeurs afin de nous préserver et protéger des affres de notre post modernité dans laquelle nous a plongé l’éducation progressiste. En démocratisant l’éducation dans son fond et dans sa forme une telle éducation a vidé l’éducation de ce qu’elle a d’essentiel.
par Gomsolbé Justin - le 3 mars, 2018
Conserver, c’est sauver.
par Marie Coulon - le 4 mars, 2018
Derrière le problème de l’éducation se profile le problème de la transmission tout court, et du rapport entre les générations.
Rapports qui sont à comprendre dans une tension permanente entre compétition (entre les générations) et protection.
Pour l’autorité, il est important de pouvoir comprendre que la responsabilité de la communauté des adultes envers la génération suivante consiste à donner un cadre qui forcément limitera la possibilité/les possibilités de l’individu (se souvenir que tout enfant naît avec la possibilité de parler/prononcer toutes les langues, mais que progressivement, il perd (plus ou moins) cette capacité en apprenant la langue de sa communauté).
Le fait d’entrer dans une communauté sociale passe par une perte, ou ce que Freud pouvait appeler une castration. C’est inévitable, et structurant. Et c’est le rôle des adultes d’imposer… cette/ces perte(s), pour permettre à l’enfant de trouver sa place dans la communauté et s’y intégrer afin d’y jouir d’une liberté toute relative…
Après, je trouve qu’il est important de dissocier le problème de l’éducation de l’institution de l’école, et poser la question du rôle.. initiatique de l’institution école dans nos société modernes.
Et je n’aime pas trop mettre un majuscule au mot « moderne ».
Enfin, à faire remarquer que les deux grandes traditions religieuses qui ont fortement marqué l’Occident, la pensée juive, et la pensée chrétienne ont un rapport au temps qui est différent.
Le messianisme juif situe un certain accomplissement du temps dans l’arrivée (a-venir) du Messie, alors que le Christianisme voit cet accomplissement dans le retour (répétition…) du Christ. Pro-gressisme et répétition ont donc des bases très traditionnelles, pourrait-on dire.
par Debra - le 4 mars, 2018
Voilà un texte de philosophe. Il y est question de l’homme et du monde : de la condition humaine dans sa généralité, chez les bretons comme chez les esquimaux.
Cela a t-il un sens ? Et lequel ? Les hommes transmettent à leurs enfants ce qu’ils ont reçu de leurs pères et mères : un monde. Si les enfants n’écoutent pas ou si les parents ne parlent pas, c’en est fini de cette « culture », de ce « peuple ». Une génération suffit.
Aussi, faut-il bien avoir présent à l’esprit que toutes ces générations que nous « occidentalisons » signent la fin, sinon de l’humanité dans sa richesse et son inventivité, du moins l’humanité telle que Arendt en parle.
Certains pensent que cette humanité a fait son temps. Et qu’une humanité « nouvelle » est en train de naître. Une sorte de « bonne nouvelle » en quelque sorte.
par Gérard - le 4 mars, 2018
Cette réflexion philosophique me semble centrée exclusivement sur le sort futur de notre « civilisation » occidentale avec ses caractéristiques historiques au sens le plus exhaustif. Ce sort suscite à juste titre des inquiétudes depuis les deux guerres mondiales qui ont détruit l’ensemble de nos certitudes sur le progrès ( sciences, technologie, économie, etc ) ainsi que sur la validité de la valeur universelle de notre civilisation occidentale confrontée aux désordres et à la désorganisation mondiaux qu’elle a suscité par son imposition forcée ( colonisation, évangélisation, etc… ). Nous observons au jour le jour nos actuelles jeunes générations massivement scolarisées et « éduquées » dans un contexte où l’utilitaire parfois fugace le dispute à la connaissance pure et désintéressée. L’abandon progressif et continu scolairement de toute historicité de notre monde actuel leur donne l’illusion d’un acquis sans contradiction, d’un monde surgi ex nihilo à leur naissance et destiné à perdurer sans contraintes ni efforts. Parvenus à l’âge adulte beaucoup se complaisent dans un assistanat social qui les maintient dans cette illusion. Leur apprendre à nouveau l’histoire du monde et de notre civilisation avec ses ruptures, ses sursauts, ses continuités, ses bienfaits comme ses méfaits, son devenir souhaité est devenu plus que jamais indispensable face aux défis de la mondialisation de tous nos échanges et relations économiques, sociaux, sociétaux, humains.
par Abate Gérard - le 13 mars, 2018
[…] Hannah Arendt : « Le conservatisme est l’essence même de l’éducation » […]
par i Philo.fr | Chantal Beaugnon - Correction de thèses, mémoires et rapports - le 25 mars, 2018
[…] aussi : Le conservatisme est l’essence même de l’éducation (Hannah […]
par iPhilo » Éloge de la classe - le 10 décembre, 2019
[…] aussi : «Le conservatisme est l’essence même de l’éducation» (Hannah […]
par iPhilo » Laïcité, autorité, sécurité et santé : le peuple dépossédé - le 24 octobre, 2020
Laissez un commentaire