Petite philosophie du grand large
BONNES FEUILLES : Nous proposons ici la lecture de quelques extraits de Petite philosophie du grand large, récemment paru aux Éd. Le Pommier, dans lequel Claude Obadia offre un regard nouveau sur cette expérience singulière : larguer les amarres, voir disparaître la côte, n’être plus qu’embruns, sens du vent et gestes assurés. Où vivre en mer revient à se lancer dans une aventure de la pensée, bref, à vivre philosophiquement.

Agrégé de philosophie, Claude Obadia enseigne dans le secondaire, en classes préparatoires commerciales, à l’Université de Cergy-Pontoise et à l’Institut Supérieur de Commerce de Paris. Ancien rédacteur en chef de la revue Le Philosophoire, il a publié Les Lumières en berne ? (éd. L’Harmattan, 2011) et Kant prophète ? Éléments pour une europhilosophie (éd. Ovadia, 2014). Nous vous conseillons son blog.
Le 16 octobre 1992, le navigateur américain Mike Plant quittait le port de New York pour rallier Les Sables-d’Olonne à bord de son nouveau 60 pieds Open Coyote et prendre le départ, pour la deuxième fois, du Vendée Globe, course autour du monde en solitaire et sans escale. Le 27 octobre, le navigateur déclenche sa balise de détresse. Mais comme il a négligé de la faire enregistrer par les affaires maritimes, aucune recherche n’est entreprise par les autorités américaines avant le 6 novembre. Le 29 novembre, Coyote est repéré à 460 milles au nord des Açores. Le bateau est chaviré et le bulbe de la quille a disparu. On ne retrouvera pas le corps de Mike Plant, l’un des navigateurs hauturiers les plus doués de sa génération. Quelle est la cause précise de sa disparition ? Nul ne le saura jamais. Défaillance humaine ? Technique ? Vague «scélérate» ? Toutes les hypothèses sont envisageables, aucune n’est à privilégier. Mais une chose est certaine : qui prend la mer court toujours le risque d’y être emporté. Non que la mer soit traîtresse, et encore moins vicieuse comme le veut une représentation populaire bien ancrée. Mais prendre la mer sera toujours partir à l’aventure. Platon l’a très bien compris, auquel on attribue, non sans discussion, la formule déjà citée : «y a les vivants, il y a les morts, et il y a ceux qui vont sur les mers.». Que veut-il dire par là, et en quoi l’appel du large est-il bien une invitation à l’aventure ?
Qui a déjà pointé l’étrave de son bateau vers le large sait qu’on ne le fait pas sans un minimum de préparation. Il faut vérifier l’état du navire, en particulier du gréement[1], des voiles, du moteur, faire l’avitaillement, vérifier que les équipiers disposent de vêtements adaptés, qu’ils n’ont pas de problèmes de santé aigus, définir un programme de navigation adapté aux conditions météorologiques et aux compétences globales de l’équipage, etc. Pour le dire vite, prendre la mer réclame autant de méticulosité que de méthode. Au fond, il convient ici de ne rien laisser au hasard. La raison en est simple. Si certains des faits qui vont marquer la croisière, ou la course si l’on est un compétiteur, sont prévisibles, et même pour certains d’entre eux prévus, toute navigation offre son lot d’événements imprévus. Pour cette première raison, naviguer, que ce soit en haute mer ou près des côtes, constitue une aventure au cours de laquelle le hasard et la fatalité retrouveront toujours leurs droits. Qu’est au juste le hasard ? C’est ce qui fait qu’un événement peut se produire comme il peut ne pas se produire. En ce sens, on parlera aussi de contingence et l’on dira qu’un phénomène se produit par hasard lorsqu’il se produit sans raison ni finalité. Qu’est-ce que la fatalité ? C’est le caractère de ce qui doit se produire, «ce qui est déjà écrit», comme dit Jacques à son maître dans le fameux roman de Diderot Jacques le Fataliste. Or, chacun le sait, chaque départ en mer réserve son lot de surprises, plus ou moins bonnes. Un boulon servant à fixer le moteur sur le fond du bateau que l’on découvre complètement desserré. Un bulletin météo obtenu par fax en pleine nuit annonçant du vent de force 10 Beaufort[2] sur la zone qu’on s’apprête à traverser. Un écho radar, encore en pleine nuit, signalant un navire de grande taille à moins de deux milles nautiques mais dérivant à une vitesse de 1,5 nœuds tous feux éteints. Un enrouleur de génois[3] qui casse au beau milieu de la mer Celtique. Sommes-nous condamnés à subir de façon passive ce type d’événements ? Rien n’est moins sûr. Réfléchissons.
Il est évident que nous n’avons ni le pouvoir de déterminer la force du vent ni celui de modifier la trajectoire du porte-conteneurs qui menace d’entrer en collision avec notre bateau. Ces choses, en effet, ne dépendent pas de nous. Néanmoins, si nous ne pouvons pas toujours prévoir une avarie du gréement, nous pouvons, avant de prendre la mer, le vérifier soigneusement. Comme nous pouvons prendre soin de contrôler l’état de nos voiles avant d’appareiller et de risquer de subir un coup de vent. Il est aussi en notre pouvoir de veiller à nous alimenter et à dormir correctement tant que les conditions de navigation sont clémentes, et ce afin d’être aussi vigilants et réactifs que possible si nous venions à rencontrer des conditions plus musclées ou si nous devions subir une avarie majeure. Donc, oui, bien sûr, on ne peut pas tout prévoir. Mais cela, il faut précisément le prévoir ! C’est pourquoi le navigateur doit avoir à l’esprit qu’il devra toujours assumer les difficultés qu’il rencontrera. C’est la raison pour laquelle il lui faudra, non se lancer dans une aventure hasardeuse, mais préparer sa traversée en veillant à anticiper l’éventualité d’une situation délicate et imprévisible. Chacun l’aura donc compris, naviguer comporte des risques. Pourquoi, dès lors, «aller sur les mers» ? Pourquoi risquer de se mettre en danger ? Pour comprendre pourquoi nous retournons au large même lorsque nous y avons vécu des moments difficiles, il faut d’abord relativiser les dangers que nous y courons. Car, encore une fois, si nous ne pouvons pas toujours éviter d’y croiser la route d’une dépression très creuse, nous aurons d’autant plus la capacité d’essuyer cette tempête que nous nous y serons préparés. Il faudra donc apprendre à maîtriser les gestes techniques, les manœuvres qu’il convient d’effectuer dans le gros temps, comme il faudra avoir pris soin de prendre le large sur un bateau en bon état de fonctionnement et avec un équipage capable de faire face à la difficulté. Envisagée sous cet angle, la mer n’est-elle pas la plus formidable école de la vie ?
[…] 1er mars 1969. Le navigateur Bernard Moitessier, qui a pris le départ le 22 août 1968 de la première course autour du monde en solitaire sans escale, le Sunday Times Golden Globe Race, écrit dans son journal de bord : «J’ai remis le cap vers le Pacifique… la nuit dernière a été trop pénible, je me sentais devenir vraiment malade à l’idée de regagner l’Europe […]. Certes il y avait des raisons valables, sérieuses. Mais est-ce la sagesse que de se diriger vers un lieu où l’on sait qu’on ne retrouvera pas sa paix ? […] Je n’en peux plus des faux dieux de l’Occident. Et je porte plainte contre le Monde Moderne. C’est lui, le Monstre. Il détruit notre terre, il piétine l’âme des hommes.»[4]. Un peu plus tard, il fait parvenir à un journaliste du Sunday Times, qu’il connaît bien, le message suivant : «Cher Robert, le Horn a été arrondi le 5 février et nous sommes le 18 mars. Je continue sans escale vers les îles du Pacifique parce que je suis heureux en mer, et peut-être aussi pour sauver mon âme.». Sept mois après avoir quitté Plymouth, en Angleterre, le skipper de Joshua (c’est le nom qu’il a donné à son voilier, en hommage à Joshua Slocum, premier marin à avoir effectué un tour du monde à la voile en solitaire) abandonne la course et, au lieu de remonter l’Atlantique sud, met le cap sur l’océan Indien. Bernard Moitessier, après avoir pris cette décision radicale, atteint Tahiti le 21 juin 1969 et passera de longues années en Polynésie. S’il n’est pas question, dans le cadre du présent ouvrage, de retracer la vie de ce marin hors norme, il faut néanmoins rappeler que ses livres, en particulier Vagabond des mers du Sud et La Longue route, en faisant découvrir les bonheurs et les aléas de la navigation hauturière à ceux qui ne les connaissaient pas, ont suscité de très nombreuses vocations pour la mer et la vie au grand large. D’aucuns demanderont ce qui peut expliquer le succès de ces récits. Pour le comprendre, il faut d’abord rappeler le contexte dans lequel ces ouvrages ont été publiés.
Lire aussi : L’homme de l’universel (Claude Obadia)
Entre Vagabond des mers du Sud (1960) et La Longue Route (1971) s’écoulent dix années qui vont changer le monde : construction du mur de Berlin, influence de la beat generation, guerre du Vietnam, Mai 68, premier pas sur la Lune. Entre progrès technologiques, conquête spatiale, crainte d’un holocauste nucléaire et aspiration à la liberté, les années 1960 voient se développer, aux États-Unis puis en Europe occidentale, une contre-culture au sein de laquelle la découverte de l’Ailleurs – bien après Gauguin soulignant, dans sa toile Arearea, qu’on peut entretenir un rapport pacifique avec la nature – devient une invitation au voyage. Larguer les amarres ! Partir ! Pourquoi, dira-t-on ? Encore une fois, nous devons avoir à l’esprit que dans le sillage de la révolution industrielle, l’Occident, acquis aux vertus du machinisme et, plus largement, de la technique, entretient un rapport principalement utilitaire avec la nature qui est le plus souvent envisagée comme ce dont on tire profit en l’exploitant. Or, c’est ce rapport d’exploitation que la contre-culture occidentale va dénoncer. Le monde devient alors ce dont la richesse ignorée doit être explorée, ce dont la beauté doit être contemplée. On rêve ainsi, dans une Europe pétrie de puritanisme chrétien, de faire corps avec la nature, et, dans une société nourrie au lait de la psychanalyse freudienne, de redécouvrir cette part animale, naturelle, qui est en nous et que des siècles de moralisme nous ont condamnés à refouler.
La beat generation se définit donc d’abord par son aspiration à la libération des mœurs et d’abord de la sexualité. Mais elle se caractérise aussi par son attrait pour les cultures exotiques et pour les traditions éloignées de celles de l’Occident, acquis aux sirènes du progrès des techniques et du rationalisme productiviste. On sent d’ailleurs très nettement, dans le journal de bord de Moitessier, lorsqu’il décide de faire route vers la Polynésie, ce rejet de la modernité et des valeurs prométhéennes attachées à l’essor de la science et de l’industrie. «Je porte plainte contre le monde moderne», écrit-il le 1er mars 1969. Nul doute, par conséquent, que dans cette époque des années 1960, Moitessier ait pu devenir le héraut de ce rejet du monde industriel et capitaliste, de cette société qui, à ses yeux, ne jure que par le profit et par l’argent. Le navigateur, néanmoins, et c’est sans doute aussi ce qui a fondé l’influence qu’il a pu exercer sur la jeunesse, en particulier en France, ne s’est jamais pris pour un prédicateur. Ce n’est pas un homme de discours. Au lieu de s’abîmer dans la déploration, il est passé à l’action. Il ne s’est pas résigné à condamner le monde moderne. Il a pris la décision de le quitter, et il l’a fait. Mais attention, il n’a pas pris cette décision en prenant le départ de la première course autour du monde en solitaire. Quand il quitte Plymouth le 22 août 1968, c’est en comptant bien y revenir. Il la prend en mars 1969, après sept mois de mer, de solitude, de réflexion.
[1] Ensemble du matériel nécessaire à la manœuvre des navires à voiles.
[2] Échelle cotée de 0 à 12 degrés, proposée par l’amiral Beaufort en 1806 (modifiée en 1946), et utilisée pour mesurer la force du vent.
[3] Voile de grande surface, installée à l’avant du mât.
[4]Bernard Moitessier, La Longue Route, Éd. Arthaud, Paris, 1971, p.226.
Agrégé de philosophie, Claude Obadia enseigne à l'Université de Cergy-Pontoise, à l'Institut Supérieur de Commerce de Paris et dans le Second degré. Il a publié en 2011 Les Lumières en berne ? (L’Harmattan) et en 2014 Kant prophète ? Éléments pour une europhilosophie (éditions Paradigme – Ovadia). Il consacre ses recherches actuelles aux sources religieuses et métaphysiques du socialisme. Son blog : www.claudeobadia.fr.


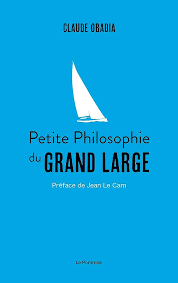
Commentaires
Bonjour,
Etre et, se trouver au grand large en mer, isolé en un point Némo est en soi une démarche philosophique ; une décition radicale inédite. Un changement de monde. Une nature fluide indomptable, la trainée d’un esquif furtive.
Un condensé de méditation, le lieu de l »éloge de la lenteur, le choix de larguer les chaînes qui retiennent à la terre, le goût de la curiosité et de l’aventure.
Un étalonnage de la peur et du courage, l’envie de se connaître, de visiter des géographies inconnues, Un lieu de réfléxion profonde, une totale remise en question, l’envie irrépressible de repartir quoiqu’il en fut.
par philo'ofser - le 25 septembre, 2023
Laissez un commentaire