Le narcissisme est-il un fléau si contemporain ?
ANALYSE : Lorsque je me photographie moi-même devant la Joconde, que fais-je ? que suis-je alors pour moi-même ? Est-ce narcissique, au point de penser que j’ajoute une plus-value à la photo du Portrait de Mona Lisa, que tout le monde peut trouver sur Internet ? Maxime Sacramento s’interroge : maladie contemporaine, tendance naturelle de l’homme, … les deux ?

Diplômé d’une maîtrise de Philosophie, Maxime Sacramento est professeur de lycée en Anjou. Auteur et conférencier, il s’intéresse à la philosophie antique, mais aussi à des thématiques contemporaines, comme Batman ou les jeux vidéos.
Nous le savons, l’amusante photographie dont l’objet est en même temps le sujet déclencheur de la prise de vue est ce que l’on appelle un selfie. Une photo de soi, prise par soi, afin d’être vue par soi et éventuellement par d’autres. Si l’on considère l’histoire picturale, force est de constater que la pratique de produire soi-même une image de soi n’est pas nouvelle. L’histoire de la peinture témoigne de cette volonté d’un certain nombre d’artistes de se peindre, ou sous la forme d’autoportraits, ou en s’intégrant de façon plus discrète dans d’autres œuvres. L’affranchissement de la maîtrise technique nécessaire à la reproduction de sa propre image n’a guère hissé vers le haut la production de l’autoportrait, en se démocratisant il a malheureusement vu sa valeur esthétique chuter de façon drastique. De la peinture au daguerréotype, puis de la transition de ces procédés photographiques primitifs vers l’appareil familial, à l’autofocus intégré dès les années 1970, produire une image n’a cessé d’être de plus en plus simple.
Lire aussi : De la photo d’identité à la photo de profil (Sandy Berthomieu)
Le bouleversement le plus profond n’est pas toujours celui que l’on croit, et ce n’est pas tant du développement de la photographie et de sa démocratisation que vient la révolution moderne mais de l’intégration des outils photographiques dans l’objet présent dans toutes les poches et jusque dans les plus intimes recoins de l’existence, je veux bien évidemment parler du téléphone portable. Si l’appareil photo était un appareil dédié, et de ce fait, n’était pas systématiquement embarqué avec l’individu, la quasi-nécessité de la connexion sociale téléphonique a fait de la fonction photographique du téléphone un vade-mecum (étymologiquement, qui va avec moi) que chacun emporte avec soi. Accessibilité et démocratisation ont donc accru le nombre de photographies de soi, mais ont également, fait chuter drastiquement la valeur moyenne des prises de vues et consacre la médiocrité du soi au rang d’icône.
Le téléphone portable, en tant qu’outil technique médiatise notre rapport au monde. Il est donc concerné au premier chef par ce que Régis Debray tient à étudier au travers de ce qu’il appelle la médiologie. Ce que celle-ci nous enseigne, c’est que le rapport au monde de l’individu, dont la philosophie, la science ou la religion ne sont que des cristallisations, dépend profondément des objets techniques par lesquels le sujet se saisit du monde qu’il entoure. Ce qu’il y a de curieux dans la modernité, c’est que l’appareil photographique, initialement destiné à reproduire l’apparence visible d’un paysage, d’un objet ou d’une personne a été très largement détourné, (devrions nous dire retourné ?), pour n’avoir comme objet principal que celui qui prend la photographie ! D’une certaine manière, personne n’imaginait un tel retournement de situation, et il faudra attendre trois générations d’Iphone, soit l’Iphone 4, pour voir apparaitre ce dispositif de prise de vue qui permet la réalisation du selfie (d’ailleurs aussi de la sextape).
Les origines du mythe de Narcisse
Si le narcissisme n’a jamais cessé d’exister, il me semble ressurgir de façon inédite avec ces nouveaux objets et ces nouvelles techniques. Pour comprendre ce qu’est le narcissisme moderne, il nous faudra d’abord, dans un premier temps, comprendre le mythe et le personnage de Narcisse pour ensuite étudier la disqualification du narcissisme permis et opéré par la philosophie platonicienne pour enfin étudier la réactualisation moderne de ce motif et les conséquences funestes d’un tel rapport à soi.

Le mythe de Narcisse est assez riche et raconté en bien des versions. Une des plus anciennes retrouvées serait issue des papyri d’Oxyrhynque en Égypte, composée en 50 avant Jésus Christ. Une version contemporaine de celle d’Ovide attribuée à Conon le grammairien serait malheureusement disparue. Pausanias, au deuxième siècle après Jésus Christ, en produirait une version rationalisante, dans la lignée des travaux d’Évhémère. Si une étude philologique en produirait une étude comparée, nous nous concentrerons, en ce qui nous concerne, sur la version proposée par Ovide, dans les Métamorphoses, texte composé au premier siècle après Jésus Christ et profondément empreint des thèses philosophiques de son époque. Résumons en quelques traits le mythe : l’Oracle affirme que Narcisse vivra vieux s’il ne croise pas son reflet. Malheureusement pour lui, au faîte de sa beauté, il rencontre son image sur les eaux. Il ne se reconnaît pas, de prime abord, dans cette apparence qu’il voit et dont il tombe amoureux. Ce n’est que plus tard, en comprenant que ce reflet est le sien et qu’il ne peut donc s’unir à celui qu’il aime, qu’étourdi par la colère il finisse par se languir jusqu’à la mort. Le mythe ainsi restitué, nous pouvons dorénavant avancer quelques interprétations. Commençons par étudier celle que Pierre Hadot reconnaît comme être celle de la tradition philosophique et qui fait du mythe de Narcisse un récit de transgression et de punition par la transformation :
« Toute la tradition est unanime : Narcisse, se voyant dans la source, croit voir un autre et tombe amoureux de cet autre sans savoir que c’est son propre reflet dans l’eau. La démence de Narcisse consiste précisément dans le fait qu’il ne se reconnaît pas et la punition dans le fait que Narcisse est voué ainsi à une passion et une soif qu’il ne pourra jamais assouvir. »[1]
Le drame du narcissique, c’est qu’incapable d’aimer autrui, il dévie cette pulsion amoureuse à son propre endroit. Quand bien même il céderait à l’onanisme, il ne peut consommer cette union avec lui-même. En effet, toute fusion suppose deux termes étrangers l’un à l’autre. Mais ici, le sujet et son image ne sauraient être distincts puisque la seconde émane du premier. Cet amour est mortifère, non parce que la déception qu’il entraîne est profonde et amère, non parce que la folie qui en est la cause est ivresse de soi, mais parce qu’éloignant du véritable amour, il avorte en lui-même la promesse de vie de l’union amoureuse des contraires. Loin d’être insufflée par Eros, une telle pulsion est bien plutôt l’œuvre morbide de Thanatos. En tant que déviance, le narcissisme est une aliénation paradoxale puisque loin d’être le signe d’une emprise d’autrui sur le sujet, elle est le témoignage d’un sujet prisonnier de sa propre apparence et incapable de se reconnaître. Hadot ne s’y trompe pas, en soumettant le mythe de Narcisse à la logique dionysienne, il le place sous l’horizon de l’hubrys. S’aimer-soi est, dans une certaine mesure, indubitablement nécessaire, au moins suffisamment pour préserver sa propre existence, mais lorsque c’est au détriment de l’affection que l’on peut offrir à autrui et refuser de prendre place au sein du cosmos en s’unissant, au prétexte de la passion sans borne portée à son propre égard, c’est faire preuve d’une démesure qui dans le contexte grec ne saurait manquer d’être punie. Et le tableau de Waterhouse montre à quel point Narcisse, malgré le monde qu’il a la chance d’habiter reste aveugle à ses beautés, obsédé qu’il est par sa propre apparence.
Il ne s’agit pas ici de dénoncer l’admiration qu’a Narcisse pour la beauté qu’il a reçu. Le plaisir que nous prenons dans l’admiration des choses belles est indiscutable. Mais l’attention que le jeune éphèbe porte à son apparence physique le détourne de la cause spirituelle dont elle est l’émanation. Il néglige alors le soin qu’il doit rendre à son âme, au profit de la contemplation de la beauté des formes inférieures que sont les formes matérielles. Et c’est cet oubli de l’être qui interdit toute remontée vers le principe spirituel qu’il faut, en tant que platonicien, fermement condamner. S’en tenir à ce que nous montre les apparences, c’est s’interdire d’accéder à la vérité de l’être qui est toujours placée au-delà du sensible, et quand bien même le sensible n’entrerait pas en contradiction avec l’idée dont il est l’émanation, en tant que signe, il ne délivre toute sa richesse que lorsque qu’il est placé sous l’horizon de ce à quoi il renvoie. La beauté plastique n’est aimable que lorsque qu’elle est rattachée à la beauté de l’âme humaine qui en dépend, qui elle-même dépend de l’âme du monde, et qui elle-même dépend de l’Être de l’Un qui est, qui lui-même dépend de l’Un, pour le dire dans le vocable employé par Plotin. Ce n’est qu’en vertu de cette remontée vers le principe, que les platoniciens nomment contemplation, que l’intellect humain s’accomplit conformément à sa nature[2].
La Belle et la Bête, un conte narcissique ?
L’image de soi, comme toutes les autres images, et plus généralement comme toutes les apparences sensibles ne sont que des reflets, des échos si l’on souhaite rester fidèle aux métaphores proposées par Ovide de réalités plus fondamentales que l’on appelle les idées. Elles sont aux choses matérielles ce que le modèle est à la copie. Dans le Timée, Platon rend Narcisse coupable de s’attarder sur son apparence physique et de la comprendre comme la réalisation ultime de son être, alors que ce à quoi il devrait s’attacher est bien plutôt son âme, cause et principe d’animation et de réalité de son propre corps. C’est parce que cet aveuglement est accompagné par la volonté et le désir qu’il devient une faute qui mérite d’être punie parce que cette confusion est inversion de l’ordre des réalités. En ce sens, le mythe de Narcisse n’est pas le seul à penser en ces termes l’opposition entre l’apparence et la réalité intelligible, le récit de La Belle et la Bête telle qu’il est formulé par Jeanne-Marie Leprince de Beaumont dans son manuel d’éducation Le Magasin des enfants publié en 1756, et plus encore sans doute par son interprétation dans l’adaptation cinématographique proposée par Gary Trousdale et Kirk Wise et produit par Walt Disney en 1991.

Le récit commence par une légende selon laquelle un prince doué de bien des qualités sensibles et régnant sur un royaume paisible eut à offrir l’hospitalité à une vieille femme repoussante. N’acceptant une telle laideur en son royaume, il la congédia en l’humiliant. Celle-ci dévoila alors sa véritable apparence, celle d’une fée resplendissante et aux pouvoirs magiques considérables. Pour punir le prince de son orgueil et de l’importance qu’il accordait aux apparences superficielles, elle lui jeta une malédiction qui le transforma en bête pour l’éternité. Sa seule chance de salut était alors de réussir à aimer et à se faire en retour, avant que les pétales de la rose magique qu’elle lui remit ne se fane. En refusant même de regarder la misère et la détresse de l’être en faiblesse, le prince témoigne de son égocentrisme et de son incapacité à vivre en charité. C’est pourquoi il est puni et reçoit l’apparence d’une bête. En le privant de figure humaine, la punition le rend semblable à la vieille femme dont il a méprisé l’apparence. On ne se privera pas alors de rappeler la thèse de Lévinas lorsqu’il affirme toute l’importance du visage dans la relation à autrui, en ce qu’il fonde la responsabilité absolue de l’homme à l’égard de son prochain : « le visage s’impose à moi sans que je puisse rester sourd à son appel, ni l’oublier, je veux dire sans que je puisse cesser d’être responsable de sa misère »[3].
Si le Prince a pêché par narcissisme en accordant à l’apparence physique une importance exacerbée, il doit être frappé en son apparence pour comprendre l’injustice qu’il a commis en refusant le gîte et le couvert à une vieille femme en raison de son apparence repoussante. Ce n’est qu’en faisant l’expérience de l’iniquité dont il s’est fait l’auteur qu’il peut la connaître et la reconnaître comme le mal objectif qu’elle est. Le dessin animé de La Belle et la Bête se destinant (sans exclusivité cependant) aux enfants, il faut le rapporter à sa dimension d’édification morale de la jeunesse. Montrer comment et en quoi l’importance accordée à l’apparence est fautive, c’est donner la possibilité aux plus jeunes de comprendre, ce qu’est le bien et leur donner les moyens d’agir selon ce principe. Chacun des personnages principaux du film est soumis à l’épreuve narcissique en étant confronté à son image à de nombreuses reprises illustrant ainsi des trajectoires aux origines semblables mais aux destinations diamétralement opposées.
Lire aussi : Hyperindividualisme ou néotribalisme ? Scénarios pour le monde de demain (Philippe Granarolo)
Gaston, jeune homme qui habite non loin de chez Belle dit d’elle : «Elle est la seule ici-bas / que je trouve digne de moi, / et je compte bien épouser cette demoiselle.»
La jeune femme n’est rien d’autre que l’objet par lequel il se valorise, elle n’est au fond, qu’un trophée de plus pour ce chasseur émérite. Au fur et à mesure du film, il comprend que Belle n’a rien d’autre que du mépris pour lui. Son narcissisme est ainsi mis à mal, incapable de supporter d’avoir été éconduit, il veut se venger et n’hésite pas à tenter de tuer sournoisement la Bête, alors même qu’il a été le témoin de la bienveillance de son adversaire. Dès son apparition, la jeune femme, qui est le protagoniste du film est présentée, par son nom lui-même comme la beauté incarnée. Refusant d’être réduite à cette apparence plastique, celle-ci cultive son intelligence et son imaginaire par la lecture. Cela n’est d’ailleurs pas sans exciter la curiosité et même la méfiance de ses voisins qui témoignent ainsi de l’opinion commune et de la valeur habituellement accordée aux apparences. Son mépris pour le dénommé Gaston, qu’elle qualifie de «analphabète basique et primaire», n’a d’égal que l’importance qu’il accorde à leurs beautés respectives. La puissance du mythe est manifeste lorsque celui-ci, à partir d’un ancrage antique daté, parvient, par sa richesse symbolique à infuser le champ culturel dans des proportions considérables. Pourtant, réduire le narcissisme à cette origine mythique me semble impossible et conduirait à négliger le travail philosophique moderne puis psychanalytique qui renouvelle l’interprétation de la figure de Narcisse.
On ne peut nier par ailleurs que l’estime de soi soit, au moins dans des proportions raisonnables, nécessaire pour permettre à l’individu de s’épanouir dans sa propre existence. Plus encore, on ne saurait nier que l’humanité se constitue dans et par la subjectivité, n’accorder strictement aucune valeur à sa vie propre, c’est à coup sûr la mettre en danger de façon inconsidéré et la laisser périr de désintérêt. Si l’on en croit le dictionnaire du Larousse, le narcissisme est l’amour excessif porté à l’image de soi. Cela signifierait donc, d’après la définition que nous propose Spinoza de l’amour dans l’Éthique, que le narcissisme est une certaine sorte de «joie accompagnée de l’idée d’une cause extérieure». Et là semble naître pour nous une première difficulté, puisque si nous ne pouvons aimer que ce qui est extérieur à nous, comment nous aimer nous-même ? N’y a-t-il pas là quelque paradoxe à ce que l’objet de l’amour, qui est précisément autrui, puisse glisser vers le sujet lui-même ?
Lire aussi : La tragédie du postmodernisme (Salim Mokaddem)
Selon Freud, le fond insondable d’où naissent toutes les perversions est nécessairement la vie sexuelle de l’individu. Le narcissique déplace l’excitation sexuelle qu’il a pour le corps de l’autre vers le sien propre. La translation s’opère de l’autre vers le même ce qui permet d’expliquer à la fois son dédain pour les autres jeunes gens quelle que puisse être leur beauté, et son attirance pour sa propre apparence. C’est dans cette double tension que se joue le nœud de la perversité narcissique. Narcisse n’accorde d’attention à l’autre que si celui-ci lui renvoie en retour, comme par écho, la reconnaissance qu’il souhaite récolter. Autrui n’est alors qu’un intermédiaire qui diffère l’affection qu’il se porte à lui-même et en se soustrayant à toute relation. Puisqu’il n’y a de prise en charge psychanalytique que dans un rapport authentique à l’autre, le malade narcissique se place du même coup hors de portée du thérapeute et semble être bien difficile à secourir.
Le mythe de Narcisse témoigne donc non seulement d’une confusion entre l’apparence et la réalité, mais surtout d’un rapport du moi au monde perverti par l’obsession égocentrique du narcissique ce que l’on retrouve parfaitement dans la définition ordinaire et connue de tous du narcissisme : il s’agit tout simplement de l’obsession qu’un individu nourrit pour lui-même au détriment de ses interactions sociales et de l’attention qu’il porte au monde qu’il entoure. Cette observation, loin de se rencontrer dans les cas sévères de narcissismes ou dans des troubles psychologiques plus graves se verra étayée par les observations sociologiques les plus simples, comme le rappelle Gilles Lipovetsky :
« Un nombre croissant de femmes déclarent aimer se maquiller davantage pour elles-mêmes que pour séduire. Dans un sondage datant de 2014, 50% de femmes affirment qu’elles se maquillent pour se donner confiance en elles-mêmes et seulement 16% pour plaire et séduire. »[4]
Et ces faits conduisent tout naturellement l’auteur cette analyse :
« À l’heure de la séduction souveraine, les femmes cherchent à s’embellir non plus seulement pour plaire à l’autre mais aussi à elles-mêmes : la séduction du rapport à soi a fait reculer la suprématie antérieure du rapport à l’autre. »[5]
Sans doute appartient-il au psychiatre de juger des éventuels effets délétères sur la santé mentale de la généralisation des symptômes narcissiques, toujours est-il que les effets sociaux et moraux du narcissisme sont trop importants pour ne pas être considérés et se contenter de s’en moquer, malgré le plaisir vil que cela peut procurer, n’est plus suffisant.
Notre narcissisme post-moderne
Si nous voulions caractériser notre post-modernité, il faudrait le faire, me semble-t-il, relativement aux outils qui ont singulièrement modifié notre rapport au monde. L’une des premières causes de l’importance prise par le narcissisme et permettant de rendre compte de sa floraison renouvelée est, me semble-t-il, la substitution métaphysique qu’observe déjà Feuerbach dans la Préface à la deuxième édition de L’Essence du christianisme que Guy Debord choisit de placer en exergue de son texte intitulé La Société du spectacle :
« Et sans doute notre temps […] préfère l’image à la chose, la copie à l’original, la représentation à la réalité, l’apparence à l’être… Ce qui est sacré pour lui, ce n’est que l’illusion, mais ce qui est profane, c’est la vérité. Mieux, le sacré grandit à ses yeux à mesure que décroît la vérité et que l’illusion croît, si bien que le comble de l’illusion est aussi pour lui le comble du sacré. »[6]
Ce à quoi assiste Feuerbach au début du XIXe siècle n’est rien d’autre que les prémices de l’inversion générale des valeurs que Friedrich Nietzsche va diagnostiquer dans l’ensemble de son œuvre et dont il rend pour partie responsable le christianisme et le Nouveau Testament. Où que l’on cherche en celui-ci, nous trouverons des propositions semblables à celles-ci qui permettent de témoigner de cette inversion. Cette manipulation du réel conduit, d’une certaine manière, à le rejeter, au profit d’une idéalisation de celui-ci. Ce que Nietzsche appelle l’arrière-monde, c’est le procédé par lequel on nie l’ici et maintenant au profit de ce qui devrait être. Cette substitution du double, de la copie, de l’apparence au réel lui-même revient à le nier et à le rejeter, comme ce que l’on ne veut pas voir, et que l’on ne veut pas regarder. Qu’il soit anonyme ou célèbre (et peut-être davantage dans ce dernier cas), ce n’est plus la vertu que l’honnête homme poursuit, mais l’apparence de vertu.
Lire aussi : Le « miroir des princes » : les primaires ne sont-elles qu’un duel narcissique ? (Alexis Feertchak)
De la même façon, on ne poursuit plus le bonheur, on se contente volontiers des indices de son apparence. L’essentiel des efforts des hommes ne reposent plus dans la conquête de quoi que ce soit de réel, mais dans la production d’apparences crédibles qui leur donneront la reconnaissance qu’ils attendent d’autrui. Ainsi, la pratique de la photographie dont attestent les selfies témoignent de ce recul volontaire que les hommes adoptent à l’égard de leur propre existence. Nous pourrions aller jusqu’à affirmer qu’ils refusent d’agir en acteur de celle-ci pour se réfugier dans la posture du spectateur contemplateur esthète de la vie qui est la sienne. Il semblerait cependant que la pensée de Debord ait été dépassée par l’accroissement sidérant du phénomène, à tel point qu’il faille parler aujourd’hui d’hyperspectacle, comme l’affirme Gilles Lipovetsky et Jean Serroy :
« On est dans l’hyperspectacle lorsque, au lieu de subir passivement les programmes médiatiques, les individus fabriquent et diffusent en masse des images, pensent en fonction de l’image, s’expriment et portent un regard réflexif sur le monde des images, agissent et se montrent en fonction de l’image qu’ils veulent voir projetée d’eux. »[7]
Si nous ne sommes pas insensibles à l’effet comique produit par les pratiques narcissiques de la modernité, affirmer que le selfie est un fléau n’est pas seulement une métaphore, mais une réalité concrète bien plus meurtrière que les attaques de requins ou le football américain. Il ne faut cependant pas s’y tromper, ces décès sont marginaux et bien que spectaculaires, ils ne sont pas le véritable danger que fait courir cette nouvelle forme de narcissisme. Ses effets sociaux délétères sont, sans doute, bien plus à craindre que ces manifestations dramatiques, mais au fond, anecdotiques. La série Black Mirror, dans l’épisode Nosedive, premier proposé par la troisième saison illustre parfaitement notre propos : Lucy, le personnage principal vit sa vie à travers l’interface que constitue son écran dans l’attente des récompenses sociales qui sanctionnent. Cette application ne s’arrête d’ailleurs pas à un simple Facebook ou à Instagram amélioré puisqu’elle intègre un système de notation qui détermine le niveau du rang social accordé à l’utilisateur, lui permettant ainsi de voyager dans de meilleures conditions ou d’accéder à des emprunts bancaires plus conséquents.
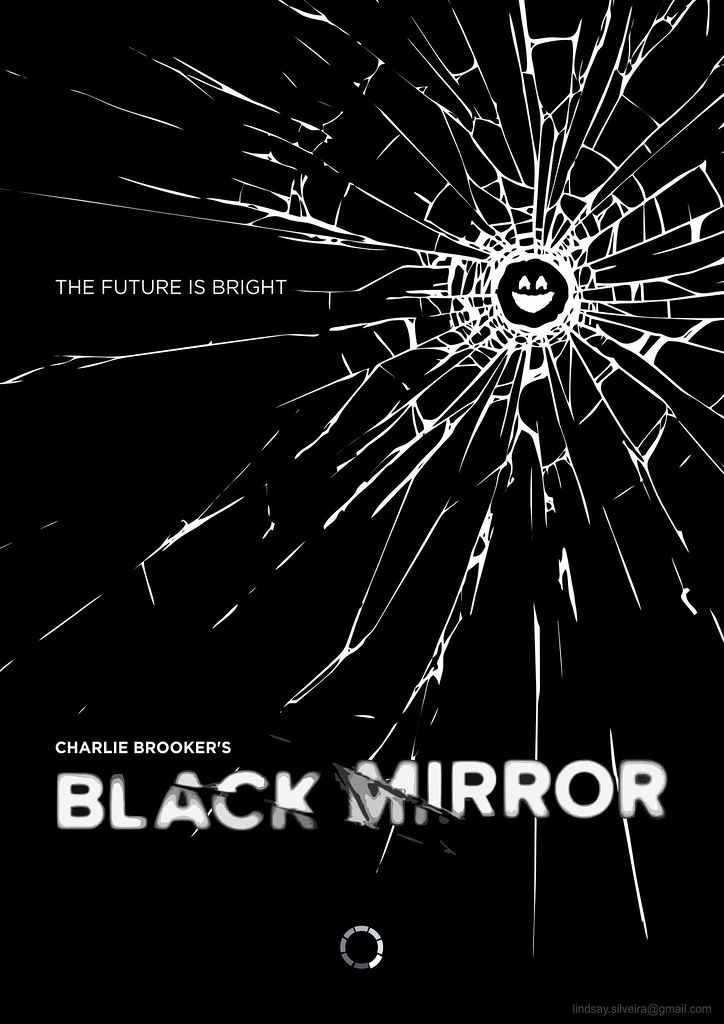
La discrimination sociale œuvre alors à plein régime dans un monde où la douceur et le rose pâle ne sont rien d’autre que les tonalités chromatiques des filtres que l’on superpose au regard que l’on porte sur lui. Faire de l’évolution technique le seul facteur du renouvellement du narcissisme serait une erreur, en effet, celle-ci conjugue ses effets avec les transformations sociales qui ont conduit, selon le sociologue américain Christopher Lasch au développement du travail de bureau en Occident :
« L’environnement interpersonnel surpeuplé de la bureaucratie moderne, dans lequel le travail revêt un caractère abstrait, presque totalement dissocié de son exécution, encourage et souvent récompense, par sa nature même, une réaction narcissique. »[8]
En effet, lorsque le travail devient abstrait, lorsqu’il devient difficile voire impossible de le quantifier par sa nature, les hommes ne s’évaluent plus entre eux par la quantité de travail qu’ils sont capables d’absorber, mais par leurs capacités à être suivis par d’autres hommes en suscitant chez eux l’admiration ou la confiance. Celle-ci ne s’acquiert plus par la bravoure au combat, l’habileté technique ou l’intelligence, mais par les signes de réussite que l’on est en mesure de produire. Ce vertige narcissique et toute l’enivrante séduction qu’il peut exercer sur nous est très clairement visible dans la série Mad Men, qui suit le mystérieux Don Draper, dont l’essentiel du temps de travail. Et il y a bien une pathologie du narcissisme au sens précis où celui-ci conduit l’individu oublie sa condition d’être social et sociable. Alors même que l’existence dont il jouit est toute entière garantie par la société, son aveuglement sur la réalité des rapports qu’il entretient avec autrui le conduisent à nier, au moins par son comportement autocentré, l’existence de l’autre. Il ne la nie pas en la refusant, il la nie en ne la reconnaissant pas, incapable qu’il est de donner la moindre valeur à ce qui lui est étranger.
Lire aussi : L’étrange dénouement du périple moderne (Salim Mokaddem)
Alors que plus que jamais l’homme est intégré dans une existence collective, et que de façon plus criante qu’auparavant, la satisfaction des besoins humains dépend d’un très grand nombre de ses semblables, l’individu moderne s’affirmant comme une totalité autonome, une partie du monde qui pourrait être comprise abstraction faite de l’ensemble physique et métaphysique dont il fait partie. C’est dans cet oubli de l’autre et du monde que l’individu se croit capable de saisir sa propre identité dans l’accumulation des représentations de sa propre apparence, comme si le collage en patchwork des différents visages qui ont été les siens suffisaient à épuiser ce qu’il était, et il se comprend ainsi comme une somme et non plus comme une partie en négligeant le monde dont il fait partie.
Il est fort intéressant de comprendre cela en revenant à notre exemple initial du selfie. Loin de me moquer à nouveau de cette pratique, celle-ci souligne notre propos. Que l’on s’immortalise à côté de La Joconde ou devant le Sphinx, ce qui compte est ce qui, sur chaque photographie restera identique. Celui qui se prend en photo, et qui, d’ailleurs, manifeste une très grande habileté à reproduire à l’identique l’apparence qu’il souhaite donner de lui. Le réseau social, comme dispositif de mises en relation d’individualités isolés, de monades, incapables de refléter le tout dont elles ne sont que des parties, est une construction technique qui, en tant qu’elle flatte la pulsion morbide de l’idolâtrie du soi, amoindrit la capacité sympathique de l’homme tout en niant sa dimension d’être social et sociable. Cet engagement que j’ai à l’égard de mon semblable n’a d’autre source que la reconnaissance de l’humanité dans le visage d’autrui, c’est en tout cas une des thèses essentielles avancées par Lévinas dans son œuvre en général et qu’il souligne dans l’entretien avec Anne Catherine Benchelah publié sous le titre Altérité et transcendance :
« La sociabilité est cette altérité du visage, du pour-l’autre, qui m’interpelle, voix qui monte en moi avant toute expression verbale, dans la mortalité du moi, du fond de ma faiblesse. Cette voix est un ordre, j’ai l’ordre de répondre de la vie de l’autre homme. Je n’ai pas le droit de le laisser seul à sa mort. »[9]
Le paradoxe est d’autant plus grand, que le livre des visages, traduction littérale de Facebook est précisément négation de la singularité d’autrui et derégulation de la responsabilité que j’ai à l’égard de l’autre. Pour l’utilisateur du réseau social, Facebook, Instagram… l’autre n’est plus que l’image d’autrui. Par l’intermédiaire du dispositif technique de la mise en réseau, autrui n’est rien d’autre que son image, et dans cette réduction, c’est la responsabilité que j’ai à son égard qui disparait. La multiplicité et la multitude des visages affichées nous conduit à oublier la singularité de chacun. N’est-ce pas ce dont témoignent les applications de rencontre réduites à leur plus stricte dichotomie entre validation et rejet ? Tinder, c’est le nom de l’une d’entre elles propose de swiper, glisser la photo vers la gauche pour l’écarter et glisser la photo vers la droite pour la retenir. Lorsque les deux interlocuteurs se valident mutuellement, l’application propose le dialogue. Cherche-t-on alors à rencontrer autrui, où ne veut-on qu’être validé par lui dans l’autosatisfaction narcissique ? Cherche-t-on seulement à séduire ou ne convoite-t-on que la validation de notre apparence extérieure ? Si la deuxième hypothèse semble devoir être favorisée, ne fait-elle pas de mon prochain le moyen quand il devrait être une fin ?
Pour éviter qu’autrui ne soit que le faire valoir de ma propre obsession pour moi-même, il faut s’arracher au culte de sa propre apparence, non pas seulement pour mon propre bien, mais comme condition de possibilité d’un authentique être-ensemble. Si le XXe siècle a été celui des idéologies, certains croient que le XXIe siècle verra le retour du religieux, je crois pour ma part que loin de ces grandes idées, le siècle à venir sera déterminé par les innovations technologiques, non pas tant en ce qu’elles amélioreront notre existence, mais en ce qu’elles feront disparaitre ce qu’était jusqu’ici l’existence humaine. Parce que le narcissisme, comme pulsion dynamique et constante, nous conduit à attacher toujours plus d’importance et d’attention à notre propre apparence et à lui consacrer tout le soin que nous devrions consacrer à notre vie intérieure, il ne peut être considéré comme un petit travers ridicule de notre modernité. Au contraire, il me semble être une de ses déterminations les plus saillantes et les plus déterminantes.
Comme nous alerte Matthew Crawford dans son récent livre Contact, l’interface technique a pris une telle importance qu’elle en vient à déterminer le cadre métaphysique dans lequel l’idée même de monde prend naissance. En tant que telle, la médiatisation disparait tout en continuant d’agir, comme si nous l’avions incorporé, elle devient alors dispositif intégré et déformant de notre rapport à nous même, tout autant que de notre rapport au monde.
« C’est avant tout dans l’interaction sociale que nos facultés mentales se développent, et c’est apparemment ce qui, simultanément, garantit la communicabilité mutuelle du contenu de nos esprits et structure la façon dont nous appréhendons conjointement le réel. »[10]
L’oubli du monde, en même temps que l’oubli de l’autre contribue à renforcer le moi, l’ego, dans des proportions morbides qui compromettent jusqu’à la possibilité de l’existence sociale. En ce sens, le narcissisme est pathologique en ce qu’il détourne l’individu du monde qui l’entoure et qu’il lui fait oublier jusqu’à ce dont il a besoin pour vivre. Je veux, à défaut d’avoir trouvé un remède, participer à en établir le diagnostic.
[1] Hadot, Plotin, Porphyre, Chapitre 15, Éd. Gallimard, Paris, 1999.
[2] Plotin, Traités, I, 6, Sur le Beau, Éd. GF Flammarion, Paris, 2002.
[3] Lévinas, Humanisme de l’autre homme, Éd. Fata Morgana, Paris, 1972.
[4] Lipovestky, Plaire et toucher – essai sur la société de séduction, Éd. Gallimard, Paris, 2017.
[5] Ibid.
[6] Debord, La Société du spectacle, §1, Éd. Gallimard, Paris, 1992.
[7] Lipovestky et Serroy, L’Esthétisation du monde – vivre à l’âge du capitalisme artiste, Éd. Gallimard, Paris, 2014.
[8] Larsh, La culture du narcissisme, Éd. Flammarion, Paris, 2006.
[9] Lévinas, Altérité et transcendance, Entretien avec Anne-Catherine Benchelah, Éd. Le Livre de Poche, Paris, 1995.
[10] Crawford,Contact, Éd. La Découverte, Paris, 2015.
Maxime Sacramento est professeur de philosophie en Anjou et titulaire d’une Maitrise en philosophie. Auteur et conférencier, il s’intéresse particulièrement à la philosophie antique, mais aussi à des thématiques contemporaines, qu’il s’agisse de Batman ou des jeux vidéos.


Commentaires
Il me semble que le selfie relève surtout de la quête d’identité de personnes noyées dans un monde qui se caractérise par l’hyperconnectivité, l’instantanéité, la vitesse, le changement permanent, l’accélération sociale, l’accélération technologique, et l’accélération de nos rythmes de vie. Comme si on cherchait à suspendre le temps.
par Calvo - le 11 juillet, 2020
Ce texte est long et dense. Je vais peut-être m’offrir le luxe de revenir en faire un autre commentaire…
Le selfie… la REPRODUCTION d’une image.
On a la reproduction qu’on.. peut, n’est-ce pas ?
Quand je songe à toute la belle poésie du 16/17ème siècle, dont des sonnets de William (Shakespeare) où il est question de.. reproduire son image en engendrant un/une autre pour la postérité, je crois que le problème est bien posé, là…
Et on rejoint le mythe de Narcisse par la même occasion.
Il m’est arrivé de dire à de jeunes amis que le plus beau miroir dont on dispose est les yeux de son amoureux, et je crois que c’est vrai.
Il n’est pas mauvais de pouvoir s’aimer aussi…
Je ne sais que penser d’un mouvement d’âme qui voudrait qu’on ne soit… RIEN à ses propres yeux afin d’être.. TOUT.. aux yeux de l’amoureux ? l’ami ? Dieu lui-même ?
Le ou exclusif est si perfide…
….
Dans la même veine, et avec Levinas, Lacan parle du stade du miroir comme le moment où l’enfant se découvre sujet en se regardant dans la glace, et dans les yeux de sa mère, en entendant son nom. Il se rassemble, en quelque sorte.
Avant même les photos, le miroir a troublé notre rapport à nous-même… mais ça remonte à très loin. Il est bon de savoir que les miroirs ont été des objets de luxe, réservés à un petit nombre, en remontant dans le temps. Comme quoi la démocratisation de la richesse n’a pas que des avantages…
par Debra - le 14 juillet, 2020
J’ai promis de revenir ici, et je le fais.
Ce matin, j’ai sorti mon Ovide, « Les Métamorphoses », pour lire de manière attentive le mythe de Narcisse.
Première découverte, et non les moindres : « Les Métamorphoses » ne parle pas de Narcisse seul, mais le lie avec Echo, la nymphe qui jacassait tellement en répétant ce que disaient les autres qu’elle s’est fait punir par Junon, qui l’a réduite à faire le mainate, sans pouvoir INITIER une conversation, un sujet, mais contrainte de… faire des copier/coller de ce qu’elle entendait, en n’en répétant que les derniers mots (parce qu’elle ne retenait que ça ?).
Un vrai enfer, être contraint de passer son existence à.. « produire » des copier/coller, je trouve. En tout cas, pour Ovide, c’était un enfer. On peut le comprendre…Il était un vrai auteur, je crois…
Donc.. il me semble que si Ovide a parlé de Narcisse en lien avec Echo, ça voudrait dire quelque chose, et pas simplement qu’Echo était amoureuse de Narcisse.
Ovide dit aussi que Tirésias avait prédit que Narcisse vivrait vieux tant qu’il ne se « connaissait pas »… Il se pourrait que j’aille voir exactement quel mot latin Ovide a employé pour « connaître », mais d’emblée, cette formulation me fait penser à quelque chose qui devrait faire réfléchir (!!) les phisolophes en tous genres…
De quelle « connaissance » s’agissait-il ?
Ovide précise qu’à l’âge de 16 ans, Narcisse semblait autant un garçon qu’un homme (?) et que jeunes hommes ET FEMMES souhaitaient être aimés de lui.
Dans la rencontre de Narcisse avec Echo, Ovide met l’accent sur l’horreur que le jeune homme éprouve A ETRE TOUCHE par une femme, et sa fascination pour… la chasse, activité préférée de Diane, la déesse VIERGE, par excellence…une vraiment pas commode, capable de mettre des gens en morceaux ((hommes ou femmes, d’ailleurs)) par accès d’humeur).
Les jeunes gens qui éprouvent cette conjugaison (horreur de toucher, fascination pour la chasse solitaire) finissent mal dans la mythologie greco-romaine, dans l’ensemble. Il est entendu qu’ils ont des attitudes.. CONTRE NATURE… et que cela ne PARDONNE PAS.
Donc, en rencontrant Echo, Narcisse s’exclame : « Non, non, vous ne devez pas toucher, enlever vos mains, QUE JE SOIS MORT avant de sentir vos terribles chaînes autour de moi ! ». Ovide précise que ce rejet brutal par Narcisse conduit Echo a devenir une pâle ombre désincarnée. (Tout rapprochement avec notre situation actuelle d’horreur du toucher, par exemple, est.. voulu.)
Mais c’est après un autre rejet que Narcisse, objet de malédiction d’un amoureux dépité, éveille Némésis, et rencontre la punition de son attitude contre nature. Punition qui le rencontre, bien entendu, à l’endroit où il pèche… contre nature.
Un jour, épuisé par la chasse, la chaleur, et la soif, il rencontre un étang où « jamais berger, ni chèvre, ni bête sauvage, ni feuille, ni oiseau s’aventuraient, un endroit que le soleil ne chauffait jamais, et dans le désir d’éteindre sa soif, il se penche pour boire, mais en buvant, il sent naître une autre soif, la beauté enchantée et enchanteresse le piège. Il aime l’image qu’il pensait être ombre, au point d’être frappé et de ne pas pouvoir parler, LUI MEME L’ADORE ET L’ADORATEUR. Il s’est cherché/chassé, et était lui-même cherché/chassé….Seul le miroir regardant de réflexions remplissait ses yeux, un corps qui n’avait aucune substance de lui-même, une ombre qui venait, restait, et partait avec lui… s’il pouvait la quitter… »
« Je suis enchanté, ensorcelé par ce que je vois, et il se dérobe à moi…ni montagne, ni mer, ni remparts nous séparent… seulement cette voile d’eau. Viens à moi, o beau garçon, où partez-vous quand je cherche à vous embrasser ? Au moment où je tends les bras vers vous, vous me les saisissez presque…je hoche la tête vers vous, et vous répondez de même…Que dois-je faire ? Suis-je l’aimé ou l’amant ? Pourquoi donc faire l’amour ? Puisque je suis ce que je désire, alors mes richesses sont si grandes qu’elles me rendent pauvre. O, puissé-je choir de mon propre corps…et que mon aimé s’éloigne de moi… Et alors, l’amour vide ma vie de sa substance.
Il parlait ainsi et faisait face à l’IMAGE QU’IL AVAIT FABRIQUE LUI-MEME » de lui-même…
…
J’arrête là. Le récit entier est dans le 3ième livre des Métamorphoses. Il mérite d’être lu et… bien entendu, médité.
…
A la lumière de ce récit, je crois pouvoir dire que les deux sources, greco-romaines, et bibliques, mettent en garde contre les dangers de l’idolâtrie, à comprendre comme une attitude envers l’image qui conduit à se déprendre du monde pour se mouvoir dans un univers d’images fabriquées par soi-même et pour soi-même. Et cela veut dire, non seulement les dangers des « selfies », mais les dangers de la démocratisation de la photographie elle-même, qu’elle soit de soi, ou d’autres. Les dangers… du monde VIRTUEL.
Narcisse s’abime dans l’admiration de l’image du même, et l’image du même est désincarné, et surtout, écarte la possibilité de rencontrer un autre, DIFFERENT DE SOI.
Les richesses de la littérature surpassent les piètres concepts d’égoïsme, ou autre chose encore, que nous avons fabriqués pour essayer de rendre compte de ce qu’Ovide dit… bien mieux. A mon avis.
par Debra - le 22 juillet, 2020
Bonjour,
Merci pour cette réflexion qui m’a beaucoup intéressée. J’ai particulièrement aimé la fin, avec la référence à Lévinas, aux visages, à Facebook et à la perte de la singularité. Le selfie n’est qu’un renvoi au self, mais pas au myself. Ça m’a fait penser à Heidegger et sa réflexion sur la vie inauthentique : vivre sur le mode du « on », car les poses pour des selfies réussis sont très codifiées. Une façon de cacher la nudité du visage, dirait sans doute Lévinas.
Bonne continuation !
par AL - le 30 juillet, 2020
[…] aussi : Le narcissisme est-il un fléau si contemporain ? (Maxime […]
par iPhilo » Le miroir, objet philosophique - le 4 janvier, 2021
[…] aussi : Le narcissisme est-il un fléau si contemporain ? (Maxime […]
par iPhilo » Les hobbits, personnages conceptuels – essai sur «Le Seigneur des anneaux» - le 15 février, 2021
[…] Publication éclairante à l’heure du selfie et des réseaux sociaux, à lire ici -> https://iphilo.fr/2020/07/11/le-narcissisme-est-il-un-fleau-contemporain-maxime-sacramento/ […]
par Le narcissisme est-il un fléau si contemporain ? - le 13 novembre, 2023
[…] Publication éclairante à l’heure du selfie et des réseaux sociaux, à lire ici -> https://iphilo.fr/2020/07/11/le-narcissisme-est-il-un-fleau-contemporain-maxime-sacramento/ […]
par Le narcissisme, un fléau si contemporain ? - le 28 mai, 2024
Laissez un commentaire