Piotr Rawicz et la Shoah comme métaphysique
LECTURE : Ecrit a posteriori, et pourtant au cœur de la destruction, Le sang du ciel (1961) de Piotr Rawicz, déporté en 1942 à Auschwitz, pilonne toutes les idées reçues sur la Shoah, explique Didier Durmarque. Pour ce spécialiste du génocide des Juifs, le sommet philosophique de ce texte est double : l’auteur fait de la Shoah une question de métaphysique, tout en faisant de la métaphysique le lieu de l’effondrement de Dieu, du commandement de la parole à sa désintégration.
 Professeur de philosophie en Normandie, Didier Durmarque anime également un séminaire à l’Université populaire de Caen, où il se prononcera cette année sur le thème : « Bilan métaphysique après Auschwitz: les écrivains incandescents ». Spécialiste de la Shoah, il a publié La Liseuse (éd. Le rire du serpent, 2012), Philosophie de la Shoah (éd. de L’Âge d’homme, 2014) et Enseigner la Shoah : ce que la Shoah enseigne (éd. Uppr, 2017).
Professeur de philosophie en Normandie, Didier Durmarque anime également un séminaire à l’Université populaire de Caen, où il se prononcera cette année sur le thème : « Bilan métaphysique après Auschwitz: les écrivains incandescents ». Spécialiste de la Shoah, il a publié La Liseuse (éd. Le rire du serpent, 2012), Philosophie de la Shoah (éd. de L’Âge d’homme, 2014) et Enseigner la Shoah : ce que la Shoah enseigne (éd. Uppr, 2017).
Sur la Shoah, une œuvre fictive est-elle légitime, souhaitable et justifiée ? Recouvre-t-elle ou révèle-t-elle l’événement ?
L’événement n’est-il pas inhérent à la construction historique, au passage nécessaire, mais construit, du fait, comme cours de l’histoire, à l’historiographie comme écriture de l’histoire ? La question n’est pas surfaite. Elle est plutôt récurrente. Dès l’instant où l’on croit en avoir fini avec elle, elle revient comme un boomerang.
En face de la question posée s’impose un dogme qui est, en tant que dogme, son propre fondement. Le caractère lancinant et insistant de ce dogme pose l’idée d’une profanation de l’événement historique, dès l’instant où l’on fait de la Shoah autre chose que de l’histoire.
L’argumentation est soit d’ordre ontologique, on ne peut témoigner au cœur de la destruction ; soit morale, on tue une seconde fois les victimes en recouvrant leur destruction par autre chose ; soit épistémologique, il n’y a de connaissance de la Shoah que par et dans l’histoire.
En somme, la littérature de la Shoah quand elle ne prend pas l’histoire comme condition nécessaire, c’est-à-dire l’écrit des naufragés et des rescapés des camps, pour reprendre une expression de Primo Levi, est impossible, déplacée ou indigne d’une réelle connaissance de la Shoah.
Ce qui est en jeu est finalement résumé par la formule que Claude Lanzmann a adressée, un jour, à Raul Hilberg : « Faut-il une œuvre d’art pour montrer la Shoah ? » Faut-il une création qui part de l’imaginaire pour montrer ce que la construction de l’événement historique ne peut montrer comme telle ?
Lire aussi – Pourquoi nommer la Shoah ? Nommer une chose, c’est la désigner dans son être (Didier Durmarque)
Au cinéma, ce dogme vient d’être récemment transgressé par Le fils de Saul de Laszlo Nemés. On peut d’ailleurs voir, dans le succès critique de ce film, comme un soulagement face à un acte créateur et artistique que l’on a parfois considéré comme une profanation du devoir de mémoire, voire comme un interdit. Essayons d’expliciter cet interdit et de le mettre à l’épreuve.
Cet interdit est posé là où l’histoire a assumé le passage du fait, lié au cours de l’histoire, en événement, lié à la construction du fait historique, et a renoncé à se construire sur le modèle des sciences de la nature. Ce passage du fait en événement montre que la compréhension, liée à l’idée même de science humaine, achoppe sur une difficulté centrale, c’est-à-dire sur la démesure, sur la puissance, à la fois organisationnelle et destructrice, d’un événement humain où l’homme doit se comprendre lui-même.
Bien plus, ce dogme et cette compréhension historique butent sur des conduites anthropologiques inédites, donc incompréhensibles immédiatement, conduites qui posent une idée nouvelle de l’homme, où les actes ne reposent plus seulement sur des individualités, sur des motifs individuels comme le racisme, l’antisémitisme, mais sur une obéissance à l’autorité, le conformisme et la segmentation des activités, où celui qui agit n’est pas celui qui décide. L’œuvre philosophique de Günther Anders, les expériences psychosociologiques de Milgram et de Zimbardo ont dit l’essentiel de ce passage qui marque, selon l’expression d’Anders, une obsolescence de l’homme.
Lire aussi – Günther Anders : l’obsolescence de l’homme et la question du nihilisme moderne (Didier Durmarque)
Ce dogme autour de la Shoah, répété par les plus grands spécialistes, repose sur l’idée selon laquelle la littérature de la Shoah est une expression oxymorique, voire contradictoire. Ce que le passage du fait historique en événement ne peut révéler, la littérature, a fortiori celle qui n’atteste d’aucun témoignage historique, ne peut prétendre surmonter les difficultés épistémologiques inhérentes à la connaissance de la destruction des Juifs d’Europe.
En 1977, Elie Wiesel argumentera en faveur de cet interdit, sous une forme quasi-syllogistique, déductive, de sorte que l’hypothèse et l’expression d’une littérature de la Shoah n’a rien pour elle :
« La littérature de l’Holocauste ? Le terme même est un contresens. Qui n’a pas vécu l’événement jamais ne le connaîtra. Et qui l’a vécu jamais ne le dévoilera. Pas vraiment, pas jusqu’au fond (…) La littérature de l’Holocauste n’existe pas et ne peut pas exister. Auschwitz nie toute littérature comme il nie tous les systèmes, toutes les doctrines. »
Cet interdit était pourtant loin d’aller de soi, d’être intuitivement évident. Il faut rappeler que, dès 1947, David Rousset choisit la forme littéraire, « par méfiance des mots » pour témoigner des camps, de l’impensable, au cœur de la destruction dans Les Jours de notre mort.
L’argument de Wiesel ne tient pas sur le respect absolu et incontestable de l’historiographie de la Shoah, mais sur l’impossibilité de témoigner au cœur de la destruction, impossibilité qui semble pour le moins étonnante, lorsqu’on sait que nombre de manuscrits de Sonderkommandos ont été retrouvés enterrés, à proximité des chambres à gaz de Birkenau.
Cette impossibilité ontologique d’une littérature de la Shoah est répétée, dans un même mouvement discursif, entre autres, par Jean-François Lyotard, en 1983, puis par Annette Wievorka dans sa thèse de doctorat, Déportation et génocide, de 1991.
Le grand texte résout des problèmes posés après lui : fulgurance du sang du ciel de Rawicz
Or, tout se passe comme si cet interdit, posé, justifié, déduit géométriquement selon l’ordre des raisons, était balayé à l’avance par la publication de 1961, de Piotr Rawicz, Le sang du ciel.
Torturé par la Gestapo, déporté en 1942 à Auschwitz, non en tant que Juif mais en tant qu’Ukrainien, sous le nom de Peter Heller, avec le matricule 102679, Piotr Rawicz fait partie d’un groupe de déportés, transférés en septembre 1944, d’Auschwitz à Leitmeritz, en Bohême, jusqu’en mai 1945.
Le personnage de Boris du sang du ciel, qui cherche à se faire passer pour un goy, opéré du phimosis, et donc victime d’un malentendu, n’est évidemment pas sans écho avec son parcours personnel, particulièrement avec l’idée selon laquelle la question de l’Être, question métaphysique par excellence, n’est qu’une histoire de queue. Il est remarquable que le titre initial de l’œuvre de Rawicz était la queue ou l’art de comparer, titre qui effraya Gallimard.
Ecrit a posteriori, et pourtant au cœur de la destruction, se déroulant dans une Ukraine imaginaire, et pourtant plongé dans le trou béant de la persécution des Juifs d’Europe, le sang du ciel de Rawicz pilonne, une à une, toutes les idées reçues et actées sur la Shoah. Radicalement, il met à l’épreuve les structures de notre rapport au monde et à la mémoire, à savoir les questions de l’identité, de l’existence, de l’esthétique du témoignage, et en définitive, de l’idée de Dieu.
La question de l’existence a pour pli celle de l’infini
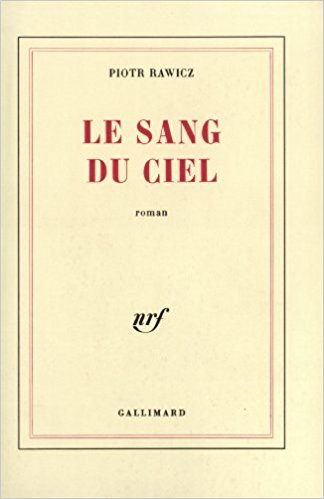
Plus fondamentalement, l’écriture de la Shoah, chez Rawicz, se confronte perpétuellement à deux sortes d’infinis, l’infiniment petit et l’infiniment grand, le cafard, sorte de métonymie du Juif, et Dieu, le prétendu infiniment grand, l’imposteur qui délaisse, le silencieux lové dans sa propre béance.
Boris, sorte de synthèse entre un Lautréamont et un Stavroguine de la Shoah, traverse la dévastation des Juifs d’Europe comme la fin d’un monde, celui de la pensée et de la civilisation, celui des humanités.
Dans ce va-et-vient, dans cette bipolarité de l’infini a lieu la naissance d’une nouvelle affirmation de l’existence, d’un nouveau cogito qui, à l’antipode de Descartes, repose sur le surgissement d’un monde menaçant, en face de soi :
« Au milieu d’une rue vide, chancelant sur ses pieds, un homme dont nous n’apercevons pas le visage, pousse des cris :
– Femmes, hommes, ténèbres, Dieu, vite, vite, plus vite que ça, accourez à mon secours, armez-vous de toutes vos pitiés : un mal inédit s’est abattu sur moi, un malheur entre tous honteux et unique : je suis né. J’existe. »
Mais cette existence n’est jamais apparentée à une connaissance de son identité, mais plutôt à son effondrement :
« Cette charpente sur laquelle Dieu a étendu l’innommable chiffon que – dans mes expériences quotidiennes qui durent depuis trente ans – j’ai pris l’humiliante habitude d’appeler « MOI » ?
Un cri retentit dans la ville :
Vous autres, vous tous, qui n’êtes pas moi, périssez donc, mourrez, crevez !
Dieu m’a exaucé : vous êtes tous là, debout, vous n’êtes pas morts. Donc, c’est que vous l’êtes, c’est que vous êtes – MOI.
A mes ennemis.
(et vous tous, vous l’êtes) :
Vivez éternellement. Et à moi, laissez-moi, à moi tout seul, la douce grâce de mourir. Dieu l’a offerte à l’homme dans Sa grande pitié. Lui-même. Il subit, paraît-il, l’immortalité, l’immortalité cruelle. Le pauvre… »
Chez Rawicz, le sujet ne peut se saisir lui-même que s’il répond à la question de l’infini, de Dieu. Sauf que chez Rawicz, Dieu prend la figure d’un imposteur, d’une figure à mi-chemin entre le Dieu de la parole juive et celui dé-laissant de la pensée gnostique.
On retrouve la figure des deux infinis, Dieu et cafard, dans ce long passage, presque insoutenable, où le silence de Dieu fait face aux cadavres humains mangés par les porcs.
« Il y avait une fois un cafard. Mais ses yeux n’étaient point ceux d’un cafard ou alors, s’ils étaient bien ceux d’un cafard, moins ignobles tout de même que vous ne l’eussiez imaginé. Sa vie passée n’était pas démesurément belle. Tout ce qu’il y a d’authentique : la vie d’un cafard.
Mais ces derniers temps, depuis son arrivée à S., ce n’était plus « la- vie- d’un-cafard », mais bien le processus de l’écrasement d’un cafard. Chaque jour et à toute heure – le processus continue. La carapace craque et se déchire. Les tripes blanchâtres sortent et commencent une existence autonome qui remplirait de frayeur même un cafard… bien portant.
Si ce n’étaient ces cris perpétuels : tue-le, tue-le ! »Son bégaiement se muait en vrai balbutiement et je n’ai plus retenu que quelques mots isolés :
« Le corps de l’histoire
Dévoré par les cafards
En vouloir aux cafards
Qu’ils ne soient que cafards…
…Mais c’est un rang élevé ! »Et encore :
« Des phénomènes sucent l’heure crasseuse
(l’heure tombée sans fracas)
Comme des mouches rouges
Sucent le cadavre d’un chat aveugle. »
Préférez-vous une autre version, Monsieur, fit-il :
« Des faits, des faits, des événements
Grouillent sur chacune de ces heures crasseuses
Qui tombent, qui tombent de l’arbre du temps.
Ils grouillent comme des mouches
Dans le cadavre d’un chat aveugle… »
Pourquoi « aveugle », pourquoi « aveugle » me suis-je demandé ou alors ai-je demandé au lieutenant qui, pantelant et échauffé par la lecture, attendait de moi une réponse ou une critique. La bouteille de mauvais cognac était vide.Noëmi, qui jusque-là avait gardé presque tout le temps le silence, dit avec un sourire narquois : « Vous êtes comme des frères. »
L’intimité qui s’établit dans la pièce était comme palpable. Par un effort difficile et conscient, je me levai de mon siège en écartant la main de l’officier qui cherchait encore à me retenir. Je touchais de mon front ardent la vitre froide de la fenêtre donnant sur la petite cour. Et brusquement, comme un fouet de cirque, un réflecteur éclaira le décor. Le paysage minuscule et lunaire frappa mes tempes comme une massue. Je freinai une brusque envie de vomir. Ce n’étaient point des têtes de choux qu’étaient en train de lécher et de manger les porcs. Cinq hommes étaient enterrés debout dans le petit jardinet adjacent à la cantine. Leurs têtes salies, couvertes de poussière humide et de choses innommables, leurs têtes à moitié dévorées sortaient du sol tels de géants champignons. Une de ces têtes aux orbites vides venait d’effectuer un mouvement circulaire, nettement perceptible.D’un geste violent et inconsidéré je brisai la vitre et me penchai au dehors. Et avant de sentir le canon froid de révolver sur mon front moite, je réussis à entendre une parole humide, mi-râlée mi-chantée qui venait de loin, de plus loin que les astres : « Ecoute mon peuple, Dieu est ton Seigneur, Dieu est unique… »
Le sang coulait de ma main blessée. Avec une force et une détermination qui me parurent surhumaines, le sous-lieutenant m’attirait vers le milieu de la salle. Noëmi s’était abattue de tout son poids sur la main qui tenait le révolver. C’était la difficulté suprême, définitive, comme pour un impuissant celle de créer un monde. »
L’infini ou la métaphysique de la Shoah comme « histoire de bites »
Le sommet philosophique du texte de Rawicz est double : l’auteur fait de la Shoah une question de métaphysique, tout en faisant de la métaphysique, non pas le lieu de la puissance de la pensée en adéquation avec l’Être, dans une opération de dévoilement, mais le lieu où la circoncision, symbole de l’Alliance, est le lieu de l’effondrement de Dieu, du passage du monde à l’immonde, passage du commandement de la parole à sa désintégration. Tout se passe comme si la conception rawiczienne de la Shoah remplaçait la révélation du Sinaï et annonçait la fin d’une civilisation au profit d’une autre, où l’homme et Dieu deviennent révolus et finissent à la queue de la Création.
« – Regardez-moi donc cette queue ! Avec un engin comme ça, il veut se faire passer pour un des nôtres, pour un Youri Goletz. Trop d’honneur ! Sais-tu seulement faire le signe de croix ? …espèce de petit malin… Attends, ne la cache pas si vite, ta petite queue. Nous allons l’examiner. Comme ça. Et où donc ton prépuce ? Regarde ma pine à moi, tu ne vois pas la différence ?
Boris fixait l’objet du litige : c’était donc ça l’instrument, le pauvre instrument de toutes ses métaphysiques passées ? De toutes ses métaphysiques qui lui paraissaient jadis tellement personnelles, tellement uniques et qui, aujourd’hui n’étaient pas plus à lui que les tripes d’un cafard écrasé ne sont « individuelles » par rapport aux tripes d’un autre cafard écrasé ? »
Ainsi, ce qui était Alliance devient blessure, déchirure de l’être, passage d’une bénédiction à une malédiction. On peut parler, sans se méprendre, d’a-diction de l’Être, à la fois sortie du Verbe et dépendance, sachant que la métaphysique ne passe plus par la parole mais par le délaissement du Juif, métaphore de la condition humaine. Par la circoncision, ce délaissement prend donc la forme d’une histoire de bite.
Par une phénoménologie de la circoncision qui traverse la fin du roman, circoncision étudiée avec une rigueur scientifique, saupoudrée abondamment d’ironie, Rawicz montre donc que le signe de l’Alliance n’a aucun contenu comme objet de perception, de sorte qu’elle peut être apparentée à une maladie de l’Être, apparence sans apparaître, apparence sans apparition, mésalliance ou phimosis.
Dans tous les cas, l’Être, y compris l’être juif, est mis à l’épreuve avec une virulence peu commune et une écriture paroxystique, qui va jusqu’au bout d’elle-même, de sorte que l’œuvre de Rawicz demeure, encore aujourd’hui, relativement gênante et d’une subversion patente. On remarque moins qu’elle pose les principes d’une métaphysique de la Shoah. Dans la Shoah pensée par Rawicz, Dieu et le Verbe ne jouent plus le lieu tenant de l’Être, de sorte que la métaphysique devient ontologiquement une histoire de queue.
Professeur de philosophie en Normandie, Didier Durmarque anime également un séminaire à l'Université populaire de Caen. Spécialiste de la Shoah, il a publié La Liseuse (éd. Le rire du serpent, 2012) et Philosophie de la Shoah (éd. de L’Âge d’homme, 2014).


Commentaires
Etonnant.
Je suis sidérée de constater combien bon nombre d’intellectuels modernes, d’obédience juive ou pas, manifestement ont du mal à comprendre comment on parvient à remplacer Dieu par… un idole, notamment, l’événement de la Shoah, sacralisé pour faire Lieu Originaire du Monde Moderne.
Si on veut taper sur l’adoration de Dieu comme une aliénation, il vaudrait mieux ne pas ériger.. un idole, en lieu et place. Si tant est qu’on a le moindre contrôle de cette situation, ce qui reste à vérifier, finalement.
Je suis scandalisée de voir combien d’intellectuels se disant modernes ne parviennent pas à reconnaître dans ce… procès fait à Dieu par l’Homme orgueilleux (mais sans belle bite dressée.. le salut serait de ce côté là) est déjà là dans la Bible, dans le livre de Job, et Quoeleth, l’Ecclésiaste.
L’Homme n’a pas attendu le 20/21 siècle pour oser penser ce que nous nous taraudons de penser de nos jours.
Cela devrait nous faire réfléchir un peu, mais je vois peu d’indications que c’est le cas.
Pour instruction, le livre d’Isaac Bashevis Singer, « Le Manoir », dans lequel Singer, un très bon juif, qui a un pied dans un monde traditionnel et un pied dans son temps, montre une confrontation entre un vieux rabbin hassidique et sa fille révolutionnaire, en Pologne, peu de temps avant la révolution de 1917 en Russie. L’incompréhension est totale. Elle pense… comme « les modernes ». Lui… ne comprend rien à son idéologie…et lui fait remarquer que la relation entre Dieu et l’Homme n’est pas symétrique. Dieu… n’a pas besoin que l’Homme l’adore. Il n’a pas besoin de se justifier, ou de donner des raisons pour l’existence du mal dans le monde. L’Homme, par contre… a besoin de Dieu. Pour ma part, je constate tous les jours combien l’Homme a besoin de Dieu, nonobstant ses fanfaronnades qui proclament le contraire.
Nous avons du mal, à l’heure actuelle à accepter ? comprendre ? des relations qui ne sont pas symétriques. Je me demande pourquoi…
On dirait que Rawicz cultive comme il peut cet humour qu’Hanok Levin (orthographe ?) a pu cultiver en tant qu’auteur de théâtre. Cela donne un regard très caustique, mais l’effondrement dont il est question n’est pas celui de Dieu… c’est celui de l’Homme. Dieu… nous ne pouvons rien en dire, à la fin…
Sachons rester un peu humbles, tout de même…
par Debra - le 20 septembre, 2017
[…] Piotr Rawicz et la Shoah comme métaphysique […]
par Piort Rawicz et la Shoah comme métaphysique – Philosophie de la Shoah - le 20 septembre, 2017
Franchement, je ne me vois pas disserter sur un sujet pareil . L’important, me semble-t-il , c’est que nos sociétés restent extrêmement vigilantes à l’égard de l’antisémitisme . Si j’en crois la décision du Parquet de Paris, mercredi 20 septembre, concernant le meurtre de Sarah Halimi , c’est le cas des autorités françaises.
par Philippe Le Corroller - le 21 septembre, 2017
Laissez un commentaire