La consolation, rendre raison du mal
UN MOT, UN PARADOXE : Chaque mois pendant six mois, iPhilo publiera une entrée du très beau Dictionnaire paradoxal de la philosophie. Pour commencer, voici le thème de la consolation, dont l’entrée a été rédigée par Martin Steffens.
Nous parlons le plus souvent des choses dans le silence des contradictions qui les animent. C’est le principe du Dictionnaire paradoxal de la Philosophie de Pierre Dulau, Guillaume Morano et Martin Steffens que de mettre en lumière plus de cent notions élucidées par l’épreuve de leur propre paradoxe. Car si la contradiction n’était pas partout, la pensée ne serait chez elle nulle part.
POUR ALLER PLUS LOIN : Dulau, Morano, Steffens, Dictionnaire paradoxal de la philosophie : penser la contradiction, éd. Lessius, 464 p., 35 euros.

Spécialiste de Simone Weil, de Léon Bloy et de Léon Chestov, agrégé de philosophie, Martin Steffens est professeur en khâgne au lycée Fustel de Coulanges à Strasbourg. Auteur de plusieurs ouvrages, il a notamment publié Petit traité de la joie (Salvator, 2011) ; Rien de ce qui est inhumain ne m’est étranger (Points, 2016) ; L’Éternité reçue (Desclée De Brouwer, 2017) et dernièrement L’Amour vrai (Salvator, 2018).
La consolation est l’acte par lequel on cherche à apporter un réconfort à quelqu’un qui endure une épreuve. Dans la consolation, il s’agit donc, par la parole ou le geste, de soulager au moins partiellement autrui du mal qu’il endure. Comment peut-il cependant nous être donné d’atténuer la souffrance d’un autre ? La première forme de consolation possible consiste à rendre raison du mal éprouvé, sous la forme des causes qui l’expliquent, des fins qui le justifient ou d’une totalité qui le comprend et lui donne sens. On console dans tous les cas en indexant le mal éprouvé à autre chose que lui, afin d’en atténuer le poids ou d’en relativiser la réalité. Cette première forme de consolation est celle du parent qui nous dit que nous n’avons pas de raison d’angoisser quand nous angoissons, ou de l’interlocuteur qui cherche à nous convaincre que les douleurs qui nous semblent sans fin ne sont que provisoires et relatives, voire, dans le cas des amis de Job, qu’elles sont méritées. Une telle consolation n’est pas étrangère à la philosophie. C’est précisément la philosophie que vient chercher le chrétien Boèce quand, condamné à mort pour sa foi, il rédige la Consolatio philosophae, autrement dit : «La consolation de la philosophie» (1). C’est dans la philosophie également que l’empereur Marc Aurèle trouve à se consoler de la perte des êtres chers, des trahisons, des insultes, des privations et de la perspective de la mort qui attend tout homme (Pensées pour moi-même). A ce niveau philosophique d’expression, la consolation vient alors de ce que le mal enduré se trouve intégré à la rationalité immanente d’un cosmos harmonieux où il trouve tant sa place que sa raison d’être. Au sommet de la consolation philosophique, nous serions ainsi délivrés du mal en comprenant qu’il n’en est pas un.
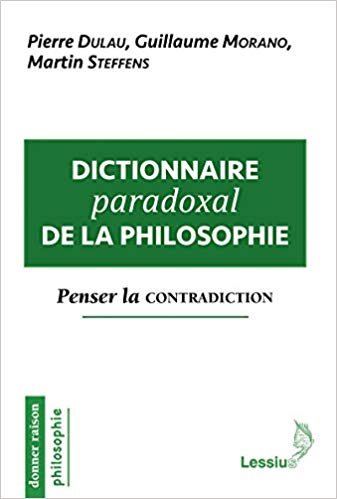
Quelle que soit la forme prise par cette première forme de consolation, immédiate, religieuse ou philosophique, qu’elle la reconduise à des causes, des fins ou une totalité signifiante, on comprend cependant qu’elle ne peut qu’échouer à consoler. Le principe de son échec, c’est le sens même de la stratégie qu’elle met en œuvre, qui prétend atténuer le mal en commençant par refuser d’en reconnaître la pleine et entière réalité. Or une consolation qui prétend nous réconforter du mal sans le partager n’en est pas réellement une. Peu importe à celui qui souffre le cortège des raisons qu’on invoque pour le convaincre que sa souffrance n’est pas un mal : on ne souffre pas moins après qu’il nous a été démontré que nous avons tort de souffrir. Boèce, qui finit par se résigner à son sort, a-t-il, dans l’invocation d’un ordre universel du monde auquel ramener sa mort particulière, trouvé un quelconque réconfort ? Boèce, mort à cause de sa foi, ne sera pas mort en elle : il trouve dans la philosophie stoïcienne assez de raisons de quitter cette vie de telle sorte qu’il nous paraît mourir, non pas consolé, mais seulement résigné. C’est sans doute que la philosophie, en cherchant à rendre raison du mal, ne sait pas se tenir, impuissante et silencieuse, auprès de celui qui en souffre (2).
Être désolé pour consoler
Une consolation qui esquive, annule, dilue ou relativise le mal qu’elle cherche à conjurer ne peut que manquer son but. Pour consoler il faudrait donc commencer par être au moins aussi désolé que celui qu’on veut consoler. Il faudrait, autrement dit, avoir soi-même perdu l’aplomb de celui qui vient au secours et l’assise des bons mots qu’on vient offrir. On ne peut consoler que d’en bas. Quand la consolation cherche à remettre debout, voire à fonder l’autre en son malheur, elle ne peut jamais rien qu’exacerber la souffrance de l’être désolé. C’est là ce que Job, vertement, reproche à ses amis venus le consoler (3). Qui vient pour consoler, au sens de «redonner un sol», de «rendre plus solide» (con-solus), manquera son but à cause de ce but même. C’est dire que la consolation n’a de sens que lorsqu’on ne peut plus rien faire : si l’on peut faire mieux que consoler, alors la consolation offerte n’est jamais qu’une façon de fuir devant l’action. Mais c’est en consentant justement à ne pas pouvoir infléchir la situation qu’on en vient à offrir une présence d’autant plus pure et d’autant plus donnée qu’elle n’est entachée par aucun désir d’efficacité. C’est dans l’impuissance à aider, c’est dans l’imperfection pratique, que l’action de consoler peut devenir présence réellement offerte. Pour redonner une assise, il faudrait avoir perdu la sienne.
Mais si le consolateur est vraiment désolé, est-ce seulement une consolation ? En cette forme désolée de consolation, nous manquons nous-mêmes du sol que nous souhaiterions offrir. Or à quoi sert de proposer à celui qui souffre son propre abîme ? Au terme le plus absurde de cette consolation, il n’y a ainsi plus un, mais deux hommes en souffrance, et c’est celui que l’on cherchait à consoler qui en vient à nous consoler de notre propre désolation. En rejoignant l’autre dans la réalité de sa souffrance, on échoue donc à l’en consoler, parce qu’on commence par reconnaître l’entière réalité de ce dont on voudrait précisément le soulager et que, souffrant de cette souffrance, nous devenons pour lui la cause d’un chagrin supplémentaire (4).
La consolation paradoxale
On saisit ici tout le paradoxe de la consolation : si celui qui nous console n’est pas authentiquement désolé, il ne peut offrir qu’un remède qui ne fera pas droit au mal, soit un faux remède. Mais si le consolateur est a contrario authentiquement désolé, il fait du même coup l’aveu que la souffrance endurée par autrui est irréductible, autrement dit qu’elle est sans remède possible. Soit celui qui console n’est pas désolé, et sa consolation sera factice, donc nulle ; soit celui qui console est désolé, et son réconfort est nul parce que sa désolation le laisse démuni. La consolation ne peut donc offrir un réconfort qu’à la condition de s’avouer impuissante à réconforter, elle ne peut être efficace qu’à reconnaître l’impossibilité dans laquelle elle est d’apporter quelque secours que ce soit. La contradiction de la consolation, c’est finalement qu’elle a pour condition subjective une désolation qui la rend objectivement impossible, et qu’elle n’assure sa possibilité objective qu’en se privant de ce qui la rend subjectivement possible.
Devait-on alors se passer de consolateur ? Cela n’est pas non plus possible. A plusieurs reprises, la Bible rapporte l’histoire de Rachel qui, ayant perdu ses fils, ne voulait pas être consolée (5). Sans doute redoute-t-elle qu’un mauvais consolateur cherche à la priver de cette blessure dont la douleur, par son intensité, indique encore quel amour elle vécut avec ses fils. Surtout, elle seule sait ce qu’elle endure. Or on ne se console pas tout seul. Toutes les consolations qu’on s’octroie (les compensations psychologiques) sont en réalité des pièges (alcool, abrutissement, achats compulsifs, etc.) qui accroissent le malheur en en différant l’affect. Dans nos détresses, l’autre apparaît comme cet être qui ne peut nous rejoindre et dont nous aurions pourtant besoin.
Seul un dieu pourrait nous consoler
Finalement, la consolation serait de descendre là où l’autre souffre, sans s’abîmer avec lui. Il en irait d’une juste distance, qu’il faut trouver. Tout en sachant pourtant qu’il n’y a rien de plus contraire à la consolation que la quête de cette juste distance, laquelle quête supposerait en effet un sujet qui prend pour objet de son attention, non plus le malheur de l’autre, mais l’ajustement à ce malheur. Pour faire droit à la souffrance de l’autre sans faire de sa souffrance l’objet d’un devoir ou d’une compassion qu’on viserait à ses dépens, il faudrait un détachement, certes, mais détaché aussi de lui-même, une distance, mais libre d’adhérer au malheur de l’autre : qu’il y ait une part de nous qui soit quitte de la souffrance de l’autre, afin qu’on puisse, paradoxalement, l’habiter pleinement.
En ce sens, il n’y a peut-être que Dieu qui puisse s’abaisser pleinement au malheur des hommes : l’efficace de la kénose chrétienne (du libre dessaisissement, par Dieu, de sa divinité (6)) consiste en ceci que le Fils, qui est Dieu fait homme, peut d’autant plus profondément descendre dans nos enfers qu’il sait qu’il n’y engage pas toute la divinité, puisque le Père, comme le confesse le Notre Père, est «aux Cieux». Le paradoxe est le suivant : Dieu peut d’autant plus mourir du mal des hommes qu’il est, dans son être même, éternel. Il peut s’engager à-corps-perdu dans le malheur en tant précisément qu’il y a une part de Lui (le Père éternel, mais aussi l’Esprit, qui va «où il veut» (7)) qui ne se perd pas quand le Verbe est crucifié. Pour le dire encore autrement : Dieu, étant la Vie éternelle, quand il vient habiter notre mort, c’est finalement pour y mettre la vie. Ceci pour indiquer que la consolation, sur un plan strictement humain, est sans doute impossible : rejoindre l’autre là où il est sans y être soi-même, c’est de cela que la contradiction du Dieu trinitaire vient nous tirer. Aussi n’est-il pas étonnant que le thème de la consolation n’ait plus été celui du stoïcisme mais du christianisme – et que ce thème, avec la mise en discrétion de la pensée chrétienne ou sa critique comme religion de la consolation (Marx, Nietzsche), ait progressivement disparu du champ de la pensée philosophique.
Vers une consolation tout humaine
N’y a-t-il pas, toutefois, une façon humaine d’habiter le paradoxe de la consolation ? Oui, mais à partir de cette impossibilité même : le paradoxe de la consolation est ici la voie par laquelle on peut en sortir. On ne peut certes rejoindre l’autre en sa souffrance. Mais ce dernier, peut-il seulement rejoindre le lieu où il souffre ? Souffrir, n’est-ce pas être privé de soi ? L’être qui souffre n’a pas plus accès à sa souffrance que l’être qui tenterait de l’y rejoindre. Si l’autre est un abîme pour ma consolation, c’est dans l’exacte mesure où il l’est d’abord pour lui-même. Et c’est là le ressort paradoxal de la consolation : me tenir auprès de celui qui a mal, en sachant pourtant que je ne peux pas accéder au lieu-propre de sa blessure, c’est l’autoriser à se tenir lui-même au lieu de sa souffrance sans en avoir l’accès. Être fidèle à l’ami qui, à cause de son malheur, m’échappe, c’est lui montrer, par la pratique, que chacun peut être fidèle à sa propre vie, quand celle-ci lui échappe. L’altérité radicale où nous met la souffrance est paradoxalement la condition d’une voie à travers elle. Quand l’impuissance où je suis de ne rien faire pour toi n’est pas pour moi un argument pour ne pas être auprès de toi, je t’invite, sans rien dire, sans faire aucune morale, à ne pas abandonner ta vie, quand bien même tu n’y as plus accès. La consolation, qui est une impuissance à faire («Je ne peux rien pour toi») est donc une puissance à être.
«Merci d’avoir été là» dira le consolé à son consolateur. «Être là», c’est avoir su ne rien pouvoir faire pour l’autre et ne pas avoir fui. Aussi ne faut-il pas craindre de me tenir auprès de cet ami qui souffre, quoique, au fond, j’ignore ce qu’il traverse. Car lui-même l’ignore.
Cette fidélité à l’autre, qui l’invite en retour à une fidèle présence à sa vie altérée, sauve la consolation de l’alternative entre assimilation de la souffrance de l’autre à soi et crainte de ne pouvoir jamais la rejoindre. On dit de Niobé que, ayant perdu ses fils, elle eut faim et mangea (8). Être celui qui continue de manger et d’aimer la vie, tout en restant auprès de celui qui ne parvient plus à le faire, c’est l’autoriser, peut-être, à laisser sa joie, quand elle adviendra, reprendre le dessus, comme Niobé «aux beaux cheveux, qui, ayant perdu ses fils, pensa à manger».
Bibliographie
- Cicéron, Tusculanes, Livre III, « Du chagrin ».
- Plutarque, Consolation à sa femme, in La Bibliothèque classique infernale, L’au-delà de Homère à Dante, Paris, Les Belles Lettres, 2016, p. 352-361.
- Marc Aurèle, Pensées pour moi-même.
- Boèce, La consolation de Philosophie. Paris, Le Livre de Poche, 2008.
- Le Livre Job, in L’Ancient Testament.
- Léon Chestov, Athènes et Jérusalem, Traduction du russe par Boris de Schloezer, Paris, Le Bruit du Temps, 2011
- Dans la balance de Job, suivi de Pérégrinations à travers les âmes, Traduction du russe par Boris de Schlœzer, Paris, Le Bruit du Temps, 2016.
- Monique Schneider, « Endiguer », inLa pudeur La réserve et le trouble, Paris, Ed. Autrement, 1992, pp.171 à 175.
- Denis Moreau, Deux cartésiens La polémique Arnauld Malebranche, Deuxième partie, chapitre IV, Paris, Vrin, 1999, pp.111-126.
- Michaël Fœssel, Le temps de la consolation, Points, Essai, 2017.
[1] Boèce, La consolation de Philosophie, Paris, Le Livre de Poche, 2008.
[2] Voir Léon Chestov, Athènes et Jérusalem, Traduction du russe par Boris de Schlœzer, Paris, Le Bruit du Temps, 2011, pp.365 à 366.
[3] Le livre de Job,chapitre 16.
[4] «La compassion, dans la mesure où elle engendre véritablement une souffrance – et cela doit être ici notre unique point de vue – est une faiblesse comme tout abandon à une affection nocive. Elle accroît la souffrance dans le monde.» Nietzsche, Aurore, §134, trad. Julien Hervier, Paris, Gallimard, folio essais, 1995, pp.173-174.
[5] Livre de Jérémie, chapitre 31, verset 15 : «Ainsi parle l’Eternel : On entend des cris à Rama. Des lamentations et des larmes amères. C’est Rachel qui pleure ses enfants. Elle ne veut pas être consolée parce qu’ils sont morts.» Repris textuellement par Matthieu en 2, 18.
[6] Saint Paul, Lettre aux Philippiens, Chapitre 2, verset 6.
[7] Evangile selon saint Jean, Chapitre 3, verset 8.
[8] Sur deux lectures possibles de cet épisode de l’Iliade, voir Michaël Fœssel, Le temps de la consolation, Points, Essai, 2017,p.117-121.
Spécialiste de Simone Weil, de Léon Bloy et de Léon Chestov, agrégé de philosophie, Martin Steffens est professeur en hypokhâgne et en khâgne au lycée Georges de la Tour à Metz. Il a notamment publié Petit traité de la joie, consentir à la vie (Éd. Salvator, 2011), Rien de ce qui est inhumain ne m’est étranger (Éd. Points, 2016) et L’éternité reçue (Éd. Desclée De Brouwer, 2017).


Commentaires
La consolation , ça n’existe pas : que pourrait-on dire à la mère qui vient de perdre son enfant qui ne paraisse insupportable ? Vous résumez remarquablement la situation lorsque vous écrivez : » Etre là » , c’est avoir su ne rien pouvoir faire pour l’autre et ne pas avoir fui « . Bien sûr , dans un deuxième temps la société tentera d’aider cette mère à dépasser cette tragédie . Mais ce temps peut ne jamais advenir et la mère ne jamais réussir à s’arracher au malheur. On touche là au tragique de nos vies et toute la philosophie du monde n’y pourra rien .
par Philippe Le Corroller - le 22 septembre, 2019
Propos intéressants…
Consoler… et se laisser consoler. Deux attitudes qui naissent d’une générosité à deux faces, et différente : générosité de celui qui profères des paroles, générosité de celui qui accueille et accepte gracieusement ce qui lui est offert.
Supporte-t-on de perdre, en sachant que perdre scande la condition humaine du début à la fin ? Supporte-t-on de savoir qu’il est notre lot commun de partager nos pertes avec autrui ? Que souffrir est le lot des hommes, et que ce n’est pas injuste, ou forcément signe de maladie ?
Il y a un orgueil de celui qui refuse de se laisser consoler, qu’il ne faut pas négliger en essayant de penser la situation. Cet orgueil, souvent invisible, sape l’élan vital. Cet orgueil est démultiplié dans une société qui prêche que la perte est irrémédiable, et dans le même mouvement, que le pardon est impossible.
Pour la consolation « toute humaine », je constate que du temps de Dostoievsky, celui-ci s’était déjà aperçu de combien la foi chrétienne était terriblement exigeante pour les pauvres créatures que nous sommes, alors… la consolation « toute humaine », en rejetant tout.. pouvoir sur l’Homme ajoute un poids supplémentaire à ce qui était déjà bien écrasant. Il ne me semble pas souhaitable d’ajouter ce poids à un fardeau qui au début, était censé était un joug léger…Chacun devrait être en mesure de savoir à quel point le pouvoir, loin d’être une liberté absolue, est un fardeau écrasant.
Je ne peux pas m’empêcher de penser que le désir de fabriquer une consolation « toute humaine » tente d’évincer la place de Dieu dans nos vies humaines, (et encore plus.. en nous-mêmes) comme je ne peux pas m’empêcher de croire (savoir, même…) que cet acte terriblement orgueilleux a des conséquences sur notre nature, et notre condition que nous ne pouvons même pas imaginer, tellement nous restons assujettis au Verbe, même à notre insu, et notre corps défendant.
Et cela me rend très triste, tout de même, de savoir que cela ne nous agrandira pas, contrairement à ce que nous… croyons…
par Debra - le 23 septembre, 2019
[…] aussi : La consolation, rendre raison du mal (Martin […]
par iPhilo » L’oubli, meilleur ennemi de la mémoire - le 31 octobre, 2019
La notion de consolation est devenue désuète, si ce n’est pour parler de choses bénignes ou infantiles. On parle plutôt de faire son deuil, de résilience, de lutte contre la maladie, etc., comme pour décrire un processus psychologique propre à l’individu, dans lequel le rôle d’autrui est plus ou moins marginal.
Qu’elle soit physique ou morale, la souffrance est intime, on ne peut pas vraiment la partager, et pourtant l’aide des autres est essentielle pour la supporter et, si possible, la surmonter.
A mon sens, (essayer de) consoler, c’est accompagner en toute sincérité. Donc, comme dit dans l’analyse, apporter le réconfort d’une présence extérieure à la souffrance mais qui y est sensible, qui ne la néglige pas, qui en supporte la vue – donc, qui la subit aussi mais au second degré. Et, à travers cette présence, pour le croyant quelque chose de Dieu peut se manifester. Au fond, la consolation vient quand il devient possible de reconnaître que le mal dont on souffre ne tue pas le bien.
Selon les moments et les personnes, la consolation ou le réconfort passeront par la possibilité de s’exprimer : dire, crier ou expliquer son chagrin, sa peur, sa colère. Ou au contraire par des diversions, que la présence d’autrui rend plus faciles : manger, sortir, s’intéresser à autre chose. Celui qui veut réconforter doit s’adapter à ces besoins.
Finalement, ce processus difficile de la consolation n’est-il pas un révélateur des relations humaines, de la qualité des liens ?
par Diane - le 15 novembre, 2019
[…] une entrée du très beau Dictionnaire paradoxal de la philosophie. Après le thème de la consolation et celui de l’oubli, voici un grand classique de la philosophie : le […]
par iPhilo » Le désir, ce manque paradoxal - le 1 février, 2020
[…] une entrée du très beau Dictionnaire paradoxal de la philosophie. Après les paradoxes de la consolation, de l’oubli, du désir et de l’attention, c’est celui du monstre que nous allons […]
par iPhilo » Le monstre, celui qui nous demande qui nous sommes - le 16 juillet, 2020
[…] une entrée du très beau Dictionnaire paradoxal de la philosophie. Après les thèmes de la consolation, du désir, de l’attention, de l’oubli et du monstre, nous allons suivre la réflexion […]
par iPhilo » Le plaisir, une évidence sans au-delà ? - le 8 avril, 2021
Laissez un commentaire