L’Hypertrophie de la mémoire
ANALYSE : Culturellement, on a trop l’habitude de considérer l’oubli comme une déficience, tandis que la mémoire relèverait d’une capacité, à tel point que nos civilisations progressistes n’ont reculé devant rien pour optimiser cette mémoire dont on ignore la nocivité. Outre qu’elle s’avère de plus en plus énergivore, elle conserve aujourd’hui ce qui devrait être oublié au point de nous faire le plus grand tort, et c’est cet étrange paradoxe moderne de la mémoire que Stéphane Braconnier nous invite à ne pas oublier.
Diplômé en Philosophie de l’Université Panthéon-Sorbonne et en Droit de l’Université Pascal Paoli, ancien journaliste, ancien entrepreneur, Stéphane Braconnier est professeur de Philosophie depuis 2013, en poste dans l’académie d’Ajaccio puis celle de Nantes. Il a publié trois recueils de poésie : Testostérone ; L’Évasion sensuelle et Coup de pied dans la fourmilière (éd. Amalthée).
Une mémoire contre-nature
En tant que mémoire externalisée, Socrate s’en prenait à l’écriture[1], mais comme il est de coutume de ne pas écouter les philosophes, nous n’avons pas cessé d’amplifier cette mémoire externalisée au point de lui donner une dimension infernale. Certes, le livre s’y est adonné à cœur joie, surtout depuis l’invention de l’imprimerie par Gutenberg, néanmoins la pléthore de titres, la difficulté de se procurer certains ouvrages, leur faible tirage, leur dispersion géographique, les barrières linguistiques, bref, leur accessibilité somme toute ouvrait la porte à une subjectivité intellectuelle résultant de ce que chacun avait eu la possibilité de lire. Et c’est cette même subjectivité intellectuelle qui constituait l’intérêt de chaque individu, car nous lisons tous des œuvres communes, tout autant que nous lisons des ouvrages rarissimes. S’il convient d’avoir lu Le discours de la méthode de Descartes, peu ont eu la chance de jeter un œil sur Le journal de médecine de Claude Brunet qui lève le voile sur la théorie du solipsisme, avant qu’il ne la théorise dans son Projet pour une nouvelle métaphysique dont il ne reste plus un seul exemplaire au monde. Or, cette culture individuelle fondée sur une diversité mêlée d’originalité constituait l’intérêt de chacun auprès de tous.
De nous jours, avec les data centers et l’intelligence artificielle, une connaissance faussement exhaustive va s’imposer à tous et rendre la pensée de chacun dérisoire, sans intérêt. Le cours de philo sur la thématique du bonheur par exemple sera normalisé, formaté par ChatGPT, alors que chaque professeur de philosophie abordait la thématique d’une manière singulière ; ce qui constituait la richesse même de la philosophie. Selon mes anciens professeurs Bouveresse et Balibar, l’épistémologie différait, mais leurs apports spécifiques devaient s’intégrer à ma propre opinion, elle-même nourrit de différents auteurs, l’ensemble constituant une conception personnalisée, absolument subjective, une pensée sur mesure pourrait-on dire de cette discipline, et non du prêt-à-penser dont va nous abreuver l’intelligence artificielle. Autrement dit, on n’aura plus à faire l’effort de se forger sa propre opinion des choses : on nous en imposera une.
Pourtant, la culture ne saurait renier les individus et leurs artefacts, sans lesquels elle ne pourrait exister. Elle résulte de leur renoncement à une existence entièrement biologique, selon le rythme de la nature. Or, il est impossible d’admettre une telle individuation de la culture sans y intégrer l’oubli : une constante incontournable de chaque cerveau humain. Neurobiologiquement, nous avons tous plus ou moins de mémoire ; mais ce « plus ou moins » n’atteint jamais un absolu. L’oubli est inhérent à notre nature, même si l’homme tente d’y remédier par l’externalisation de ses pensées, via tel ou tel support, afin d’en constituer un souvenir intemporel. Si la pensée est fugace, quelle qu’elle soit, sa matérialisation dans un support la perpétue. Toutefois, des questions subsistent : est-il aussi indispensable de perpétuer des souvenirs, de stocker des informations de tous ordres, comme si nos PC n’étaient plus équipés de poubelle ? Le devoir de mémoire est-il si crucial ? Ne peut-on lui opposer le droit à l’oubli – si naturel soit-il ? À l’instar de nos vieux albums photos qui regorgeaient de clichés conservés dans un placard et qu’on lorgnait une fois tous les cinq ans, si ce n’est à l’occasion d’un déménagement ; combien nos smartphones retiennent des milliers d’instantanés dénués de tout intérêt ?
La devise du Québec est « Je me souviens ». La Shoah nous est rabâchée quotidiennement. Pas un politique français qui ne se réfère à feu Charles de Gaulle. À n’en point douter, les morts décident pour nous, comme l’écrivait Gustave Le Bon : « Les ombres des aïeux dominent nos âmes. Elles constituent la plus grande partie de nous-mêmes et tissent la trame de notre destin. La vie des morts est plus durable que celle des vivants »[2]. Le passé conditionne inéluctablement notre présent, et peut-être trop, que cela soit au niveau individuel comme au niveau collectif. Et il est à gager que l’amplification de cette mémoire surnaturelle accroisse ce phénomène de prédestination. Les Allemands auraient-ils perdu deux millions de soldats, ainsi que les Français durant la Première Guerre mondiale si la France n’avait entonné La Marche lorraine[3] après sa perte de l’Alsace Lorraine en 1870 ; quatre millions de morts au nom d’un devoir de mémoire à la con si l’on considère qu’aujourd’hui, la France et l’Allemagne appartiennent à la même quasi fédération européenne. L’identité nationale résultante d’un passé commun ne constitue-t-elle pas un fantasme désuet, alors que les principales décisions se prennent à Bruxelles quand ce n’est pas à la direction de l’OTAN ? Et dire qu’on s’est étripé depuis le traité de Verdun en 843, partageant l’empire de Charlemagne pour en arriver là : une Europe supranationale à peu près aussi démocratique que ne l’était l’Empire romain. Comme si le clavier de l’histoire nationale ne possédait pas de touche RESET, quand seul Bruxelles en disposerait. Parfois néanmoins, les États s’approprient cette touche d’effacement en décrétant une amnistie, comme Henri IV à la faveur de l’article 1 de l’Édit de Nantes, ou l’amnistie des crimes de la guerre d’Algérie[4], ou bien celle des exactions commises en Nouvelle-Calédonie avant le 20 août 1988[5]. Paul Ricœur verra d’ailleurs dans ce principe une confusion entre « amnistie et amnésie » ayant pour dessein une « thérapie sociale d’urgence »[6]. Un oubli édicté, impérieux, en guise de traitement des affres sociétaux, avec le pathos jeté aux oubliettes. Dès lors, on ne pourrait que se féliciter de l’initiative gaulliste de la réconciliation franco-allemande qui faisait fi de l’histoire respective de ces deux nations. Quatre-vingts années de paix en résultent.
La prescription et l’oubli en guise de naturopathie
Et ce n’est pas Érasme qui me contredirait, lui qui voyait le bonheur dans la folie, dans cette capacité qu’ont les fous de vivre uniquement dans le présent sans se projeter dans l’avenir ni s’agiter le bocal eu égard à leur passé[7]. D’ailleurs, cette faculté de l’oubli salvateur est aussi bénéfique pour les individus qu’elle l’est pour quelque communauté que ce soit, comme en témoigne par exemple le problème de la prescription des dettes, des délits et des crimes. La plupart des systèmes judiciaires nationaux l’applique d’une manière ou d’une autre, avec quelques différences notoires : l’imprescriptibilité des viols en Californie et des crimes contre l’humanité en France, etc. Mais n’oublions pas ses deux raisons d’être initiales, lesquelles ont présidé à sa consécration dans le Code pénal de 1810 : d’une part, la difficulté de récupérer des preuves de culpabilité au bout d’un certain temps (la mémoire des témoins étant sujette à une certaine érosion), et d’autre part, le souci d’un apaisement social, les années dissolvant des passions qu’il serait hasardeux de raviver. De fait, la prescription détermine une durée pour le droit à la rancune. Au-delà d’un tel délai, un coupable indéterminé est blanchi et la rancœur sociale n’a plus de raison d’être. Le délai de rancune cède le pas à un droit à l’oubli. Assoiffée de vengeance, la population demeure souvent insensible à cette sagesse napoléonienne, ainsi que la Cour de cassation d’ailleurs qui la contourne souvent dans certaines affaires grâce à une casuistique à faire rougir de honte un jésuite, sans parler de la création d’un pôle cold case au sein de la police nationale dont la mission principale est de remettre en cause l’essence même du principe de la prescription, à grands coups de traceurs ADN. L’affaire du meurtre du petit Grégory en constitue la meilleure illustration. Certes, le délai de prescription des crimes n’est pas un délai préfix et son commencement se renouvelle à la faveur de chaque acte judiciaire nouveau, à moins qu’aucun acte n’ait eu lieu durant une période de vingt ans. Si le délai de prescription avait été préfix, l’affaire aurait été close dès le 16 octobre 2004, Grégory Vuillemin ayant été assassiné le 16 octobre 1984. Étanche à cette sagesse impériale qui privilégiait l’apaisement social au bout d’un certain temps, le système judiciaire s’acharne sur cette affaire, au point d’emprisonner inutilement deux septuagénaires (les époux Jacob) en juin 2017, ainsi que Muriel Bolle (une gamine de 15 ans au moment des faits), avec en point d’orgue le suicide du premier juge d’instruction de l’affaire, Jean-Michel Lambert, le 11 juillet 2017. Non, l’assassinat de Bernard Laroche, perpétré par Jean-Marie Vuillemin le 4 février 1985, n’avait pas purgé ce droit à la rancœur. Il fallait que la justice le perpétue au point de pousser au suicide le premier juge d’instruction, plus de trente-deux ans après la mort du petit Grégory, et de placer en détention provisoire trois personnes qu’aucune preuve n’incrimine à ce jour. Ainsi, la rancune judiciaire, écho de la rancune populaire, organise des massacres, et dans sa version sociétale l’acharnement judiciaire est à la justice ce que l’acharnement thérapeutique est à la santé : un contre produit. Résultat : les victimes collatérales d’un crime sont doublement affligées, d’une part par l’acte lui-même et d’autre part via l’acharnement judiciaire qui les empêche de l’oublier. Chaque acte de la procédure ravive la plaie, empêche l’évanescence du souvenir d’œuvrer, sans compter que trente-trois années de résurrection de la mémoire constituent bien un acte de torture morale. Là encore, à l’instar du souvenir de la perte de l’Alsace-Lorraine en 1870, la mémoire tue. On pourrait s’interroger d’ailleurs dans quelle mesure raviver des plaies ne relève pas d’une certaine perversion, car si s’ériger en martyr perpétue de fait un statut victimaire à travers lequel le préjudicié a l’impression d’exister socialement, il a pour effet secondaire de nourrir son mal être. Il en prend soin à la faveur d’une démarche quelque peu masochiste. La chanson aux redondances révélatrices Je n’oublie pas de Vitaa traduit parfaitement cet état d’esprit :
« J’te pardonne, mais je n’oublie pas – J’fais avec, mais je n’oublie pas – C’qu’on a vécu, ça ne s’oublie pas – (…) On vit avec, mais ça ne s’oublie pas – On fait semblant, mais on n’oublie pas – (…) J’ai pas oublié, j’ai pas oublié (ah-ah) – J’ai pas oublié, j’ai pas oublié – Laisse – On dit que le temps répare – Qu’il n’est jamais trop tard – Comme si c’était vrai (ah) – Oh, je reste – Accroché au passé – C’est tellement dépassé – C’est n’importe quoi – Alors, c’est ça un souvenir – On ne l’invite pas, il ne veut plus repartir – J’veux l’arrêter (j’veux l’arrêter) – Faut l’arrêter – J’te pardonne, mais je n’oublie pas – J’fais avec, mais je n’oublie pas – C’qu’on a vécu, ça ne s’oublie pas – (…) On vit avec, mais ça ne s’oublie pas ». Et bis repetita…
À l’aune de cette chanson, d’aucuns considéreront que pardonner tout en se souvenant relève de la résilience, ce terme un peu trop à la mode pour signifier tout simplement une capacité à surmonter les épreuves. Mais a contrario, ne peut-on penser que se souvenir constituerait une faiblesse quand l’oubli s’avèrerait une force, à l’instar de Nietzsche dans La Généalogie de la morale :
« celui qui sait qu’elle force s’y oppose : la force de l’oubli. L’oubli n’est pas une simple vis inertiæ, comme le croient les esprits superficiels, c’est bien plutôt une faculté d’inhibition active, une faculté positive dans toute la force du terme ; (…) voilà l’utilité de l’oubli, actif, comme je l’ai dit, sorte d’huissier, gardien de l’ordre psychique, de la tranquillité, de l’étiquette : on voit aussitôt pourquoi sans oubli il ne pourrait y avoir ni bonheur, ni sérénité, ni espoir, ni fierté, ni présent. L’individu chez qui cet appareil d’inhibition est endommagé et ne fonctionne plus peut être comparé à un dyspeptique (et non seulement comparé), il n’en finit jamais avec rien… Eh bien cet animal nécessairement oublieux, pour qui l’oubli représente une force, la condition d’une santé robuste, a fini par acquérir une faculté contraire, la mémoire, à l’aide de laquelle, dans des cas déterminés l’oubli est suspendu. »[8]
On peut ainsi associer la mémoire et son ratiocinage au ressentiment, à la faiblesse de celui qui n’a pas la force, les moyens, la richesse d’âme de passer outre et de tourner la page pour avancer dans la vie, léger, sans boulet à tirer, car aller de l’avant avec les yeux focalisés sur le rétroviseur : on se casse la gueule ! L’oubli est inhérent au pardon pour être sincère et le pardon constitue une grâce que seuls les hommes forts, voire les rois ou les présidents (si ce n’est Dieu) peuvent accorder, car ainsi que le disait Derrida : « on n’a jamais à pardonner que l’impardonnable ». Sauf que généralement, le roi n’est pas un sujet. Alors, le surhomme nietzschéen serait-il de nature oublieuse ? Pourquoi pas ? Inconsciemment, le processus mnémonique se déleste de l’inutile ou du nuisible. Le cerveau efface ou décharge émotionnellement les souvenirs inopportuns, ceux dont il n’a pas besoin pour le bien-être de l’organisme qu’il gère, à moins d’avoir une mémoire aux fonctions troublées, portant atteinte à soi-même en rouvrant incessamment certaines cicatrices. Mieux vaut une amnésie traumatique qu’une charge émotionnelle insoutenable à la moindre évocation d’un traumatisme. Dire qu’on ne se remet jamais d’un viol, qu’on est brisé à jamais par un tel crime relève de l’auto flagellation. Il faut oublier et faire oublier aux victimes qu’elles le sont, dans leur propre intérêt. Non, le malheur n’est pas un statut social ! C’est juste un poison qu’il convient de digérer, car « À L’ÉCOLE DE GUERRE DE LA VIE – Ce qui ne me fait pas mourir me rend plus fort »[9], ainsi que l’écrivait Nietzsche. Or, si le préjudice subi constitue une réduction de l’être, le statut de victime perpétue un tel amoindrissement ontologique. En effet, si le viol réifie son sujet, ce dernier n’a pas à faire perdurer une telle réification au-delà du moment à laquelle elle s’est produite, à moins de vouloir entretenir son calvaire.
Mais le comble de l’horreur consiste peut-être à implanter de faux souvenirs dans le cerveau d’un individu[10]. Les neurobiologistes s’y attèlent depuis un certain temps, en transplantant des neurones traumatisés identifiés d’un sujet à un autre, tant et si bien que celui qui n’a pas été traumatisé réagit comme celui qui l’a été après la transplantation. Quelque part, on pratique socialement la même monstruosité, comme dans l’affaire judiciaire du Dr Le Scouarnec. La gendarmerie prend contact avec nombre de ses victimes pour leur annoncer qu’il y a vingt ou trente ans, ce chirurgien a profité de leur sommeil pour leur imposer un toucher rectal ou pelvien. Évidemment, ces victimes n’en avaient aucun souvenir, mais certaines s’en sont psychologiquement rendues malades à la lecture de son journal intime, deux ou trois décennies après les faits, quand bien même elles n’avaient eu conscience de quoi que ce soit, ce que le praticien développait pour sa défense : « Pour l’ex-chirurgien, ce n’est pas la réalité de ses actes qui a pu traumatiser ces personnes-là, mais la teneur de ses propos : « L’agression était dans mes écrits », affirme-t-il, par exemple, le 10 juin 2022. Sans jamais s’avancer, Joël Le Scouarnec semble retourner la question au juge : De qui et de quoi avaient été vraiment victimes ces patients-là ? de ses gestes à lui ? de « son journal intime » que tous ces gens n’auraient jamais dû lire ? ou de la justice qui le leur avait lu ? »[11]. Dès lors, l’imagination se substitue à l’absence du souvenir et affecte le psychisme de la personne afin de la convertir en victime.
La mémoire publique : une flétrissure
Si la survivance du trauma s’avère de l’ordre individuel (mis à part que la société l’y pousse à la faveur d’un certain culte pour les victimes), si la prescription des peines et des infractions relève de la mémoire collective ainsi que le roman national, il n’en demeure pas moins que la collectivité se protège en externalisant sa mémoire de la délinquance à la faveur, entre autres, du casier judiciaire. À ce titre, on peut relever une certaine congruence entre la fin et les moyens du système français avec les différents bulletins (B1, B2, B3), lesquels graduent la gravité des infractions ainsi que leurs accès. Par contre, on peut considérer que les choses dérapent avec le fichier national automatisé des empreintes génétiques, dans la mesure où il conserve l’ADN des condamnés, mais aussi celui de ceux qui ont été inquiétés par la justice ou les forces de l’ordre, sans pour autant n’avoir jamais été condamnés. À n’en point douter, avoir son ADN dans un tel fichier invite à la suspicion, même si vous n’avez jamais commis ni crime ni délit. Votre présomption d’innocence s’effrite inévitablement. Doit-on se réjouir que le grand public ne soit pas en mesure de se procurer de telles informations ? Hélas, la médiatisation de la publicité des débats en matière judiciaire peut entraver la réinsertion du délinquant, à l’instar de cet interne qui, condamné pour agression sexuelle en première instance, se voit refuser par l’ARS Occitanie des postes dans les hôpitaux de Toulouse et de Carcassonne. Une ordonnance de référé du tribunal administratif de Toulouse interdit sa réintégration[12] tant que la cour d’appel n’aura pas établi son innocence. Autant dire que sa faute va s’étendre bien au-delà de son éventuelle peine afflictive par une tacite interdiction de continuer ses études de médecine et de trouver un poste. Outre la condamnation judiciaire, l’ostracisme public dont il va faire l’objet nuira à sa réinsertion. Or, la société a autant besoin de se protéger de tels individus, qu’elle a intérêt à leur bonne réinsertion en son sein. L’échec de la réinsertion est souvent synonyme de récidive. La peine infligée devrait largement se suffire à elle-même sans que l’opinion publique atrabilaire n’entrave le retour du délinquant dans la société, lequel a accompli sa peine et s’est ainsi déjà acquitté auprès d’elle. Cependant, cela devient impossible par exemple aux États-Unis où des sites internet répertorient sur la carte du pays les noms et adresses avec photos des personnes condamnées, ainsi que le motif de leur condamnation disponible sur felonspy.com. Il existe aussi des sites spécialisés sur la délinquance sexuelle tels familywatchdog.com ou nationalsexoffenderpublicwebsite. En juin 2012, l’État de La Louisiane a voté l’obligation à tout un chacun de publier ses condamnations sur ses profils de réseaux sociaux. De la sorte, la volonté de transparence américaine s’apparente à l’apposition d’une flétrissure, telle qu’on en infligeait au fer rouge sur la peau des délinquants sous l’Ancien Régime. Autant dire qu’il n’y a aucune rédemption possible : la faute vous poursuit ad vitam æternam à la faveur d’une mémoire collective externalisée sur des sites publics. Ainsi, il y a plus à redouter de la condamnation sociale perpétuelle qui vous estampille « délinquant » à perpétuité que de la condamnation judiciaire elle-même. Or, les résultats obtenus par les deux différents systèmes judiciaires (français et américain) sont probants en faveur de la réinsertion à la française, puisque sur l’année 2022 la France comptabilisait un meurtre et demi pour 100 000 habitants tandis que les U.S.A. en dénombraient six pour le même échantillon de population, avec un taux de récidive inférieur à 10% dans l’hexagone, quand il s’élève à 66% aux États-Unis.
Lire aussi : Le miroir aux alouettes démocratique (Stéphane Braconnier)
Notre civilisation a sans doute trop oublié les vertus de l’oubli. À travers Socrate[13], Platon revêt-il de l’existence des cueilleurs chasseurs pêcheurs, lui qui a tant écrit ? Aurait-il craint que ses pensées ne s’égarent dans la nuit des temps ? Cependant, il est à noter que si nous externalisions notre mémoire à l’aide de l’écrit, nous en demeurions maître pour autant. L’inscription sur le casier judiciaire était décidée par un magistrat. Nous décidions de ce que nous transcrivions et nous nous rappelions de ce dont nous voulions bien nous souvenir à la faveur du graphe. L’historien qui rédige une biographie sur un homme célèbre croule souvent sous la documentation et ses efforts d’exhaustivité sont voués à l’échec. Il doit sélectionner ce dont il fera usage à la faveur d’une subjectivité assumée. Il décide de ce qu’il écrit. L’humain conservait ainsi les manettes de notre mémoire, qu’elle fût collective ou individuelle. Outre cela, l’école musclait notre mémoire biologique avec l’exercice des récitations notamment, avant de classer les élèves en fonction de leurs capacités mémorielles, tels des athlètes cérébraux, ainsi que le relevait Idriss Aberkane[14]. On était noté en fonction de ce dont on se souvenait, d’où l’antisèche. La mémoire externe et la mémoire interne s’entraidaient, se relayaient l’une l’autre.
Aujourd’hui, nous sommes à un carrefour mémoriel. Les data centers concurrencent largement les produits de nos grandes écoles. Ils rendent obsolètes nos étudiants dont la vocation se résumait souvent à de la matière grise bonne à stoker de l’information, plus utile d’ailleurs à notre petit confort qu’à la vie en elle-même. Et, soit dit en passant, il est à craindre que nous confondions confort et bonheur, car sans données externalisées, les tahitiens rencontrés par Bougainville étaient heureux comme nous ne le serons sans doute jamais. Si Platon avait pensé ainsi, que ne l’eût-il développé à la suite de son mythe de Theut ? Bref, avec les data centers et l’intelligence artificielle, nous perdons le contrôle sur une grande partie de la mémoire externalisée, administrée dorénavant par une mémoire siliconée. La machine va sélectionner elle-même les données précédemment externalisées afin d’établir la réponse à la question qu’on lui pose. Et comme ce sera elle qui aura produit l’effort, nous obtiendrons un savoir dont nous serons ignorants, ce qui revient à une antinomie absolue, car un savoir ignoré ne saurait s’avérer une véritable connaissance. Ce n’est pas en tapotant sur une calculatrice qu’on sait extraire une racine carrée, mais en en faisant tout le processus avec un crayon sur une feuille de papier, comme on l’apprenait autrefois à l’école. Maintenant, l’intelligence artificielle rédige nos messages, s’accaparant de la sorte le choix des mots, gérant notre communication, au risque de faire passer un crétin pour un lettré. Autrement dit, la machine nous rend imbéciles, avec l’illusion qu’elle nous permet d’aller plus loin, d’accéder à un autre savoir encore plus capital, que nous confierons pareillement à une nouvelle machine, pour avancer… je ne sais où ! En fait si, au miracle technologique quelque peu plus réel que les divins prodiges, à l’instar de nos smartphones que nous utilisons sans cesse, sans en connaître particulièrement le mode de fabrication et de fonctionnement. La science en devient une conquête illusoire, car sous prétexte de nous simplifier l’existence, tel un leurre, elle crée de nouveaux besoins comme l’affirmait Rousseau[15] et elle perpétue l’exploitation de l’homme par l’homme à la faveur d’incessantes nouveautés qui se substituent les unes aux autres, avec le bonheur en guise de parousie.
Ne peut-on interrompre une telle fuite en avant scientifique et mémorielle afin d’éviter que la machine ne maîtrise l’homme ? Ne peut-on redimensionner l’oubli : effacer l’inutile, comme les milliers de photos amassées dans nos smartphones et qui ne sont plus dans nos cœurs, ou omettre tout simplement ce qui attente à notre sérénité ? Doit-on investir autant d’énergie à se faire du mal, tant les data centers et l’intelligence artificielle s’avèrent énergivores ? N’y a-t-il pas qu’une seule chose à oublier : la mémoire, en ce qu’elle entraîne le ressentiment…
[1] Platon, Phèdre, – « le mythe de Theut », Éd. Gallimard, coll. La Pléiade, vol. Œuvres complètes de Platon II, trad. Léon Robin, Paris, 1950, p.75.
[2] Gustave Le Bon, La vie des vérités, Éd. Ernest Flammarion, coll. Bibliothèque de philosophie scientifique, Paris, 1914, p.2.
[3] Composée par Louis Ganne sur des paroles de Jules Jouy et Octaves Pradel en 1892.
[4] Lois des 23 décembre 1964, 17 juin 1966 et 31 juillet 1968.
[5] Loi du 10 janvier 1990.
[6] Paul Ricœur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Éd. Points essais, Paris, 2000, p.589.
[7] Érasme, Éloge de la folie, Éd. Jean de Bonnot, Paris, 1983, p.22.
[8] Nietzsche, La généalogie de la morale, Deuxième dissertation, §1, Éd. Gallimard, coll. Œuvres philosophiques complètes, vol. Par-delà bien et mal & La généalogie de la morale, trad. Isabelle Hildenbrand & Jean Gratien, Paris, 1971, pp.251-252.
[9] Nietzsche, Le crépuscule des idoles, partie « Maximes et pointes », §8, Éd. Flammarion, coll. GF, trad. Henri Albert, Paris, 1985, p.72.
[10] Stanislas Dehaene, Le code de la conscience, Éd. Odile Jacob, coll. Sciences, Paris, 2014, p.215.
[11] Hugo Lemonier, Piégés – dans le « Journal intime du Dr Le Scouarnec », Éd. Nouveau monde, Paris, 2025, pp.173-174.
[12] Tribunal administratif de Toulouse, ordonnance de référé du 27 novembre 2024, n°2406637.
[13] Platon, Phèdre, – « le mythe de Theut », Éd. Gallimard, coll. La Pléiade, vol. Œuvres complètes de Platon II, trad. Léon Robin, Paris, 1950, p.75.
[14] Idriss Aberkane, Libérez votre cerveau ! Traité de neurosagesse pour changer l’école et la société, Éd. Robert Laffont, coll. Pocket, Paris 2016, p. 155
[15] Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’iinégalité parmi les hommes, Éd. Gallimard, coll. La Pléiade, vol. Du Contrat social – Écrits politiques, Paris, 1964, p.168.
Stéphane Braconnier fit ses études de philosophie à l’Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, avant une courte expérience dans le journalisme. Partant vivre en Corse, il fit son droit à l’Université Pascal Paoli et se lança dans l’entreprenariat. Il écrivit trois recueils de poésie intitulés respectivement Testostérone, L’Évasion sensuelle et Coup de pied dans la fourmilière, publiés aux Éditions Amalthée. Depuis 2013, a été est professeur de philosophie dans l'académie d’Ajaccio, puis de Nantes.
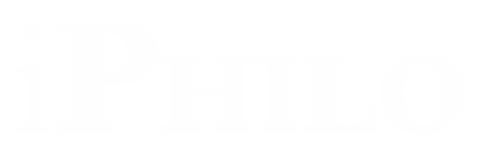


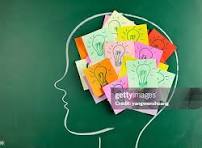
Commentaires
Bonjour
Eh oui ! »Science sans conscience n’est que ruine de l’âme ».
Ou laisser, aux allgorhymes de notre esprit, traiter le dehors pour faire retentir le meilleur de nos penchants de fond naturels.
Permettez_moi de persister raisonnablement dans l’idée de ne pas abandonner aux machines alter ego, l’oubli et nos cinq mémoires.
L »esprit et la machine fonctionnent sans savoir au juste : comment et pourquoi ça marche et évolue !
Des transgressions s’imposent au cerveau humain. Qui aura raison de l’autre.
Se sacrifier, pour savoir, quelle que soit la portée de dommages collatéraux !
par philo'ofser - le 18 mai, 2025
J’ai découvert le « Phaedre » l’année dernière pour la première fois, dans un grand émerveillement pour le fait que 400 ans avant Jésus Christ, les Grecs savaient déjà à quel point le fait de fixer le langage sur un support externe modifiait de manière indélébile et considérable le rapport avec ce qui était fixé, grâce à une technologie qui se généralise et se répand, comme Platon prend la peine de souligner.
En tant que personne qui s’est formée à la théorie freudienne de la… mémoire, je trouve qu’il est important de faire remarquer qu’on se souvient… même quand on ne sait pas qu’on se souvient, et que nos émotions, affects, pensées s’inscrivent EN NOUS souvent à notre insu. D’après Freud, et je le crois, on se souvient… quelque part, même quand on donne tout l’apparence d’avoir oublié.
Pour les machines… nous domineraient-elles à ce point s’il n’y avait pas, calfeutré quelque part EN NOUS, un désir souverain de NE PAS penser, se souvenir, savoir, que quelqu’un d’autre, quelque chose d’autre s’en charge ? Un désir en nous d’échapper à notre conscience et tout ce qu’elle implique de souffrance de la condition humaine d’être pensant ?
Antinomie de la condition humaine qui nous fait revendiquer notre « liberté » à tue-tête dans la plus grande… inconséquence, tout en désirant échapper aux conditions et conséquences de cette liberté ?
Qui dit se souvenir dit aussi « faire RETOUR sur », et le fait de faire retour est en tension avec la volonté d’aller de l’avant, de « progresser »…
Pour mémoire, oubli, et justice, je voudrais faire part de ma dernière petite trouvaille :
Dans le lieu qui énonce le mythe fondateur de la démocratie qui ne porte pas encore ce nom, car les Athéniens ne savent pas encore ce qu’ils sont en train de faire, c’est trop tôt, donc, dans « Les Eumenides » de « L’Orestie » d’Eschyle, on voit le mot « citoyen » arriver lors du PROCES d’Oreste à Athènes. Le « citoyen » surgit grâce à un procès avec des plaidoiries, et Eschyle prend la peine d’énoncer dans cette pièce où on VOIT REPRESENTEES les divinités masquées sur la scène, que laissés à eux-mêmes pour voter pour établir un jugement coupable/non coupable pour Oreste, LES CITOYENS ne peuvent pas trancher, et la situation reste dans l’impasse. Il revient à la divinité, en tiers, de trancher pour que le jugement puisse se faire. Sage Eschyle qui, dans l’embryon de la démocratie perçoit déjà les impasses qui se profilent devant, et laisse à la divinité représentée sur scène de trancher, car il sait que sans elle, les querelles se multiplient, ainsi que les antagonismes de toute nature, la justice est dans l’impasse, et… l’oubli est impossible.
par Debra - le 19 mai, 2025
Laissez un commentaire