Montaigne et les façons de mourir
ANALYSE : La mort est souvent présente sous la plume de Montaigne. Dans de précédents articles, Jean-Claude Fondras a tenté de montrer comment la pensée de cet auteur avait évolué sur la question de la préparation à la mort. Dans cette nouvelle contribution il souhaite examiner la question de la mort comme événement vécu, cette problématique étant explicitement présente dans plusieurs chapitres des célèbres Essais.
Médecin, Jean-Claude Fondras a exercé en milieu hospitalier comme anesthésiste-réanimateur, avant d’être responsable, pendant quinze ans, du service de traitement de la douleur et de soins palliatifs du Centre hospitalier de Bourges (France). Egalement docteur en Philosophie, il a notamment publié Soins palliatifs (avec Michel Perrier, éd. Doin, 2004) ; La Douleur, expérience et médicalisation (éd. Les Belles Lettres, 2009) et Santé des philosophes, philosophes de la santé (éd. Nouvelles Cécile Defaut, 2014).
Montaigne ne se soucie guère de la mort comme état ; pour lui, être mort n’est pas à craindre, qu’il se réfère à la sagesse épicurienne en citant ou paraphrasant Lucrèce ou qu’il envisage la mort comme état intermédiaire dans l’attente chrétienne du jugement divin, il fait sienne cette opinion attribuée aux empereurs Hadrien et César : « L’estre mort ne les fache pas, mais ouy bien le mourir »[1], qu’il reprendra dans le livre III : « Je ne m’estrange pas tant de l’estre mort comme j’entre en confidence avec le mourir »[2], phrase que Guy de Pernon juge énigmatique et traduit par : « Je ne me sens pas aussi étranger de l’état de mort que je me sens proche et en confiance avec le fait de mourir »[3]. C’est donc mourir, et non la mort, qui préoccupe Montaigne, comme on le voit dans le chapitre 9 du livre III « De la vanité » :
« La mort a des formes plus aisées les unes que les autres » […] Ce n’est qu’un instant ; mais il est de tel pois que je donneroy volontiers plusieurs jours de ma vie pour le passer à ma mode »[4]. Ce souci de la façon de mourir est présent dès le livre I où, examinant la vie d’autrui, l’auteur affirme « Au Jugement de la vie d’autruy, je regarde tousjours comment s’en est porté le bout ; et des principaux estudes de la mienne, c’est qu’il se porte bien, c’est à dire quietement et sourdement »[5], soit : « tranquillement et sans bruit »[6]. Utilisant un argument d’autorité en s’appuyant sur nombre d’auteurs de l’Antiquité et sur l’exemple d’homme réputés courageux, il énonce ceci : « C’est une viande, à la verité, qu’il faut engloutir sans macher, qui n’a le gosier ferré à glace »[7], nous dirions aujourd’hui « s’il n’a pas le gosier à toute épreuve. »[8]
Montaigne eu l’occasion de tester ce passage vers la mort au cours de ce fameux accident de cheval qu’il relate dans le sixième chapitre du livre II intitulé « De l’exercitation »[9] . En promenade près de son domaine, Montaine fut renversé par un de ses domestiques monté sur un cheval plus puissant et qui voulu « faire le hardy ». Le choc se traduisit par une chute violente suivie d’une commotion cérébrale « le seul esvanouissement que j’aye senty jusques à cette heure ». Cet état va durer environ deux heures pendant lesquelles il fut ramené chez lui vomissant du sang en grande quantité et commençant à reprendre peu à peu conscience, dans une sorte d’état intermédiaire qu’on qualifierait aujourd’hui de « stuporeux ». Ce récit mérite qu’on le cite largement, selon la traduction de Guy de Pernon[10] : « Ce souvenir fortement gravé dans mon âme, qui me montre le visage de la mort et ce qu’elle peut être, si proches de la vérité, me réconcilie en quelque sorte avec elle. ». Et Montaigne semble généraliser cette expérience : « Je crois que c’est dans cet état que se trouvent ceux que l’on voit, défaillants de faiblesse, à l’agonie ; et je considère que nous avons tort de les plaindre. ».Car cet état : « c’était de la langueur et une extrême faiblesse, sans aucune douleur » ; pour tout dire, soucieux d’une mort paisible, l’auteur estime que « c’eût été, sans mentir, une mort bienheureuse, car la faiblesse de mon raisonnement m’empêchait d’en avoir conscience, et celle de mon corps d’en rien ressentir. Je me laissais couler si doucement, si facilement et si agréablement, que je ne connais guère d’action moins pénible que celle-là ». Cette expérience est donc rassurante à ceci près que le retour des sensations douloureuses provoquées par les multiples contusions dans les heures et jours qui ont suivi cet accident a été difficile à supporter au point qu’il crût « mourir encore une fois, mais d’une mort plus aiguë celle-là ».
C’est aussi pourquoi l’auteur continuera à être hanté par les conditions de sa mort, mettant en jeu les ressources de son imagination, surtout en ce qui concerne les morts violentes, nous expliquant ses préférences : être enseveli plutôt que s’écraser en tombant d’un précipice, subir le tranchant de l’épée plutôt que la balle de l’arquebuse, boire la ciguë plutôt que se frapper lui-même d’un poignard ou encore se jeter dans l’eau d’une rivière tranquille plutôt que dans une fournaise ardente[11]. Montaigne fait d’ailleurs aussi entrer dans son imagination les conditions d’une mort volontaire, c’est-à-dire du suicide[12], dont il est question tout au long du troisième chapitre du livre II des Essais « Coustume de l’Isle de Cea »[13]. L’auteur commence par prendre quelques précautions rhétoriques : son écriture ne fait que « niaiser et fantastiquer » et sur ces questions comme sur d’autres, il s’en remet en dernière instance à l’autorité de la volonté divine à l’encontre de ces « humaines et vaines contestations ». Comme protégé par ce prudent avertissement, il peut alors établir une sorte de compilation de récits de suicides et parfois de suicides collectifs, le plus souvent dans un contexte de disgrâces politiques ou de défaites militaires tirées de l’histoire antique. Cette énumération est assortie de réflexions morales considérant ce qui pourrait justifier ou au contraire récuser le bien-fondé d’une mort volontaire. Montaigne s’interroge sur ce qui est le vrai courage, celui qui fait supporter l’infortune ou celui qui pousse à abréger sa vie. Il approuve le suicide pour échapper au déshonneur d’être livré à une mort cruelle par la main de son ennemi.
La coutume qui donne son titre à cet essai évoque la possibilité pour les citoyens de l’ile de Céa (mais aussi pour ceux de l’antique Marseille) de demander aux pouvoir politique de leur fournir un poison afin de réaliser leur suicide, après avoir plaidé auprès du Sénat les motivations et la validité de leur démarche. Un « suicide assisté » avant la lettre, que Montaigne cite sans commentaire à la manière neutre d’un ethnographe. Sur la question du suicide, Montaigne ne peut pas écarter l’objection théologique, mais il la présente comme une opinion parmi d’autres : « Car plusieurs tiennent que nous ne pouvons abandonner cette garnison du monde sans le commandement expres de celuy qui nous y a mis ; et que c’est à Dieu, qui nous a icy envoyez non pour nous seulement, ains pour sa gloire et service d’autruy, de nous donner congé quand il lui plaira, non à nous de le prendre ». Pour prendre le contre-pied il paraphrase alors Sénèque en énonçant : « La plus volontaire mort, c’est la plus belle. », reprise d’une des Lettres à Lucilius : « On doit compte de sa vie aux autres, de sa mort, soi seul. La meilleure est celle qu’on choisit. »[14].
Lire aussi : Montaigne, la peste et la mort (Jean-Claude Fondras)
Quittant le terrain des morts héroïques spectaculaires, le chapitre revient à des considérations plus courantes : « Pline dit qu’il n’y a que trois sortes de maladie que l’on a le droit d’éviter en se tuant. Et la plus pénible des trois, c’est celle de la pierre dans la vessie quand elle cause une rétention d’urine »[15]. On ne connaitra pas le nom des deux autres maladies, car Montaigne a de bonnes raisons de citer la « maladie de la pierre » (aujourd’hui lithiase rénale) dont il est lui-même atteint comme son propre père qui en est mort. Ayant subi des épisodes de rétention d’urine pendant trois à quatre jours, Montaigne assimile ces « cruelles attaques » à une véritable torture, citant à ce propos l’empereur Tibère, qui, selon Suétone, « faisait lier la verge à ses criminels pour les faire mourir en les empêchant ainsi de pisser était passé maître dans la science des bourreaux ! »[16]. Cette analogie entre la maladie et la torture rend licite de hâter l’échéance : « Il en est qui considèrent qu’il vaut mieux mourir à sa guise plutôt que d’encourir une mort plus atroce », allusion là encore aux propos de Sénèque : « Si je puis opter entre une mort compliquée de tortures et une mort simple et douce, pourquoi ne prendrais-je pas cette dernière ? »[17]. Il fait état des initiatives des médecins en ironisant, avant l’heure, sur leur acharnement et en tire des conclusions lucides : « Les procédés courants de la guérison agissent aux dépens de la vie : on nous incise, on nous cautérise, on nous ampute, on nous tire des aliments et du sang ; un pas de plus, et nous voilà guéris tout à fait ! […] Dieu nous permet bien de prendre congé, quand il nous met dans un tel état que la vie est pour nous pire que la mort. »[18]. Derrière son goût habituel pour l’exposition du relativisme des coutumes, Montaigne affiche prudemment sa mansuétude pour la mort volontaire et ceci malgré la représentation péjorative dominante à son époque où le suicide est un péché grave pour la religion en même temps qu’un acte honteux et criminel contre la société. L’essai se termine par cette conclusion : « La douleur insupportable et une pire mort me semblent les plus excusables incitations. ».
Les interrogations et assertions de Montaigne sur la question du mourir pourraient se résumer ainsi : pourquoi craindre la mort si elle est une entrée dans un sommeil permanent et si, de plus, on a la chance d’échapper à une mort cruelle, grâce aux circonstances ou, dans certains cas, par une mort volontaire ? Montaigne réunit ainsi tout ce que les contempteurs de la modernité ne supportent pas : malgré toute une tradition de pensée philosophique ou religieuse il va à l’encontre du poncif de la « préparation à la mort », il s’émancipe des représentations où dominent le mystère et la crainte, il juge acceptable, lorsque les circonstances l’exigent, une mort volontairement anticipée. Pascal ne s’est pas trompé là-dessus, qui note sévèrement : « Ses sentiments sur l’homicide volontaire, sur la mort. […] On ne peut excuser ses sentiments tout païens sur la mort […] il ne songe qu’à mourir lâchement et mollement par tout son livre. »[19].
Dans son insistance à comparer la mort et le sommeil, Montaigne va à l’encontre de la théologie qui, influencée par le néoplatonisme affirme la séparation de l’âme et du corps avec survie consciente de l’âme et « jugement particulier immédiat » avant même la résurrection du corps à la fin des temps. Montaigne ne s’oppose pas explicitement à cet enseignement de la théologie mais fait état de son scepticisme, en particulier dans l’Apologie de Raymond Sebond[20], où il expose les vues des philosophes antiques. Il s’y monter sévère à l’égard de Platon qui promet les récompenses de l’autre monde à la partie la plus spirituelle de l’homme, autant qu’à l’égard des promesses charnelles du paradis de Mahomet et à la transmigration des âmes soutenue par Pythagore. La méthode sceptique produit son effet en opposant ces spéculations les unes aux autres et il nous est conseillé de regarder avec distance ce « tintamarre de tant de cervelles philosophiques ». À ces mirages divers sur l’au-delà de nos vies, Montaigne oppose par cinq fois des vers de Lucrèce et, sans cependant prendre position sur le fond, il utilise l’idée épicurienne de la mort comme extinction complète à la façon d’un antidote psychologique à l’angoisse suscitée par l’inconnu d’un outre-monde fantasmé : « La nature nous apprend qu’elle nous a fait aussi bien pour mourir que pour vivre, et dès la naissance, elle nous donne la représentation de cet état dans lequel elle nous conservera éternellement après elle, pour nous y habituer, et nous en ôter la crainte »[21]. Cette façon de penser la mort et le mourir s’insère dans sa vision singulière de la vie, si admirablement exposée dans les dernières lignes des Essais : « Les plus belles vies sont, à mon sens, celles qui se conforment au modèle commun et humain, bien ordonnées, mais sans rien d’extraordinaire, sans extravagance »[22]. Ce qui vaut pour la vie dans sa globalité vaut pour la fin de cette vie : « Puisqu’il y a des morts qui sont bonnes pour les fous, et d’autres bonnes pour les sages, trouvons-en qui soient bonnes à ceux qui sont entre les deux »[23].
Lire aussi : Vivre et mourir : Ulysse, Socrate et le Samouraï (Claude Obadia)
Montaigne n’aspire pas à une fin de vie héroïque, lucide sur ce qu’il appelle sa « faiblesse naturelle », il sait qu’il ne peut être « ni un ange ni Caton »[24]. Ni ange sans enveloppe corporelle, car son aspiration à une mort apaisée lui fait redouter une agonie qu’il faudrait accepter par soumission au destin. Ni Caton, car il ne peut non plus se résoudre à un suicide violent tel celui de cet homme politique romain qu’il admire tant. Cette sagesse qu’on pourrait qualifier de simple et prosaïque s’éloigne de la mise en scène grandiose de certaines morts stoïciennes, elle apparaît plus proche des idées épicuriennes, qui voient dans la mort volontaire non une action admirable mais un pis-aller si les circonstances y conduisent, c’est-à-dire si la somme des plaisirs, y compris bien sûr ceux de l’âme, ne peut plus l’emporter sur celle des souffrances : « La nécessité est un mal, mais il n’y a aucune nécessité à vivre avec la nécessité »[25].
De plus, quelles que soient les circonstances, subies ou volontaires, il n’y a pas lieu d’imaginer que la mort survient nécessairement « à son heure », comme on l’entend parfois, et que cette temporalité soit à respecter : « Que l’homme se donne la mort ou qu’il la subisse, qu’il aille au-devant d’elle ou qu’il l’attende, tout revient au même : d’où qu’elle vienne c’est toujours la sienne. Quel que soit l’endroit où le fil se rompe, il y est tout entier, c’est là le bout de la pelote »[26]. Montaigne par cet énoncé plaide pour une réappropriation de sa mort par l’individu, s’opposant à l’extériorité d’une destinée inéluctable. C’est aussi cela qu’il recherche dans la lecture des auteurs de l’Antiquité : « Et si j’étudie, ce n’est que pour y chercher la science qui traite de la connaissance de moi-même, et qui m’instruise à bien mourir et à bien vivre »[27], paraphrasant cette fois Épicure : « le soin de bien vivre et celui de bien mourir ne font qu’un »[28].
[1] Montaigne, Essais, II, 13, 608. (L’édition citée est celle de Villey (PUF, Paris, 1965). Pour plus de clarté, la traduction en français moderne de Guy de Pernon (édition numérique Numlivres.fr, 2012) sera également citée avec la mention P suivie du livre, du chapitre, de la page et du paragraphe.)
[2] III, 9, 971.
[3] P, III, 9, 81, 232-233.
[4] III, 9, 983-984.
[5] I, 19, 80.
[6] P, I, 18, 116, 11.
[7] II, 13, 608.
[8] P, II, 13, 353, 7.
[9] II, 6, 370-380.
[10] P, II, 6, 59-72.
[11] III, 9, 983-984.
[12] Le terme n’est pas employé par Montaigne, il n’apparaît en français qu’au début du XVIIIe siècle.
[13] II, 3, 350-362
[14] Sénèque, Lettres à Lucilius, Lettre 70.
[15] P, II, 3, 38
[16] P, III, 4, 74, 24
[17] Sénèque, op. cit.
[18] P., II, 3, 32, 7
[19] Blaise Pascal, Pensées, fr. 680, Éd Lafuma.
[20] II, 12, 438-604.
[21] P., II, 6, 61, 6.
[22] P., III, 13, 413, 133.
[23] P., III, 9, 249, 119.
[24] III, 9, 119.
[25] Epicure, Sentences vaticanes, §9.
[26] P., II, 3, 32, 6.
[27] P., II, 10, 109, 6.
[28] Épicure, Lettre à Ménécèe, §126.
Médecin, Jean-Claude Fondras a exercé en milieu hospitalier comme anesthésiste-réanimateur, avant d'être responsable, pendant quinze ans, du service de traitement de la douleur et de soins palliatifs du Centre hospitalier de Bourges (France). Il est également docteur en Philosophie et membre du Laboratoire d’éthique médicale de l’université François Rabelais à Tours. Il a notamment publié Soins palliatifs (avec Michel Perrier, éd. Doin, 2004) ; La Douleur, expérience et médicalisation (éd. Les Belles Lettres, 2009) et Santé des philosophes, philosophes de la santé (éd. Nouvelles Cécile Defaut, 2014).
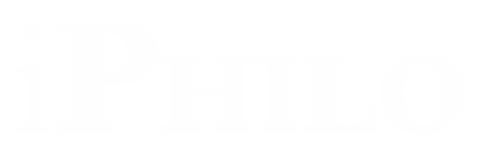


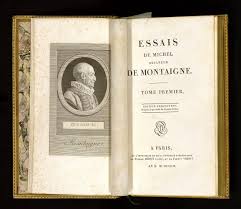
Commentaires
Laissez un commentaire