Un an masqués : des hommes sans visage, un mauvais augure
BONNES FEUILLES : Nous publions un extrait de l’avant-propos de Faire face. Le visage et la crise sanitaire (éd. Première Partie, 2021), le nouvel essai de Martin Steffens et Pierre Dulau, postfacé par Giorgio Agamben. Dans ce bel ouvrage qui revient sur le port du masque durant l’épidémie de Covid-19, les deux philosophes démontrent pourquoi le visage, ouvert et offert, est vital aux hommes.
Spécialiste de Simone Weil, de Léon Bloy et de Léon Chestov, agrégé de philosophie, Martin Steffens est professeur en khâgne au lycée Fustel de Coulanges à Strasbourg. Auteur de plusieurs ouvrages, il a notamment publié Petit traité de la joie (Salvator, 2011) ; Rien de ce qui est inhumain ne m’est étranger (Points, 2016) ; L’Éternité reçue (Desclée De Brouwer, 2017) et dernièrement L’Amour vrai (Salvator, 2018).
Docteur ès Lettres, agrégé de philosophie, Pierre Dulau enseigne en classes préparatoires à Strasbourg. Il est auteur ou coauteur du Dictionnaire paradoxal de la philosophie (éd. Lessius, 2019), de Heidegger, pas à pas (Éd. Ellipses, 2008) et dernièrement de L’Âge du Minotaure. Penser la technique (éd. Kimé, 2020).
À l’heure où nous écrivons, si l’on ajoute aux confinements successifs les mesures imposées de distanciation sociale, cela fait neuf mois que nous sommes dérobés à nous-mêmes. Neuf mois : le temps d’une grossesse. Pour accoucher de quoi ? D’un monstre : un homme sans visage.
Lire aussi : L’Édito : «Face au Covid, tous épidémiologistes ?» (Alexis Feertchak)
Oui, un monstre : l’homme masqué, en plein air et à toute heure, de nuit comme de jour, de gré ou de force, est une chose inquiétante et étrange. C’est un être devenu étranger à lui-même. Car l’homme est son visage. Quand un enfant dessine pour la première fois son père ou sa mère, c’est un visage qu’il fait. En général, il ajoute à ce visage, en lieu et place des oreilles et du cou, deux bras et deux jambes, sans prendre la peine de dessiner le reste. Cela fait sourire. C’est pourtant très sérieux : un visage capable d’accourir afin de le prendre dans les bras, voilà ce que sont, pour lui, un père et une mère. L’enfant offre ce dessin comme l’on tend un miroir : «Regarde, c’est toi», dit-il. Vous avez soudain la chance de vous regarder dans les yeux d’un autre.
Cette manière d’aimer est, pour l’enfant, une manière rigoureuse de connaître. Cette connaissance est aussi claire et précise que peut l’être une description. Mieux encore, elle est plus vraie qu’une description d’adulte. Elle n’est pas encore tourmentée par l’impératif de conformité à l’aspect extérieur des choses. Elle ne confond pas encore le visage avec la simple figure qu’une stricte géométrie permet de dessiner. Son absence de méthode s’entend d’un autre savoir-faire, où le faire est intimement uni au savoir de la relation, à la conscience que nous ne pouvons rien faire sans le secours d’un autre. Le père et la mère sont représentés par son dessin comme capables de se rendre présents : ils ne sont, pour l’enfant, rien qu’un visage doté de jambes et de bras.
Son dessin honore le caractère insaisissable, parce que relationnel, du visage humain. Il réussit à signifier que le visage n’est pleinement visible que s’il s’offre. Le visage humain ne se laisse saisir que s’il n’est pas d’abord capturé. C’est pourquoi il faut qu’il déborde : ce sont des yeux trop gros, des bras qui font une immense ouverture, c’est ce sourire si grand qu’il n’est plus besoin d’ajouter un nez ni quoi que ce soit d’autre… et ce débordement, l’enfant sait que c’est lui qui l’inspire à ses parents. Il vient seulement de traduire le désir inquantifiable qui l’a posé dans l’être : «Comme le monde était beau lorsqu’il n’avait que la largeur d’un visage» [1]. […]
Lire aussi : Coronavirus : les philosophes s’expriment !
[…] La perte du visage fut, de toujours, un mauvais augure. Ernst Jünger, arpentant les tranchées après les assauts de l’armée adverse, voyait dans les visages disparus de ses compagnons d’arme, têtes fichées dans la glaise ou défoncées par l’éclat d’un obus (futures gueules cassées que peindra Otto Dix), la préfiguration d’un temps de sacrifice de masse, sur l’autel de ces dieux qui ne cessent plus de faire retour : dieu de l’État total, dieu de la sécurité et de l’hygiène, dieu des machines aveugles de la Technique, dieu de la monnaie par quoi tout s’échange.
Notre conviction, enfantine, est que l’on ne saurait conserver une vie morale et politique proprement humaine en rendant l’homme invisible et intouchable. Telle est notre conviction : à force de rendre l’homme inaccessible à l’homme, les personnes masquées qui, dans cette épidémie, sauvent des vies ou en accompagnent le terme (les infirmiers en unité Covid, les médecins en réanimation, les personnels de soins palliatifs…) perdront jusqu’au sens de ce qu’elles font. Comment conserver l’expérience et le goût de l’humain si partout alentour il est frappé d’invisibilité ? Comment concevoir le prix infini d’une vie humaine si, dans notre quotidien, elle est sans cesse humiliée ? En s’imaginant sauver la vie d’une menace mortelle au prix de ce qui lui donne son sens, on ne fait que la condamner une seconde fois. À ceux qui croient encore qu’on peut biffer le visage humain pendant des mois ou des années sans tôt ou tard en payer le prix, nous voulons montrer ce qu’il a, au contraire, de vital.
Lire aussi : Michel Foucault, le Covid-19 et le «combat immense et multiple des savoirs» (Jean Zaganiaris)
Dans la nuit qui, depuis l’épidémie, est tombée sur nous, nous n’avons d’autre tâche que de tenir ces divinités en respect. Nous leur opposerons un autre dieu, apparemment plus faible et plus fragile mais qui resurgit chaque fois qu’on lui prête un peu de notre attention, ou qu’on mendie la sienne : ce dieu qui ne craint pas de prendre visage humain.
[1] «… et, pour l’assister, l’escorte d’un chant d’oiseau.» : René Char, Recherche de la base et du sommet, in Œuvres complètes, Éd. Gallimard, coll. La Pléiade, Paris, NRF, p.705.
Pour aller plus loin : Pierre Dulau, Martin Steffens, Faire face. Le visage et la crise sanitaire, Éditions Première Partie, coll. Point de bascule, postface de Giorgio Agamben.
Docteur ès Lettres, agrégé de philosophie, Pierre Dulau enseigne en classes préparatoires à Strasbourg. Coauteur du Dictionnaire paradoxal de la philosophie, il a également publié Heidegger, pas à pas (éd. Ellipses, 2008).




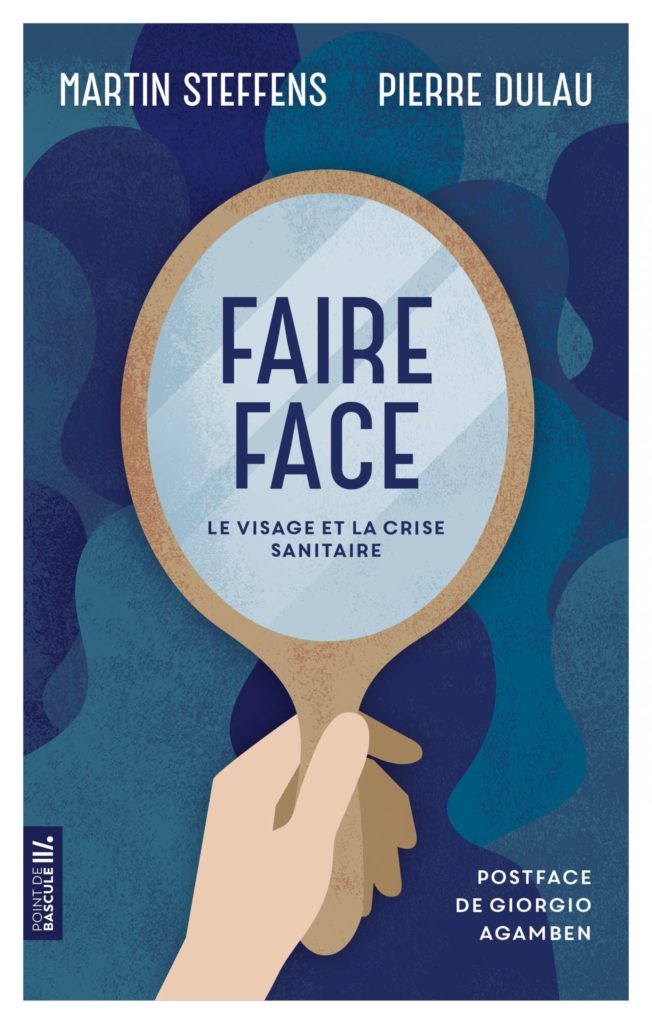
Commentaires
Merci infiniment pour ce texte. J’y souscris entièrement, pleinement, sans la moindre réserve.
Le hasard voudrait que hier, j’ai subi ma première toute petite persécution de ne pas vouloir cacher mon visage, (je ne cache pas mon visage) dans un lieu où je travaille depuis 13 ans maintenant, et où je me suis fait des amis en tant que bénévole.
Mais je ne veux pas me coucher devant ce que je perçois comme notre monstrueux entêtement à poursuivre notre propre destruction, en érigeant de nouveaux autels, avec de nouveaux… rites à accomplir, vers de nouveaux dieux qui sont sans pitié. Quelle régression que nous embrassons, et au nom de la raison, de la « science », qui plus est !
Je comprends de plus en plus que le port du masque est une manière de rendre manifeste notre méfiance fondamentale envers notre prochain. Méfiance qui grandissait avant le Covid, et continue à grandir en Occident en ce moment (et dans le monde mondialisé entier ?). C’est une manière de dire que l’autre est un danger, et que loin de nous offrir des possibilités de nous épanouir, de nous réaliser dans la relation AVEC lui, il risque de faire mourir la petite île que nous croyons être (égoïsme cartésien).
Je crois, je sais, qu’une société, une civilisation qui érige le prochain, EN SON SEIN, comme ennemi, est une société qui se condamne à mort. Elle rend toute forme de foi, de confiance, et de commerce impossible, et nous sommes des êtres de foi, de confiance, et de commerce. Qui dit commerce dit… commerce sexuelle aussi, en sachant que ce n’est pas parce qu’on commerce sexuellement qu’on réduit l’autre à un SEULE article de consommation avec de l’argent échangé. Dans le mot « commerce », il y a aussi le « merc » de « mercenaire » qui nous est arrivé dans le mot « merci ». C’est capitale, tout ça. Le « merc » de « mercenaire » matérialise le registre de l’intérêt, et de l’argent, alors que le « merc » de merci fait entendre… la grâce qui doit rester intriquée à l’intérêt. Intriquée, et non pas séparée. Quand on vise à séparer ce que Dieu a uni (et oui), on fait des ravages. Cela se confirme. Comme ça… le royaume de Dieu, comme on l’appelle, peut continuer à cheminer sur terre en même temps que la sphère temporelle, mais… sur un autre plan. Il n’y a pas obligatoirement concurrence entre les deux. C’est nous, avec notre incompréhension, et notre manque de foi, qui injectons la concurrence.
Nous sommes des êtres complexes, des êtres qui sont le lit, le lieu que traversent besoins, désirs souvent contradictoires. Le nouveau né totalement impuissant fait jaillir le lait dans les seins de sa mère quand il pleure. Il dispose d’une puissance redoutable pour nous attacher à lui. Dieu vit ça, et dit que sa création était BONNE. Pourquoi.. nous… nous déciderions que nous savons mieux que Dieu ?…
Quelle obstination pour nous DETACHER en devenant des impersonnes, surtout dans notre chair et nos os, qui sont si fragiles, et sujets à une corruption inévitable ? Au nom d’un idéal abstrait de la « liberté », érigé en AB-SOLU, pour nous rendre… AB-SOLUS et… tristement, souverainement, seuls ?
En passant, je vis, au jour le jour, le miracle qui consiste à donner le « bonjour » avec un sourire, à celui ou celle qui est en face de moi, et je vois combien cet acte est une résistance qui me porte, et souvent porte autrui. Sans masque, bien entendu. On peut le faire avec le masque, mais cela n’a pas la même portée…
En y réfléchissant, je me dis qu’il s’agit d’être l’auteur d’un acte éveillé, un acte où on est présent, attentif à l’autre, ET à ce que l’autre produit en nous. Il s’agit d’un don. Un don est peut-être tout le contraire d’un automatisme ?
Pour le désir altruiste des soignants, du corps médical, ou pas, je voudrais souligner à quel point nous sommes le lit de désirs contradictoires (voir plus haut). Le désir de protéger peut paraître un désir purement altruiste, pourtant, ce désir est le lieu où s’exerce un désir/besoin de puissance et de contrôle formidable sur autrui. Nous sommes des êtres qui nous tenons debout… en sentant que nous tenons d’autres debout.
A d’autres époques on a pu dire « qui aime bien châtie bien ». On peut aussi dire « qui aime bien… n’étouffe pas autrui sous la protection, en méconnaissant son propre besoin de se sentir puissant DANS et par la protection d’autrui ». Etre puissant, c’est aussi s’abstenir d’activisme dans certains cas. Ne rien faire.
Vivre pleinement la vie est un art de funambule. Jésus disait qu’étroite était la porte vers le royaume de Dieu, que je comprends comme une manière de parler d’une vie non pas heureuse (Sénèque ?), mais une vie pleine, vivante, comme des tomates qui poussent DANS la terre, et pas hors sol. Des tomates avec des marques dessus où une limace a pu grignoter un morceau, des cerises béquetées par des oiseaux pour le grand plaisir de nos papilles après). Vivre cette vie là, c’est pratiquer le funambulisme avec la réalisation que l’abîme est des deux côtés, et le fil sur lequel on marche est mince. Trop de protection… tue la vie vivante et confiante chez celui qui est protégé. Pas assez de protection l’expose à la dérive, et la déréliction. Décidément, être Homme debout est une… mince affaire. De tous temps. Avec ou sans technologie, d’ailleurs…
par Debra - le 10 juin, 2021
Laissez un commentaire